Obstacles en vue pour les véhicules électriques
Les investissements dans les énergies propres atteignent des niveaux records aux États-Unis, la croissance des véhicules électriques stagne, et l’Allemagne s’intéresse à une nouvelle source d’énergie en vue en provenance du Canada.
Le changement climatique expose la frontière arctique du Canada. Telle est la sombre évaluation de la GRC (ce contenu est disponible en anglais seulement) alors que l’on se préoccupe du fait que des nations rivales pourraient profiter du dégel des glaces pour « étendre leurs revendications territoriales » (ce contenu est disponible en anglais seulement) dans la région afin d’exploiter les matières premières et de profiter de nouvelles voies de transport. Parmi les autres menaces qui planent à travers le Canada figurent les événements météorologiques extrêmes et les sécheresses qui pourraient perturber la production de produits essentiels et susciter des inquiétudes de pénuries dans les pays développés. Ces avertissements sont similaires à ceux que l’on retrouve dans l’analyse menée l’Agence européenne pour l’environnement (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) qui laisse entrevoir que le continent n’est pas prêt à faire face à la multiplicité de risques climatiques « survenant en cascade et ayant un effet cumulatif » [Traduction].
Les investissements américains dans les énergies propres atteignent un niveau record. Dans le rapport du Rhodium Group et du MIT intitulé Clean Investment Monitor (ce contenu est disponible en anglais seulement), on indique qu’un montant sans précédent de 67 milliards de dollars US a été investi dans ce domaine au cours du quatrième trimestre de 2023. Les dépenses du gouvernement fédéral ont représenté 34 milliards de dollars US des 220 milliards de dollars US qui ont été consacrés à ce secteur en 2023, principalement sous la forme des crédits d’impôt prévus en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation. Bien que les conseillers de Donald Trump (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) affirment que l’ex-président pourrait fort bien éviscérer la loi historique en matière de climat promulguée par Joe Biden advenant son retour à la Maison-Blanche, cinq des dix plus grands bénéficiaires du financement prévu en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation sont des États qui ont voté en faveur du président Trump en 2020.
Shell édulcore ses objectifs en matière d’émissions. Le géant de l’énergie est désormais le troisième groupe pétrolier européen à revoir à la baisse ses ambitions climatiques, après que les sociétés BP Plc et Total Energies (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) eurent revu elles aussi leurs objectifs à la baisse l’an dernier. Si Shell a déclaré que ses activités tiendraient compte de la rapidité de la transition énergétique, elle a également formulé l’avertissement suivant : « Si la société n’atteint pas la carboneutralité d’ici 2050, en date d’aujourd’hui, se pose un risque important que Shell ne puisse pas atteindre cet objectif. » Malgré les investissements importants qui ont été réalisés dans le secteur des énergies propres, la demande mondiale en matière de combustibles fossiles continue de faire preuve de résilience. L’Agence internationale de l’énergie (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) a revu à la hausse ses estimations quant à la croissance de la demande de pétrole en 2024 pour une quatrième fois depuis novembre, et elle prévoit également une forte demande en matière de gaz(ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement)
L’hydrogène pourrait devenir la prochaine exportation énergétique d’importance du Canada. Ottawa a signé avec l’Allemagne (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) une entente non contraignante visant la vente d’hydrogène propre tirée des projets proposés sur la côte Est. La démarche générale consiste à permettre à l’Europe de se défaire de ses importations de pétrole et de gaz russe en les remplaçant par de l’hydrogène propre canadien. Plus de 80 projets d’hydrogène à faibles émissions de carbone ont été annoncés au Canada, et leur valeur estimée, au dire du gouvernement fédéral, est de 100 milliards de dollars. Jusqu’à présent, deux projets réalisés en Nouvelle-Écosse ont franchi l’étape de l’évaluation environnementale, tandis qu’un projet de transformation de l’énergie éolienne en hydrogène réalisé à Port au Port-Stephenville, à Terre-Neuve, attend une approbation gouvernementale. L’Allemagne prévoit importer jusqu’à 70 % de sa demande en hydrogène d’ici 2030 afin de décarboner ses secteurs industriels dont il est difficile de réduire les émissions.
TRANSPORT
Obstacles en vue
Les véhicules électriques (VE) se retrouvent-ils à la croisée des chemins ou sommes-nous en présence d’un ralentissement temporaire ? Souvent considéré comme constituant l’un des segments prometteurs de la transition énergétique, il suffirait de quelques erreurs pour perturber le parcours soigneusement tracé par le secteur, qui repose sur les subventions, les mesures incitatives et l’intérêt des consommateurs.
La vague de mauvaises nouvelles observée ces derniers mois se poursuit. Le nombre de modèles de VE admissibles aux crédits d’impôt aux États-Unis a chuté, passant de 43 à 19 en 2023, ce qui pourrait perturber les ventes et obliger les constructeurs à retarder leurs plans en matière de VE. En parallèle, les fabricants (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) de VE de l’ensemble de l’Amérique du Nord s’inquiètent d’une hausse des coûts et d’une baisse de la rentabilité, tandis que la capacité excédentaire en matière de VE de la Chine (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) pourrait atteindre les 10 millions par année. Le chef de la direction de la société de location de voitures Hertz a été contraint de démissionner après avoir fait un mauvais calcul en faisant l’acquisition de 100 000 voitures de marque Tesla ainsi que d’autres véhicules à zéro émission, avant de devoir vendre un tiers de sa flotte de VE dans un contexte de demande mitigée et de réparations onéreuses, tandis que sa rivale Sixt SE a entrepris de se départir progressivement de son parc de véhicules Tesla. Pour sa part, l’entreprise en démarrage dans le domaine des VE Fisker (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) est au bord de la faillite.
Au Canada, les immatriculations de véhicules électriques à batterie (VEB) neufs ont chuté de 9,5 % au cours du quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent, ce qui représente une baisse supérieure au recul de 6,4 % enregistré pour l’ensemble des véhicules. D’autres vents contraires planent à l’horizon : le Québec, soit l’une des provinces qui est à la pointe des ventes de VE, prévoit éliminer progressivement les remises sur les VE d’ici 2027, tandis que l’Alberta imposera une taxe d’immatriculation de 200 $ sur les VE à compter de 2025.
Tous ces facteurs pourraient ne constituer que des écueils temporaires en cours de parcours du fait de préoccupations économiques de nature plus générale et de problèmes affligeant les chaînes d’approvisionnement qui pourraient fort bien se résorber au fil des trimestres. Tout comme cela pourrait ne pas être le cas.
À mesure que le marché se repositionne, les véhicules hybrides – qui combinent à la fois un moteur à essence et une alimentation par batterie et qui offrent par ailleurs une meilleure consommation d’essence – apparaissent désormais comme constituant une solution provisoire prometteuse pour répondre au scepticisme des clients concernant l’autonomie et l’usage. L’an dernier, les ventes de VE (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) aux États-Unis ont atteint le niveau record de 1,2 million d’unités, en hausse de 46 %, cependant que les ventes de véhicules hybrides (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) ont augmenté encore plus rapidement, à hauteur de 65 %, pour franchir le cap des 1,2 million, faisant du même coup passer leur part de marché à 8 %, alors qu’elle était auparavant de 5,5 %. Au Canada, au cours de la dernière année, les nouvelles immatriculations de VEB ont augmenté de 41 % par rapport à 67 % dans le cas des véhicules hybrides. Les consommateurs semblent adopter une approche progressive à l’égard de la transition, même si les puristes estiment que les véhicules hybrides pourraient retarder l’atteindre des objectifs en matière de carboneutralité de l’industrie.
Les véhicules hybrides rattrapent les voitures à batterie
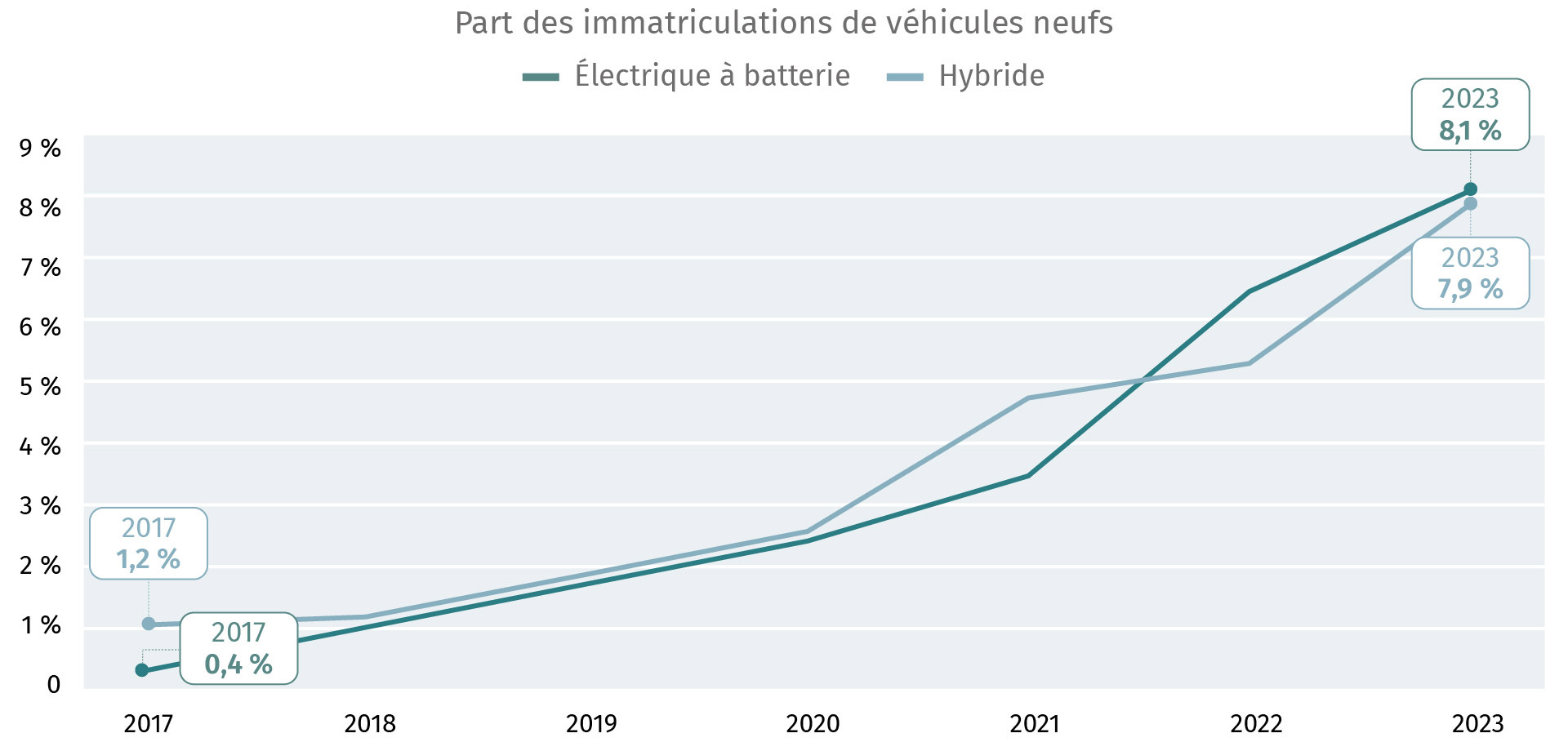
Source: Statistics Canada, RBC Climate Action Institute
Si la tendance devait persister, il se pourrait que certains constructeurs, comme General Motors, qui ont complètement laissé de côté les voitures hybrides soient pris de court. Tandis que d’autres, comme Toyota, pourraient assister au couronnement de leur quête déterminée en faveur des modèles hybrides.
Il est encore trop tôt pour déclarer quelque gagnant que ce soit, voire ce que réserve l’avenir aux VE. À de nombreux égards, le défi auquel est confronté le secteur automobile représente un microcosme de la transition énergétique dans son ensemble. En effet, si les mesures incitatives gouvernementales et les technologies prometteuses permettant pratiquement d’éliminer les émissions existent, il n’en reste pas moins que : a) le développement des nouvelles technologies est exigeant en investissements et b) l’intérêt de la part des consommateurs et des investisseurs demeure insuffisant. Invariablement, intervient alors une technologie de transition en guise de compromis.
GRAPHIQUE DE LA SEMAINE
L’énergie hydroélectrique s’épuise
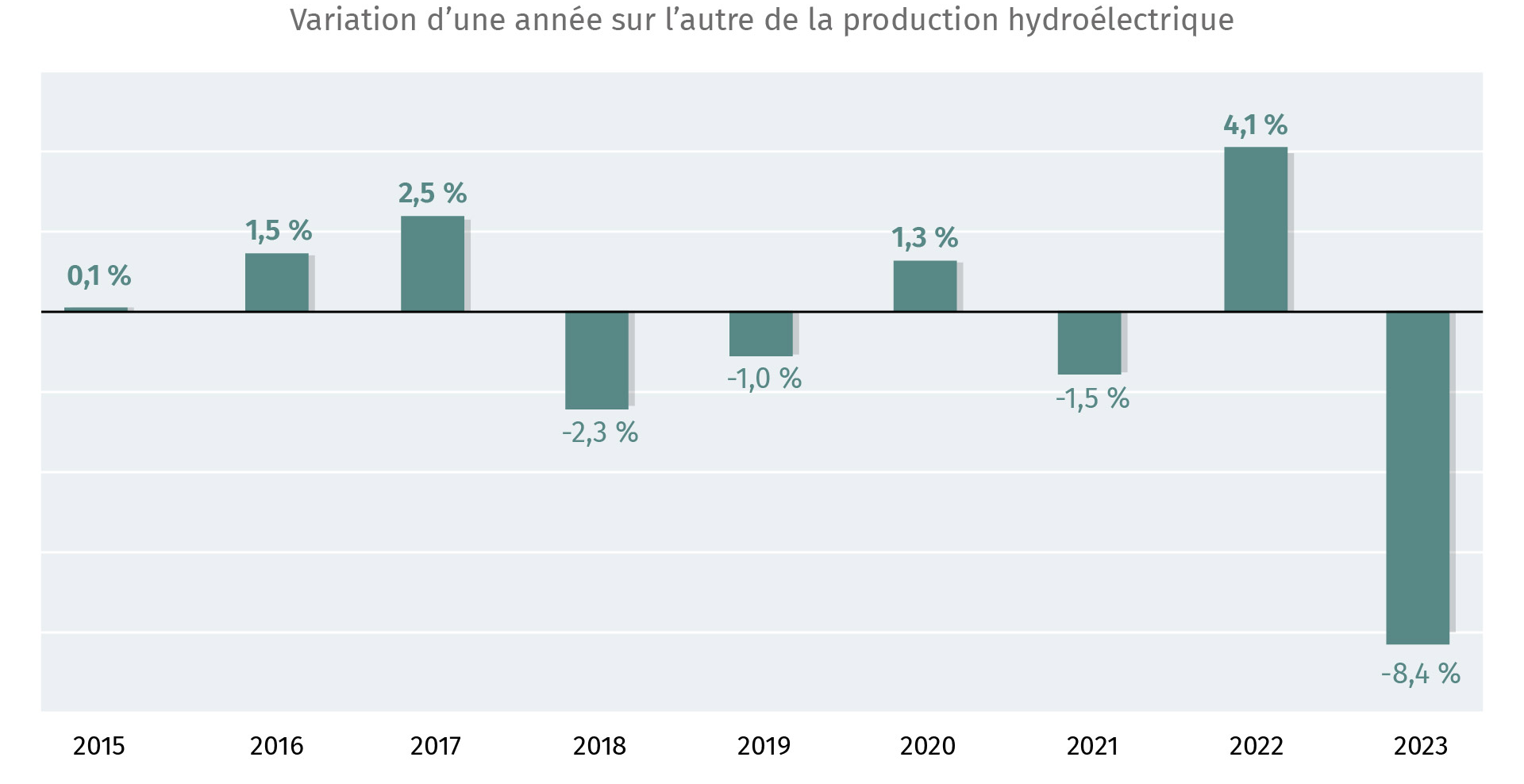
Source : Statistique Canada, Institut d’action climatique RBC
Les sécheresses ont mis à mal la situation de l’hydroélectricité au Canada l’an dernier. En effet, trois des plus grands producteurs d’hydroélectricité canadiens, soit le Québec (‑9,3 %), la Colombie-Britannique (‑21,5 %) et le Manitoba (‑12,1 %), ont été victimes de sécheresse ou de conditions anormalement sèches, estime Statistique Canada. Alors que la demande d’électricité devrait plus que doubler d’ici 2050, ce déclin met en évidence le défi qui se présente sur le plan de la résilience du système.
EN VEDETTE
80 $
Voilà le nouveau taux de la taxe fédérale sur le carbone, en hausse par rapport à 65 $ par tonne d’émissions de carbone, à compter du 1er avril. La plupart des familles canadiennes (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) verront également une augmentation de la remise (rebaptisée Remise canadienne sur le carbone) – 64 $ de plus chaque trimestre en Alberta et 36 $ de plus en Ontario, au Manitoba et en Saskatchewan. Ottawa (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) subit des pressions en vue de suspendre l’augmentation, dans un contexte de préoccupations en ce qui concerne la hausse des coûts.
Le programme Signaux climatiques est géré par Yadullah Hussain, directeur de rédaction, Institut d’action climatique RBC, avec la participation d’experts de l’Institut.
Articles précédents :
Le jeu à somme nulle de l’Alberta
L’Alberta ralentit l’élan de la province dans le domaine de l’énergie renouvelable, les petits réacteurs modulaires font leur apparition sur le radar des décideurs, et comment Brian Mulroney a résolu la pire crise écologique de son époque.
Merci, Brian Mulroney, d’avoir assaini l’air au Canada. Le 18e premier ministre du Canada, décédé la semaine dernière à l’âge de 84 ans, avait adopté un modèle de marché pour composer avec la pire crise écologique de son époque. Les pluies acides – un puissant cocktail de dioxyde de soufre et de dioxyde d’azote rejeté par les cheminées industrielles et les voitures – nuisaient à la biodiversité et causaient des ravages dans des milliers de lacs partout en Amérique du Nord. La persévérance dont il a fait preuve auprès de diverses administrations américaines a mené à la conclusion de l’Accord entre le Canada et les États-Unis sur la qualité de l’air en 1991. Quelle était la solution mise de l’avant par M. Mulroney ? Un système innovateur grâce auquel les entreprises pouvaient plafonner ou échanger leurs droits d’émission. Cette politique axée sur le marché a mis fin à une crise écologique de taille en l’espace de quelques décennies.
L’hiver du nucléaire est terminé. Un grand nombre d’ingénieurs, de financiers et de décideurs du monde entier se sont rencontrés la semaine dernière à Ottawa pour discuter des perspectives liées à une technologie éprouvée, mais légèrement actualisée : les petits réacteurs modulaires (PRM). Les PRM rassurent dans une certaine mesure, étant donné que certains d’entre eux sont fondés sur des technologies traditionnelles, mais leur prix est particulièrement élevé. Pour lire le commentaire de Myha Truong-Regan, responsable de la recherche sur le climat de l’Institut d’action climatique RBC, sur l’événement sur invitation seulement, cliquez ici (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement)
Les changements climatiques perturbent les activités de Warren Buffett dans le secteur de l’électricité. Le chef de la direction de Berkshire Hathaway se targue de miser sur des entreprises dont les flux de trésorerie sont peu excitants, mais stables, comme celles du secteur des services publics. Mais les activités du producteur d’électricité Pacific Corp., dans lequel Berkshire investit, n’ont vraiment pas été stables ces derniers temps. La société de services publics pourrait faire l’objet d’une poursuite du gouvernement des États-Unis (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) pour près de 1 milliard de dollars américains, en lien avec les incendies de forêt qui ont fait rage dans l’Oregon et en Californie en 2020. Il s’agit d’une somme distincte de celle de 299 millions de dollars américains versée pour le règlement d’une poursuite de 463 demandeurs touchés par des incendies dévastateurs dans l’Oregon. « Les besoins en électricité de l’Amérique et les dépenses en immobilisations qui en découleront seront formidables », mais certaines entreprises des services publics seront confrontées à des problèmes de survie dans un contexte d’obstacles liés à la réglementation et de perturbations causées par les changements climatiques, a prévenu M. Buffet dans le cadre de son message annuel aux actionnaires (ce contenu est disponible en anglais seulement)
L’IA pourrait donner une forte impulsion aux réseaux.Les 1,5 million de nouveaux serveurs de Nvidia utilisés pour l’intelligence artificielle consommeront 85,4 térawattheures par année lorsqu’ils fonctionneront à plein régime, d’ici 2027, selon une nouvelle étude (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) À elle seule, l’application ChatGPT d’OpenAI, qui appartient à Microsoft, consomme 564 MW par jour – assez pour approvisionner en électricité 20 000 ménages – pour répondre à 195 millions de demandes quotidiennes. « L’utilisation de l’IA revêt un caractère digne de Dickens en ce qui a trait à l’environnement : elle peut améliorer l’état de notre planète, mais elle peut aussi le dégrader », affirme le sénateur Edward Markey, qui appartient à un groupe de sénateurs américains (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) qui réclament une étude environnementale sur l’incidence de l’IA sur la demande d’électricité, les émissions de carbone, l’approvisionnement en eau et les déchets électroniques.
TABLEAU DE LA SEMAINE
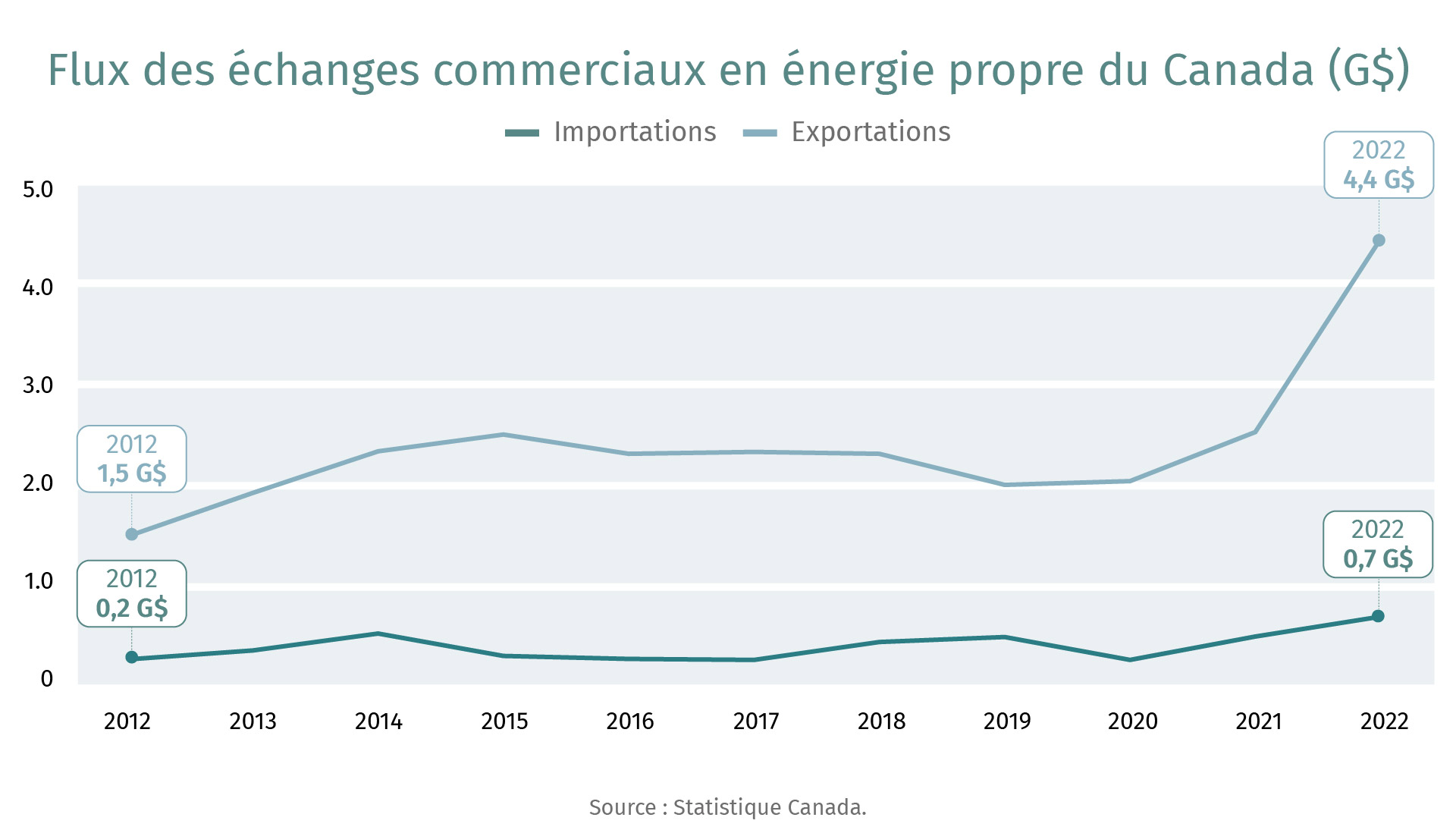
Le Canada est un exportateur net d’électricité propre tirée du nucléaire et de sources d’énergie renouvelable. Les États-Unis représentaient 78 % de l’ensemble des exportations canadiennes d’énergie propre en 2022. La valeur des exportations a augmenté à 4,4 G$ ou de 185 % depuis 2012. La valeur des exportations canadiennes d’énergie propre représente une fraction des exportations d’énergie traditionnelle du pays, qui se sont élevées à 160 G$ en 2022.
POLITIQUE
Le jeu à somme nulle de l’Alberta
La nouvelle stratégie de l’Alberta fait passer les énergies renouvelables au second plan.
De nouvelles règles provinciales imposent désormais des restrictions à l’égard des projets d’énergie renouvelable sur les terres agricoles de premier ordre, dans le cadre d’une approche accordant la priorité à l’agriculture. Il n’est plus permis non plus de construire des projets d’énergie renouvelable à moins de 35 kilomètres d’une zone protégée (selon les estimations du Pembina Institute (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), cela pourrait équivaloir à 76 % du sud de l’Alberta) ou de zones offrant des « points de vue imprenables », à quelques exceptions près. Il s’agit d’un coup dur pour le secteur en plein essor des énergies renouvelables. Cette décision complique aussi la tâche de la province canadienne dont les émissions sont les plus élevées pour limiter celles-ci et vient interrompre sa croissance, jusque-là la plus forte au pays, dans le domaine de l’énergie propre. Quelle sera la réaction du secteur des énergies renouvelables ? De plus amples renseignements sont attendus dans un avenir proche, mais des projets dont la valeur atteint 36 milliards de dollars (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) sont en jeu.
La semaine dernière, le budget de l’Alberta contenait peu de précisions en ce qui concerne l’intention du gouvernement en matière de transition énergétique, qui s’appuie sur le plan de réduction des émissions et d’exploitation énergétique (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) annoncé en 2023.
Au cours des trois prochaines années, le gouvernement affectera 597 millions de dollars du fonds provincial « Technology Innovation and Emissions Reduction » (TIER) pour soutenir les programmes de réduction des émissions et le développement de technologies vertes.
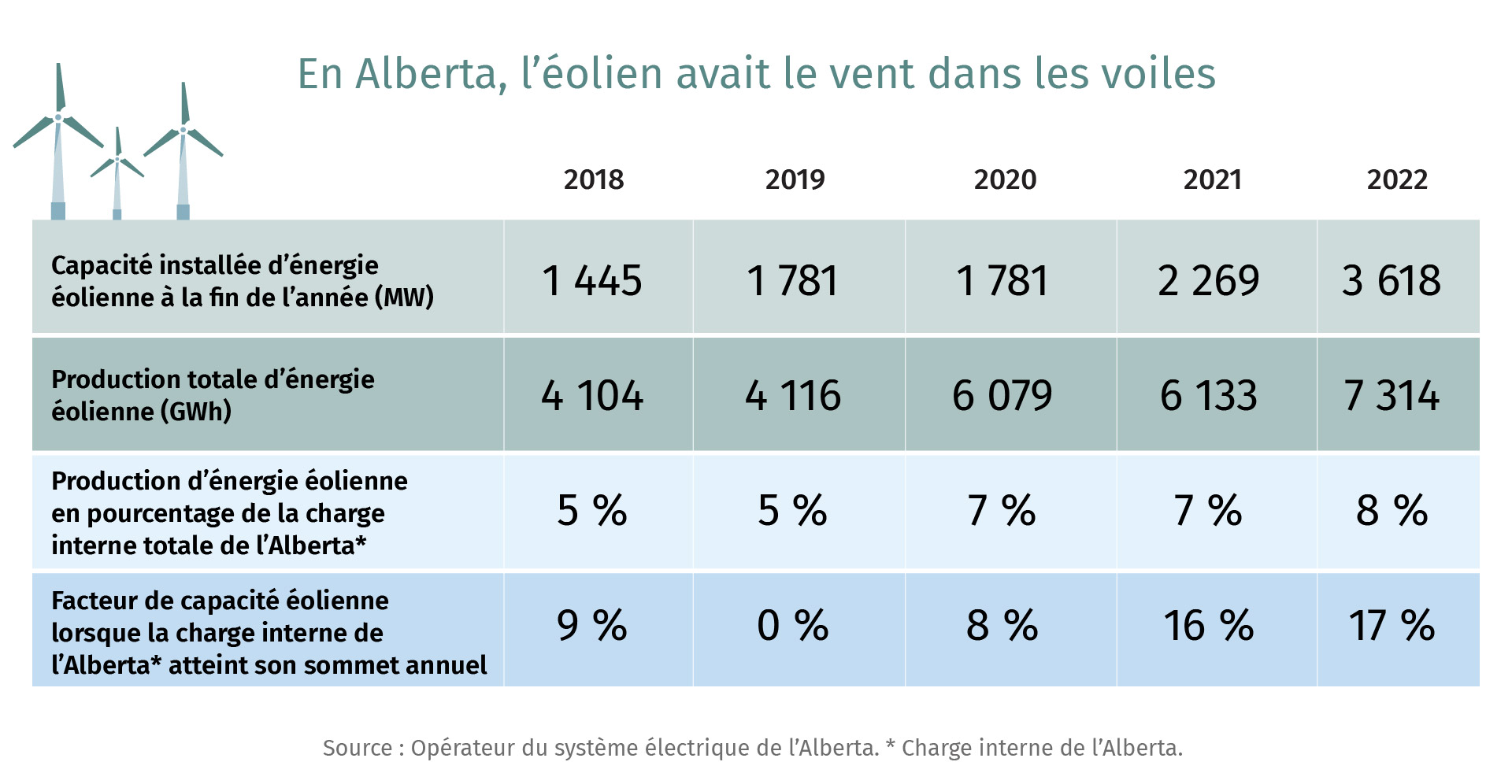
Malgré tout, le ralentissement dans cette province des projets d’énergie renouvelable apporte une dose d’incertitude de la part des investisseurs à l’égard de ce qui devait représenter une nouvelle source de revenus pour les municipalités et d’autres ordres de gouvernement.
La décision du gouvernement répond aux préoccupations de certaines communautés rurales, mais l’on craint que l’Alberta puisse rater la vague de dollars liée à la transition énergétique qui attend d’être investie. La province est bien placée pour conserver sa vigueur dans le secteur de l’énergie traditionnelle tout en mettant sur pied un nouveau système d’énergie propre en parallèle. L’Alberta peut gagner sur les deux tableaux : l’atteinte de la carboneutralité n’a pas à être un jeu à somme nulle.
Pour souligner la Journée internationale des femmes, John Stackhouse et sa coanimatrice Alison Nankivell, nouvelle directrice générale de MaRS Discovery District, discutent de façons d’inspirer la prochaine génération de femmes entrepreneures grâce à trois d’entre elles qui arrivent en première ligne dans le domaine des technologies vertes. Pour les écouter (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), cliquez ici.
EN VEDETTE
28,6 %
C’est le pourcentage de femmes parmi les travailleurs du secteur canadien de l’environnement et de la technologie propre en 2021 – ce pourcentage est inférieur à la moyenne nationale de 47,5 % dans l’ensemble des secteurs.
Le gouvernement engage la somme de 405 millions de dollars – qui vient s’inscrire dans un programme voué à l’économie propre de 1,3 milliard de dollars – pour se préparer aux urgences climatiques, alors qu’on apprend qu’en plein hiver couvent encore 92 incendies (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) en Colombie-Britannique. Les thermopompes et l’infrastructure publique de recharge des véhicules électriques ont également accaparé une partie du financement prévu dans le cadre d’un plan de dépenses de 435 millions de dollars principalement axé sur des programmes de subventions et de remises. Le NPD de David Eby a également annoncé un programme de garantie de prêts pour les Autochtones d’une valeur de 1 milliard de dollars ainsi que l’octroi d’une somme de 24 millions de dollars pour appuyer la collaboration avec les Premières Nations dans le contexte de sa stratégie sur les minéraux critiques. Malgré tout, le budget de 2024 (ce contenu est disponible en anglais seulement) met davantage l’accent sur l’accessibilité financière plutôt que sur le climat en cette année électorale.
La croissance viendra de l’est et du sud. Cette affirmation figurait parmi les 10 principaux points à retenir d’un récent événement organisé par l’Institut d’action climatique RBC qui a réuni plus de 100 penseurs du climat et chefs de direction d’entreprises appelés à discuter des conclusions du rapport Action climatique 2024. Plusieurs des technologies qui s’avèrent nécessaires dans les marchés en rapide industrialisation de l’Inde, du Brésil et de l’Indonésie, du captage du carbone à la surveillance par satellite, sont fabriquées au Canada. Alors que la majeure partie des nouvelles émissions mondiales proviendront des marchés émergents au cours des prochaines décennies, l’occasion de croissance est claire, tout comme l’est l’avantage qui en découlera sur le plan des émissions mondiales. Apprenez-en davantage sur les 10 mesures rapides que peut prendre le Canada au chapitre du climat ici (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement)
La Banque centrale européenne (BCE) ne veut pas de sceptiques verts dans ses rangs. « Pourquoi voudrions-nous embaucher des gens que nous devons reprogrammer ? » : voilà la question qu’aurait prétendument posé, lors d’une réunion, Frank Elderson (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), grand responsable du climat auprès de la BCE et l’un des six membres de son conseil d’administration. Ce commentaire suscite des interrogations sur le bien-fondé, pour les banques centrales, de s’employer principalement à assurer le maintien de la stabilité des prix ou d’élargir leur mandat de manière à englober la crise climatique. L’Agence internationale de l’énergie (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) fait également face à des critiques de la part d’un ancien conseiller de la Maison-Blanche, qui estime qu’elle s’est « éloignée » de sa mission fondamentale à titre d’organisme de surveillance de la sécurité énergétique et qu’elle a plié face aux « censeurs verts zélés ».
Turbulences en vue pour les technologies propres

Rares sont les signes qui marquent aussi traditionnellement l’arrivée du printemps au Canada que la publication des budgets gouvernementaux. (Reconnaissons que les rêves brisés d’emporter la coupe Stanley ponctuent également cette période de l’année.) La Colombie-Britannique a lancé le bal cette semaine en publiant un budget d’année électorale, qui montre vers où les autres provinces et Ottawa pourraient également se tourner au cours des deux prochains mois. Le soutien des consommateurs et des propriétaires est à la mode tandis que les stratégies industrielles et les dépenses climatiques ne le sont pas. Notre récent rapport Action climatique 2024 anticipait une telle réalité, sans pour autant s’en désespérer. Les gouvernements ont assumé la responsabilité à l’égard des questions climatiques depuis près d’une décennie, et le moment est venu pour les capitaux privés de faire leur part. Cette tâche ne sera pas facile pour autant, comme nous l’avons entendu de la bouche d’investisseurs et de chefs d’entreprise. La hausse des taux d’intérêt a freiné les investissements dans les technologies propres et contraint les entreprises à réduire leurs dépenses discrétionnaires. Si l’économie mondiale a besoin de 9 000 milliards de dollars US par an en investissements liés au climat, l’an dernier n’y ont été consacrés qu’environ 1 200 milliards de dollars US, dont la moitié a été dépensée en Chine.
Ce mois-ci, je me suis exprimé sur le sujet du défi des technologies propres dans le cadre du GLOBE Forum, une importante conférence biennale qui se tient à Vancouver. Nos recherches montrent que le Canada doit augmenter ses dépenses climatiques pour les faire passer à 60 milliards de dollars par an si nous souhaitons atteindre la carboneutralité. Si le volet des capitaux privés a marqué une croissance intéressante l’an dernier, y compris en ce qui concerne le capital-risque, il reste encore fort à faire. Et, comme je l’ai entendu dire par des investisseurs et des entrepreneurs du secteur des technologies propres à Vancouver, cette année s’annonce difficile. En effet, de nombreux investisseurs se sentent minés par la hausse des taux d’intérêt et la lenteur des résultats associés aux nouvelles technologies, qu’il s’agisse du captage du carbone ou du stockage dans des batteries. Les modèles de revenus n’existent tout simplement pas encore. Un signe d’inquiétude : le principal fonds mondial iShares voué aux titres du secteur des énergies propres accuse un repli de plus de 40 % depuis 2021. Ce type de sentiment compliquera la tâche des entreprises du secteur des technologies propres – et notamment de celles qui vendent de l’équipement –, s’agissant de réunir des capitaux. Manifestement, une baisse des taux d’intérêt contribuera à rendre ces investissements plus concurrentiels, comme c’est le cas des investissements réalisés par de grandes entreprises souhaitant décarboner leur portefeuille. Cependant, ceux qui espèrent un printemps hâtif en matière d’investissements climatiques devront faire preuve d’un peu plus de patience.
John Stackhouse
ÉLECTRICITÉ
Trois constats de la mise à jour sur le REP
La dernière mise à jour sur le Règlement sur l’électricité propre (REP) du gouvernement fédéral démontre qu’il assouplit sa position sur la réduction drastique des émissions des centrales électriques alimentées au gaz naturel d’ici 2035. Voici un certain nombre de constats formulés par Keigan Buck, responsable principal, Politique énergétique, Institut d’action climatique RBC :
- Cela représente une victoire majeure pour l’Ontario, et cette position donne également à l’Alberta et à la Saskatchewan plus de latitude dans la façon dont elles gèrent leur transition vers des sources plus propres.
- Les changements proposés ne devraient pas compromettre l’objectif de carboneutralité à l’horizon 2035 fixé pour le secteur de l’électricité si les dispositions relatives aux crédits compensatoires sont incluses.
- Des difficultés surgiront dans les menus détails, car la mise à jour ne fournit que peu d’information sur ce à quoi ressemblera le règlement une fois qu’il aura été arrêté de manière définitive.
Certains réseaux provinciaux pourraient éprouver de la difficulté
à atteindre l’objectif de carboneutralité à l’horizon 2035
Émissions de GES de 2021 dans le secteur de l’électricité par administration
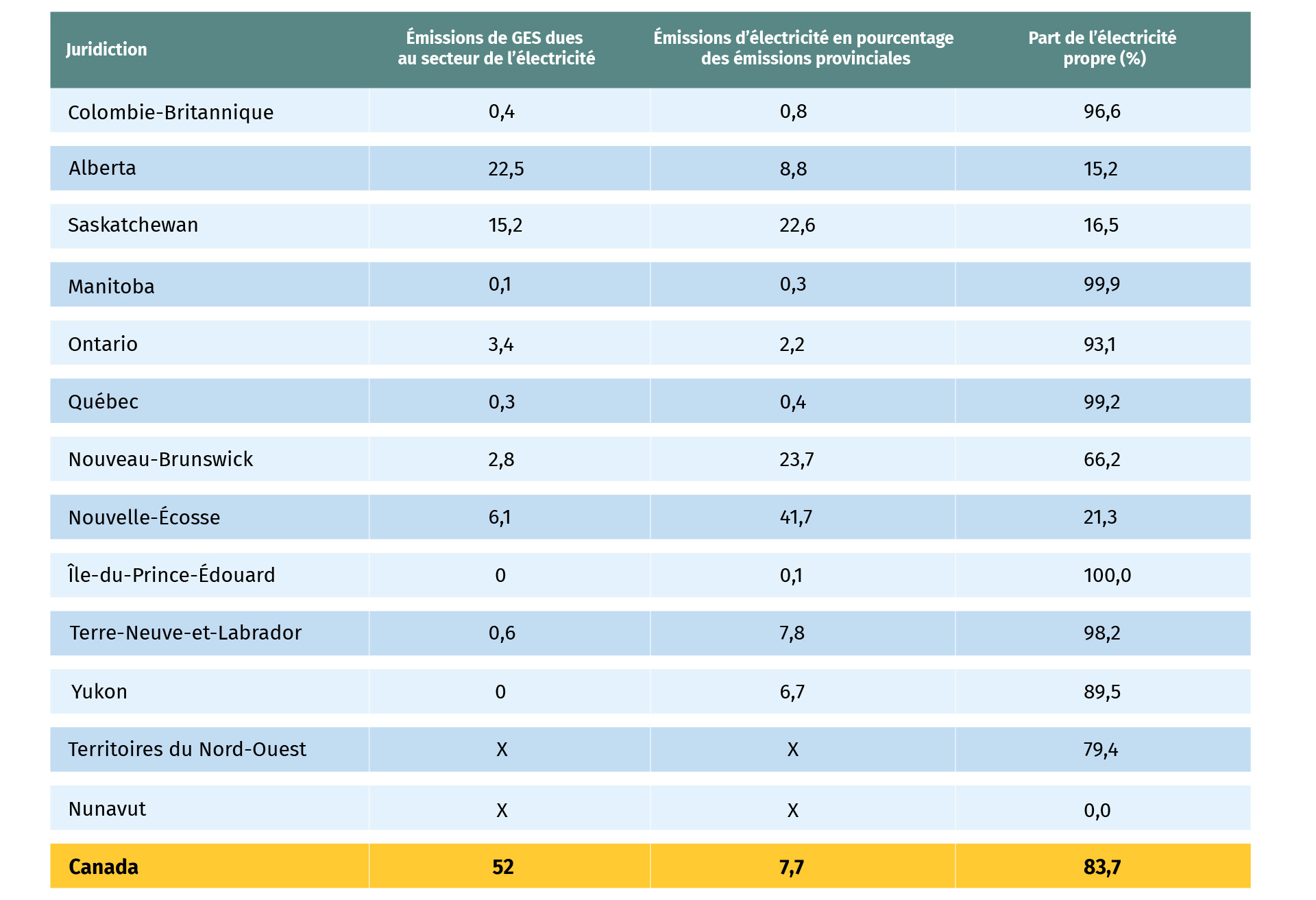
Source : Environnement et Changement climatique Canada, Institut d’action climatique RBC
TABLEAU DE LA SEMAINE
Le Canada est à la traîne des pays comparables en matière
de politiques de rénovation des bâtiments
Indice de rénovation (/100)
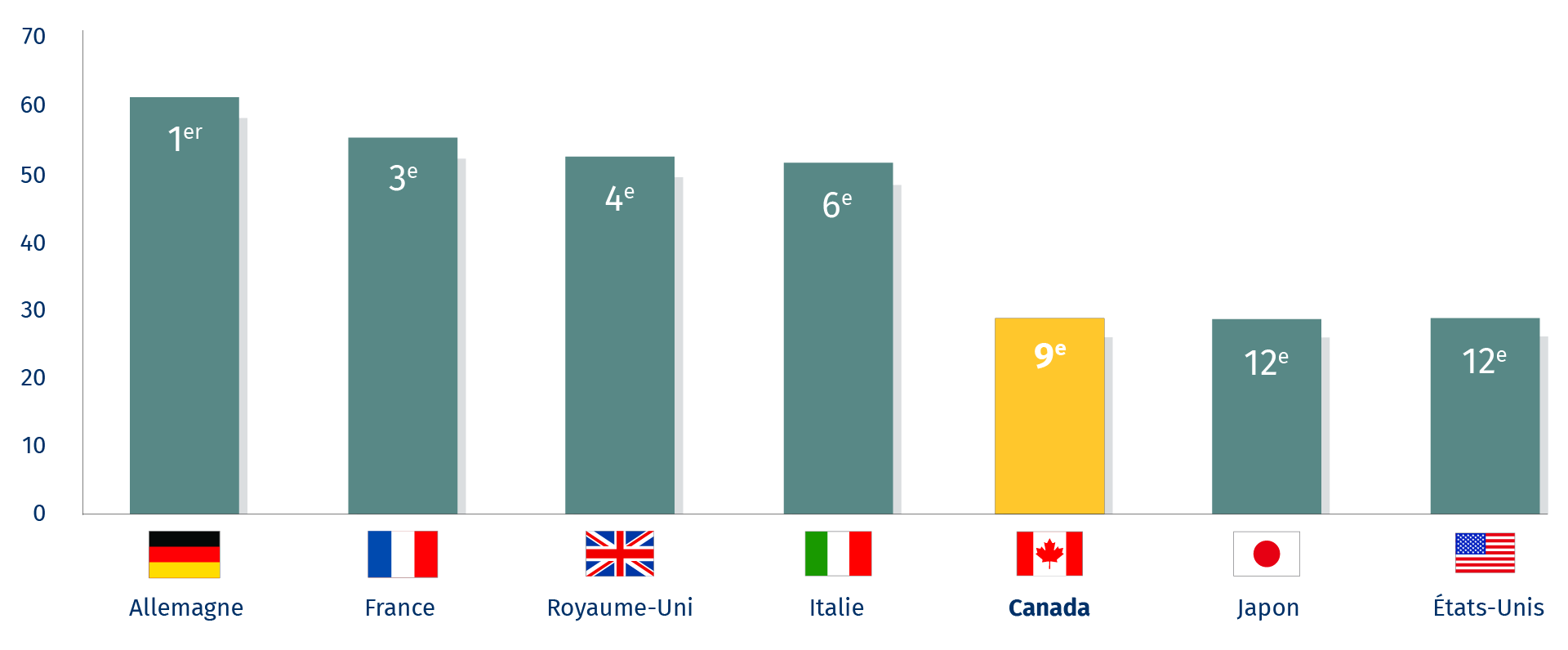
Source : 3 Keel, Global Retrofit Index Report, Institut d’action climatique RBC
La lenteur avec laquelle les constructeurs d’habitations canadiens adoptent des technologies adaptées au climat par rapport à leurs homologues du reste du monde pourrait poser un défi sur le plan de la décarbonation du secteur. Les bâtiments représentent 13 % des émissions nationales et une frénésie sur le plan de la construction d’habitations de même que l’augmentation des rangs de la population pourraient accentuer les émissions du secteur. Apprenez-en plus sur le défi que représentent les émissions du secteur du bâtiment ici.
EN VEDETTE
100 000
Nombre estimé de Manitobains qui sont tributaires de l’eau provenant des aquifères situés à proximité d’une proposition de projet d’extraction de sable de silice qui a été rejetée par le premier ministre Wab Kinew (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) la semaine dernière, alors que les gouvernements s’emploient à établir un équilibre entre la nécessité de nouvelles chaînes d’approvisionnement énergétique et la protection de l’environnement. Le sable intervient dans la production de panneaux solaires et de nouvelles batteries. Le gouvernement du NPD (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) a récemment approuvé un autre projet de mine de silice à proximité du lac Winnipeg (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement)
Dans ce numéro : les découvertes surprenantes relatées dans notre premier rapport annuel sur les progrès du Canada à l’égard du climat, les raisons pour lesquelles les agriculteurs de l’Union européenne n’entendent pas à rire et notre conseil pour la Saint-Valentin.

Il est temps de mettre les bouchées doubles
Taxonomie. Le terme « sceau vert d’approbation » utilisé pour classifier les investissements durables était sur toutes les lèvres des participants au lancement d’Action climatique 2024 (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), le rapport inaugural emblématique de l’Institut, qui examine les progrès du Canada dans six secteurs clés et présente des idées sur la voie à suivre. Mark Carney (ci-dessus), président de Brookfield Asset Management, et Chris Hadfield, astronaute, y étaient présents.
Toutes les sphères de l’économie sont engagées dans l’action climatique, mais les mesures en cours ne suffisent pas. Pour passer en vitesse supérieure, il faudrait doubler la mise de 35 milliards de dollars que les pouvoirs publics, le milieu des affaires et les consommateurs du Canada injectent chaque année dans la lutte contre les changements climatiques. Or, les gouvernements sont au pied du mur sur le plan budgétaire. D’ici 2030, le fardeau du maintien et de l’accélération de l’action climatique pourrait donc retomber sur les épaules des entreprises.
Pour leur part, les entreprises se montrent dynamiques quant à leurs ambitions climatiques. Un consensus s’est dégagé parmi les participants à l’événement : il y a beaucoup de capitaux disponibles à l’échelle nationale et mondiale pour financer l’écologisation économique du pays. L’accès à cette réserve d’argent demeure un défi, en l’absence d’une taxonomie fédérale pour le financement vert et celui de la transition. Les fonds vont là où c’est le plus facile et où il y a une certitude réglementaire. Le mandat du gouvernement fédéral actuel arrive à terme en octobre 2025, mais certains pensent que des élections pourraient être déclenchées plus tôt. En tout état de cause, l’année précédant des élections est souvent une période au cours de laquelle on fait peu avancer les initiatives qui ne débouchent pas sur séance de photos pour la présentation d’un chèque d’argent frais. Si aucune taxonomie finale concernant le financement vert et celui de la transition n’est mise en place avant cela, les entreprises canadiennes auront de plus en plus de difficulté à obtenir le financement à moindre coût dont elles ont besoin pour concrétiser leurs ambitions climatiques. Il n’y a pas une minute à perdre, et les Canadiens – pouvoirs publics, milieu des affaires et consommateurs – doivent redoubler d’efforts pour lutter contre les changements climatiques. — Myha Truong-Regan
Nous sommes no 1 ! Selon le nouveau classement (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) de BloombergNEF (BNEF), le Canada a détrôné la Chine au premier rang des meilleurs endroits au monde pour construire une chaîne logistique de batteries. Dans le cadre de l’enquête menée auprès de 30 pays, on a cité les avancées canadiennes au chapitre de la fabrication et de la production, l’engagement ferme des gouvernements fédéral et provinciaux en faveur du climat et l’excellente intégration avec le secteur automobile des États-Unis (en troisième place) comme raisons de faire du Canada un lieu d’implantation idéal pour l’industrie automobile mondiale. Bien que la Chine soit toujours dotée de la chaîne d’approvisionnement la plus solide au monde, BNEF l’a reléguée au deuxième rang à cause des préoccupations liées à la durabilité de ses batteries lithium-ion.
Les agriculteurs de l’Union européenne (UE) en ont contre ses règles écologiques. Les agriculteurs ont aligné les tracteurs dans les rues de Bruxelles et ont lancé des œufs (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) et du fumier (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) dans la capitale européenne pour manifester leur frustration à l’égard de la politique phare du bloc en matière d’alimentation durable. D’autres protestations ont émergé sur tout le continent (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) La stratégie « de la ferme à la table » de l’UE qui, selon les producteurs, nuit à leur compétitivité par rapport aux importations, constitue un lourd grief. L’UE a cédé, abandonnant un projet visant à réduire de moitié l’utilisation des pesticides. De plus, l’agriculture a été exclue d’un nouveau plan détaillé de l’UE au sujet de la diminution de 90 % de ses émissions d’ici 2040.
La Subvention canadienne pour des maisons plus vertes est en cours de révision. Le programme qui arrive à échéance dans deux semaines a permis à plus de 165 000 ménages d’adopter la thermopompe (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) et d’effectuer d’autres améliorations énergétiques. La nouvelle phase (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) ciblera les ménages canadiens à faible revenu et à revenu médian, car certains estimaient que le programme favorisait auparavant les mieux nantis. D’ici 2027, il devrait aider jusqu’à 550 000 ménages à réaliser des économies annuelles moyennes de 386 $ sur leurs factures d’énergie et avoir pour effet de retirer l’équivalent de 185 000 voitures des routes par année.
L’énergie propre a soutenu l’économie chinoise en 2023. D’après Carbon Brief (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), l’énergie propre a contribué à hauteur de 1,6 billion de dollars américains à la deuxième économie mondiale. Sans cet apport, le PIB du pays aurait chuté à un niveau relativement faible (comparativement à la norme chinoise) de 3,3 %. En réalité, il s’est chiffré à 5,2 % en 2023. Le secteur des véhicules électriques compte parmi ceux qui ont stimulé la croissance, la société BYD (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) basée à Shenzhen ayant depuis peu surpassé Tesla en termes de ventes de voitures. Les autorités chinoises ont récemment mis en garde contre la surcharge du marché intérieur des véhicules électriques, au moment où la croissance mondiale ralentit.
Cinq (autres) points à retenir du rapport Action climatique 2024
Notre tout premier rapport (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) de la sorte est un bilan de santé annuel sur l’état d’avancement de l’action climatique au Canada. Bien qu’il y ait des foyers de progrès, tous les secteurs clés (pétrole et gaz, bâtiment, électricité, transport et industrie lourde) doivent en faire plus. Seul le secteur de l’agriculture est en voie de dépasser ses objectifs climatiques de 2030, mais cela n’empêche pas les agriculteurs d’avoir du pain sur la planche.
Capitaux et réductions requis pour atteindre les cibles du Canada pour 2030
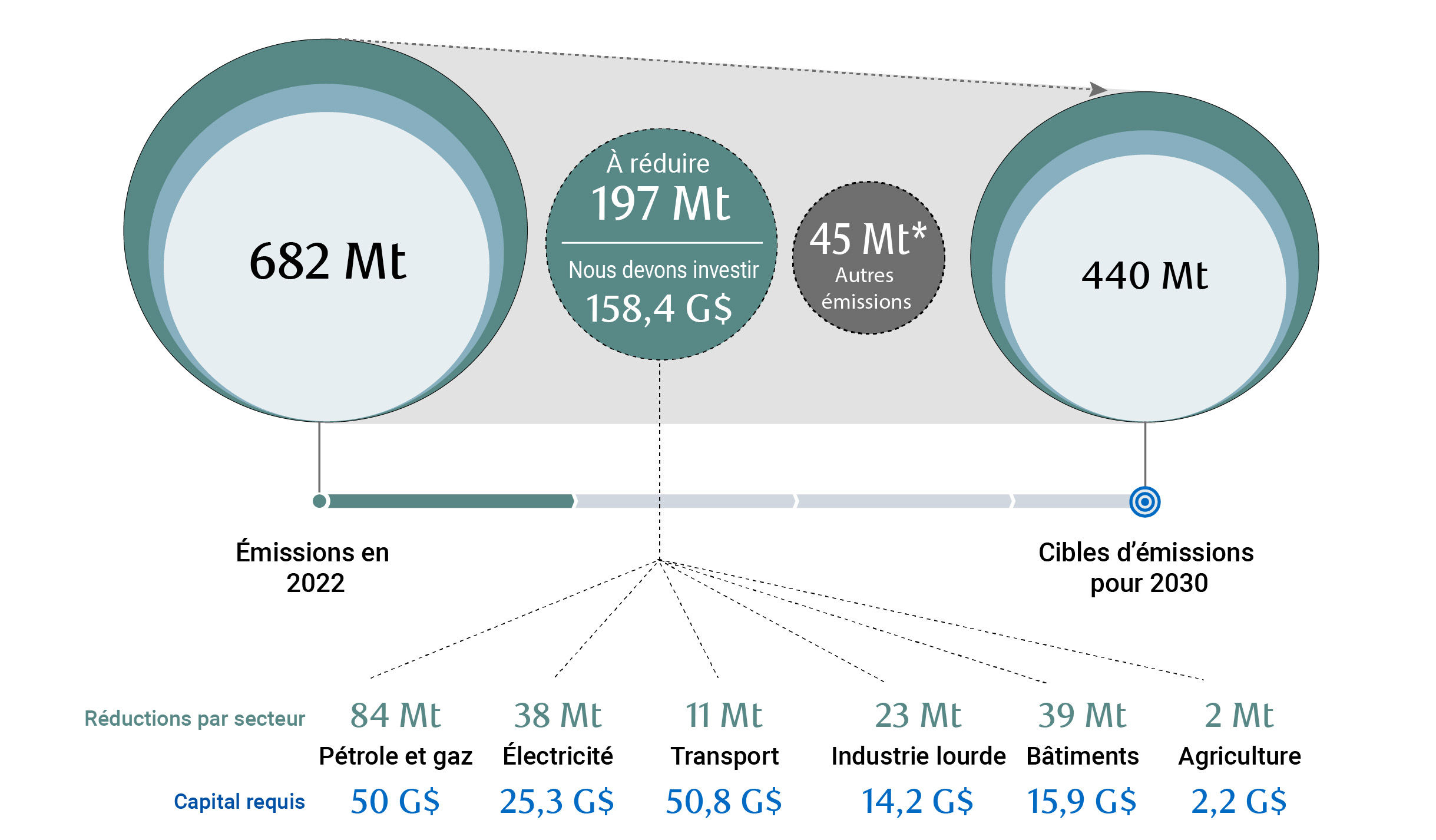
*Les autres émissions comprennent les déchets, l’utilisation
des terres, l’aménagement du territoire et la foresterie
Vous trouverez les principales conclusions du rapport ici (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) Voici également une liste de découvertes que j’ai trouvées surprenantes :
- Le parc en cours de construction ne représente que 6 % des nouvelles capacités éoliennes (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) nécessaires pour aboutir à un réseau électrique carboneutre d’ici 2035. Et nous pourrions avoir du mal à construire davantage, car l’Ontario a récemment donné aux collectivités locales plus de pouvoir pour rejeter les projets éoliens. Le syndrome du « pas dans ma cour » est bien réel.
- Seulement un Canadien sur 10 parcourt plus de 70 km par jour pour se rendre au travail et en revenir (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), ce qu’une charge par semaine suffit à combler. Pourtant, l’anxiété liée à l’autonomie existe bel et bien chez les Canadiens. Est-ce qu’elle freine les ventes de véhicules électriques ?
- Environ 40 % des thermopompes (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) à l’échelle mondiale sont fabriquées en Chine, qui est à la fois l’un des principaux exportateurs et l’un des principaux utilisateurs de cette technologie. La chaîne d’approvisionnement pourrait-elle se retrouver sous pression à mesure que la demande mondiale augmente ?
- Les agriculteurs canadiens (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) craignent que les nouvelles pratiques respectueuses du climat ne génèrent pas d’aussi bons rendements. En outre, environ un quart d’entre eux sont très préoccupés par le manque de main-d’œuvre. Comme nous l’avons indiqué dans un rapport l’an dernier, d’ici 2033, 40 % des agriculteurs auront pris leur retraite.
Le monde semble s’attaquer aux émissions de méthane (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) provenant du pétrole et du gaz. Mais peut-être que nos évaluations des émissions actuelles sont inexactes. Au Canada, sept des 130 projets axés sur la réduction du méthane ne font pas le suivi des émissions.
Pour lire le rapport en entier, c’est par ici (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement)
GRAPHIQUE DE LA SEMAINE
Selon les données de BNEF (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), la transition énergétique a fait l’objet d’un investissement record de 1,76 billion de dollars américains en 2023. Ce n’est toutefois pas suffisant. En effet, pour que le scénario de carboneutralité de BNEF se réalise, il faudrait que ce montant soit multiplié par 2,7 (passant à 4,8 billions de dollars américains) de 2024 à 2030.
Le Canada doit accélérer la cadence dans la même mesure et injecter 2,7 fois plus d’argent (60 milliards de dollars par an) pendant cette période. C’est ce que révèle notre rapport Action climatique 2024 (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement)
Montants records injectés dans la transition énergétique mondiale (G$ US)
Investissements mondiaux dans la transition énergétique par secteur
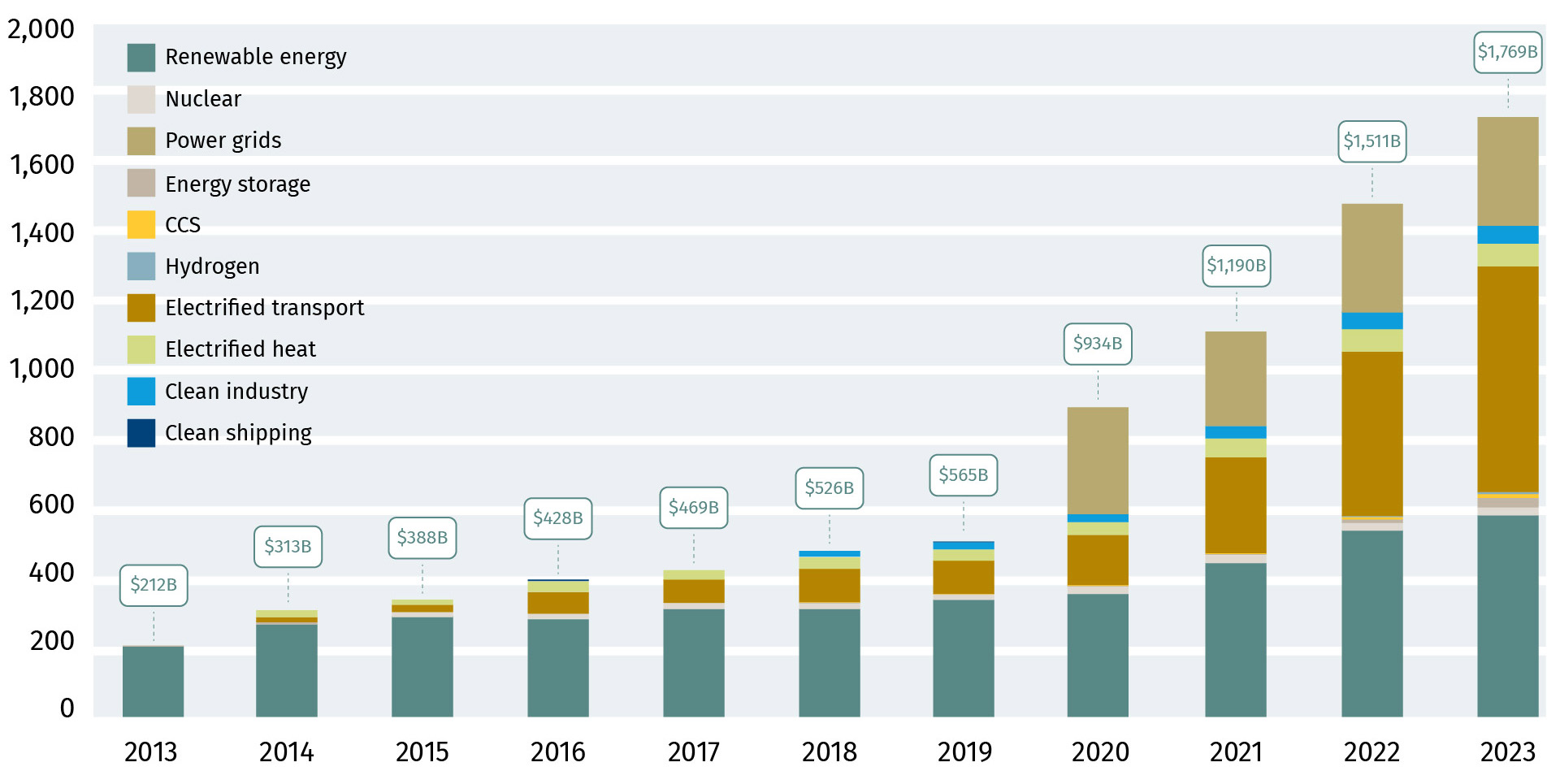
Ce contenu est disponible en anglais seulement
Sources : Statistique Canada, Recherche économique RBC
EN VEDETTE
78 000 voitures
L’équivalent des émissions générées par les roses (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) et autres fleurs coupées envoyées par avion de la Colombie vers les États-Unis pour la Saint-Valentin (en 2018). En 2023, la majorité des roses coupées vendues au Canada provenaient de la Colombie. Un conseil pour la Saint-Valentin mercredi prochain : cherchez plutôt des plantes vivaces produites localement et demandez à votre fleuriste de laisser tomber l’emballage en plastique.
Les nations viennent-elles de marquer la fin de l’ère du pétrole dans l’une des villes pétrolières les plus riches du monde ?
Dans le numéro de cette semaine : Le monde entier – si l’on peut dire – convient de délaisser les combustibles fossiles dans une ville pétrolière ; plus de Canadiens que jamais auparavant ont fait sur Google une recherche portant sur la formule « anxiété climatique » ; et Ottawa se fixe pour objectif de réduire le volume des éructations de vaches qui ont un effet nocif sur le climat.
Le bulletin Signaux climatiques fait une courte pause. Vous nous retrouverez dans votre boîte de réception dès le 16 février. Joyeuses fêtes !
Un cirque au milieu du désert : la COP28 ou la crise existentielle de l’action climatique
Par John Stackhouse
La COP des affaires. La COP du pétrole. La COP du pragmatisme. La COP de la capitulation. Il y a eu presque autant d’étiquettes accolées à la conférence sur le climat de Dubaï que de personnes présentes (100 000). Mais une chose est sûre : le rassemblement annuel des Nations unies ne sera possiblement plus jamais le même. Il y avait des vélos et des scooters électriques pour transporter les visiteurs sur le vaste site de l’exposition de Dubaï, des pare-soleil rétractables un peu partout et des hectares de pavillons intérieurs mettant en valeur tout ce que le Moyen-Orient fait dans la nouvelle économie. Et au dernier moment, un accord remarquable, bien qu’imparfait, a été conclu pour sortir le monde des combustibles fossiles.
Venons-nous d’assister à la fin de l’ère de l’or noir dans l’une des villes pétrolières les plus riches de la planète ? Ou était-ce davantage une manifestation politique qu’une volonté stratégique ? Quoi qu’il en soit, la 28e conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques passera à l’histoire comme un tournant dans la diplomatie liée au climat. Il s’agit peut-être d’une crise existentielle, peut-être d’une entrée dans la fleur de l’âge. Voici quelques-unes des tendances que j’y ai observées :
L’action climatique est maintenant une affaire de gros sous : DDubaï a constitué une bonne métaphore pour le dilemme auquel était confrontée la COP, avec une culture commerciale gagnante axée sur la carboneutralité. Les Émirats arabes unis, pays hôte de la conférence, n’ont présenté aucune excuse pour la tenue d’une conférence axée sur les affaires, choisissant comme site un vaste parc commercial abritant normalement certains des plus grands festivals du capitalisme du monde. De nombreux chefs d’entreprise ont passé plus de temps à de somptueuses conférences et à des événements connexes se tenant dans les célèbres hôtels chics de Dubaï, où furent annoncés des engagements d’une valeur de 37 milliards de dollars US, dont 7 milliards de dollars US pour des systèmes alimentaires adaptés au climat.
On est loin de Paris : Même si l’encre figurant sur le communiqué final n’est pas encore tout à fait sèche, la COP28 restera probablement dans les mémoires comme représentant la croisée des chemins sur un parcours ayant débuté en 2015 à Paris. À l’époque, la COP21 avait au cœur de ses préoccupations l’ambition, alors que le monde s’était engagé à réduire de manière significative et suffisamment rapide les émissions de gaz à effet de serre pour éviter tout impact climatique catastrophique. Les progrès réalisés depuis Paris sont inégaux, comme en a témoigné un exercice de « prise de bilan » mené à Dubaï. Le thème de la conférence – s’unir, agir et obtenir des résultats – témoignait d’un ton plus pragmatique en rapport avec lequel on pourrait fort bien voir le monde entier bientôt admettre que les objectifs de Paris, qui furent actualisés à l’occasion de la COP26 qui s’est tenue à Glasgow, pourraient ne pas être réalisables, à tout le moins dans le temps imparti.
Le nerf de la guerre, c’est le pétrole, évidemment : TL’hôte de la COP, Sultan Ahmed al-Jaber, dirige également la plus importante société pétrolière et gazière des Émirats arabes unis et est un acteur sérieux au sein de l’OPEP. De sorte que le fait qu’il eut lancé la conférence en évoquant l’engagement pris par 50 grandes sociétés pétrolières représentant 40 % de la production mondiale à se décarboner d’ici 2050, et qu’il eut mis un terme à celle-ci en annonçant le premier engagement jamais encore pris dans le monde à l’égard de l’élimination progressive des combustibles fossiles, est loin d’être négligeable. Si les aspects relatifs au calendrier, aux lieux et à la façon n’ont pas encore été définis, il n’en demeure pas moins que la COP28 a tracé une ligne dans le sable.
Mais non, ce sont les énergies renouvelables : Un sentiment clairement palpable lors de la COP28 tient à la montée irréversible des énergies renouvelables. La conférence s’est engagée à tripler les énergies renouvelables d’ici 2030 tout en doublant l’efficacité énergétique. L’énergie éolienne et solaire était omniprésente partout aux Émirats arabes unis, qui aimeraient se représenter comme une puissance dans le domaine des énergies renouvelables. L’hydrogène vert figurait également au cœur des discussions de la conférence. Il s’agit de l’hydrogène créé par l’énergie éolienne ou solaire et qui est généralement convertie en ammoniac, qui sera expédié vers les marchés énergivores. Qui en sera le plus important fournisseur ? Les Saoudiens et les Chinois travaillent de concert à travers l’Asie pour s’implanter rapidement, tandis que les États-Unis envisagent une stratégie d’exportation d’hydrogène plus ambitieuse. Pour autant que soit mis en place le schéma d’intéressement approprié pour permettre de concurrencer les combustibles fossiles, l’hydrogène texan pourrait devenir le plus grand rival de l’alliance sino-saoudienne. Puis il y a le Canada, alors que des propositions ont été formulées à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse et au Québec. Manifestement, la course à l’hydrogène vert est lancée.
Ou est-ce un mélange des deux ? : Si la notion de sécurité énergétique ne fut pas particulièrement populaire lors de la COP, elle figure néanmoins en tête des priorités de l’administration Biden. En effet, John Kerry occupe toujours la majeure partie du temps au podium lors de ces conférences, avec ses attaques à peine voilées envers les grandes sociétés pétrolières dans le style d’Al Gore. Cependant, loin du micro, d’autres responsables ont énoncé une vision plus pragmatique ancrée dans les impératifs de sécurité nationale. Ils ne souhaitent en effet pas être tributaires d’un seul fournisseur de quoi que ce soit, ce qui signifie que les États-Unis et ses alliés devront s’assurer de faire intervenir une plus large gamme de sources énergétiques, même s’il devait en coûter un peu plus pour l’économie. Cette solution pourrait laisser une plus large place au nucléaire alors que 20 pays, au rang desquels figure le Canada, sont venus à la COP pour s’engager à tripler la production nucléaire d’ici 2050. Pour atteindre la carboneutralité, 100 GW d’énergie nucléaire supplémentaire devront être mis à disposition, soit 10 fois les niveaux actuels.
Pour en apprendre plus sur les réflexions de John après la tenue de la COP, lisez son reportage complet depuis Dubaï here.
Où se tiendra la prochaine COP ? La grand-messe du climat est à la recherche d’un nouveau lieu et Baku, la capitale de l’Azerbaïdjan, pourrait être couronnée gagnante. En vérité, tout cela tourne autour de considérations géopolitiques : en effet, c’est au tour d’un pays d’Europe de l’Est d’accueillir le sommet annuel des Nations Unies sur le changement climatique, mais la Bulgarie a été contrainte d’abandonner après que la Russie eut menacé d’opposer son veto à toute candidature provenant d’un pays de l’Union européenne. L’Arménie, ardente rivale de l’Azerbaïdjan, à l’égard de laquelle le Kremlin fait preuve de neutralité, s’est également retirée en partie pour lui permettre de résoudre son conflit avec son important voisin. La Moldavie était également en lice. Un organe plénier de la COP prendra ultimement une décision en faisant un choix parmi une liste de candidatures de plus en plus restreinte.
Les énergies renouvelables canadiennes devraient rebondir après quelques années difficiles. Telles sont les prévisions de RBC Marché des Capitaux pour 2024 pour un secteur qui a éprouvé de la difficulté du fait de l’effet combiné des contraintes liées aux chaînes d’approvisionnement, de taux d’intérêt plus élevés et d’une inflation importante des coûts des projets. Cependant, une nouvelle époque pourrait s’amorcer en 2024 alors que les subventions gouvernementales et les crédits d’impôt accéléreront le déploiement des énergies renouvelables. Comme le signale le rapport : « Nous sommes d’avis que, parmi les vents favorables touchant le secteur en 2024, figurent des taux d’intérêt moins élevés, une inflation en voie de se modérer ainsi qu’un ralentissement de l’activité économique (ce qui améliorera la situation sur le plan de la disponibilité de la main-d’œuvre). »
Des carottes pour le secteur agricole, des bâtons pour le secteur pétrolier et gazier.Peu de temps après avoir publié une proposition touchant le plafonnement des émissions visant le secteur pétrolier et gazier, Ottawa a dévoilé une ébauche de régime de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre visant à inciter les éleveurs de bovins de boucherie à réduire le méthane entérique émis pendant le processus digestif des bovins et libéré dans l’air lorsque les vaches éructent. Si ce régime devait être finalisé, il pourrait s’avérer important puisque l’agriculture est responsable de 31 % des émissions totales de méthane du Canada.
Vous vous sentez anxieux face au climat ? Cette année, à travers le monde, les recherches Google portant sur le thème de l’anxiété climatique se sont multipliées, alors que le nombre de requêtes de recherche formulées en anglais sur l’expression « climate anxiety » (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) (anxiété climatique) au cours des 10 premiers mois de 2023 s’est avéré 27 fois plus élevé qu’il y a six ans, tandis qu’une augmentation des recherches formulées en chinois, en arabe et en portugais a également été observée. Google Trends combine les notions d’écoanxiété et d’anxiété climatique. Par rapport à l’an dernier, les recherches portant sur le changement climatique (en hausse de 120 %), l’adaptation (en hausse de 120 %), les émissions de gaz à effet de serre (en hausse de 120 %) et la durabilité (en hausse de 40 %) ont également été populaires.
TABLEAU DE LA SEMAINE
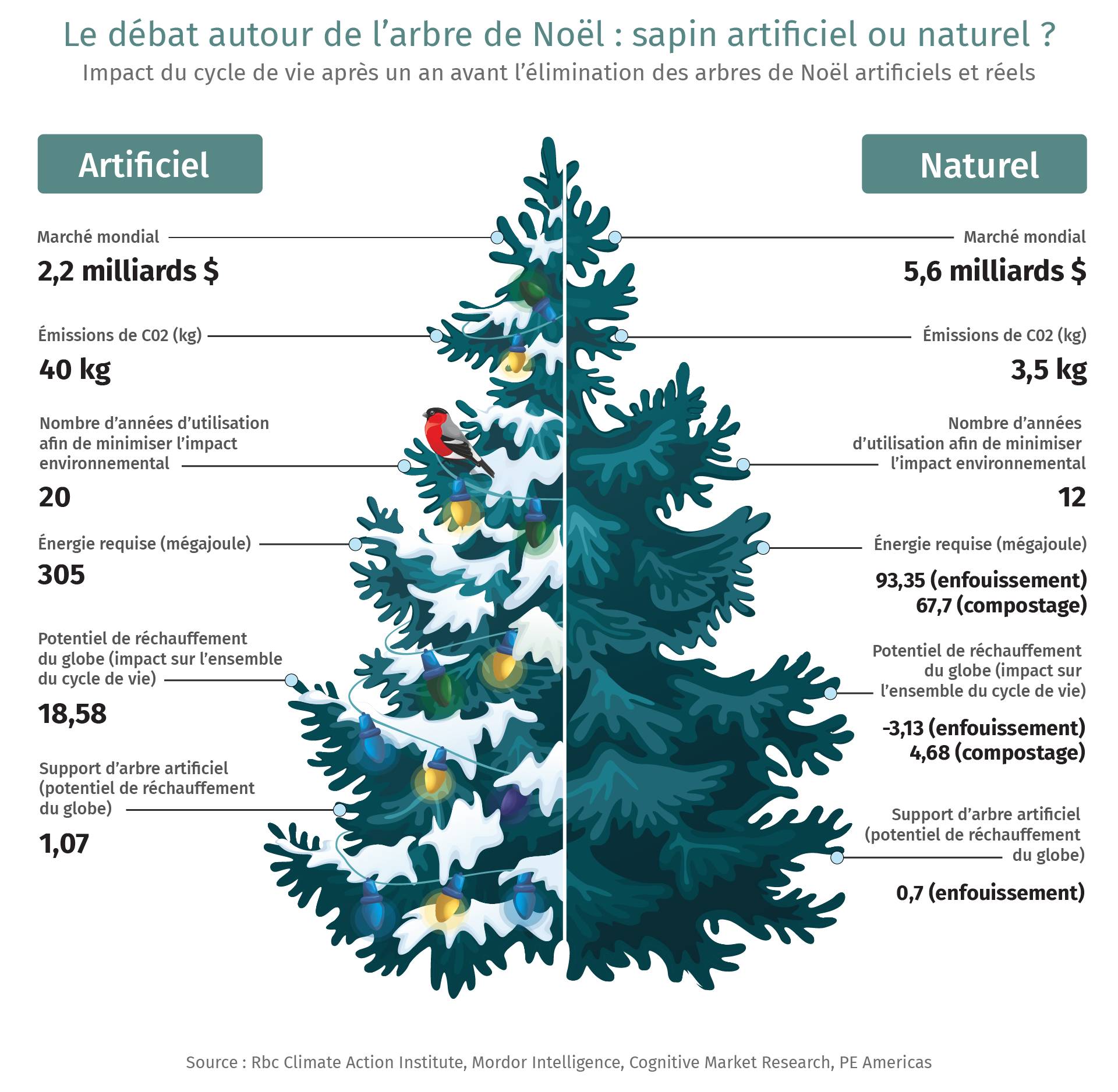
Il ne nous viendrait pas à l’idée de jouer le rôle du grincheux qui vient atténuer la joie que vous éprouvez durant le temps des Fêtes, mais cette saison peut conduire à un peu plus de gaspillage (et d’excès alimentaires), alors que nous faisons plus de folies qu’à l’habitude. Les arbres de Noël sont des décorations à l’égard desquels il pourrait y avoir lieu de se montrer un peu plus respectueux du climat. Bien que les arbres naturels puissent sembler constituer le choix durable – pour autant qu’ils soient détruits de manière responsable –, en vérité il n’y a pas de mauvaise réponse : si vous préférez les arbres artificiels, assurez-vous de vous en servir année après année.
EN VEDETTE
12e
Tel est le classement de la ville de Vancouver dans un sondage de portée mondiale portant sur les principaux pôles mondiaux de technologie propre. La région de Toronto-Waterloo s’est classée au 13e rang tandis que Calgary s’est classée loin derrière, entre les rangs 31 et 35, dans le sondage mené par Startup Genome (ce contenu est disponible en anglais seulement) La Silicon Valley, Londres et la région du delta d’Amsterdam se sont classées, dans cet ordre, parmi les trois principales ruches mondiales en matière de technologie propre.
Dans le numéro de cette semaine : Le président du sommet sur le climat revient sur ses commentaires controversés à propos des combustibles fossiles, « tripler » est le nouveau terme en vogue à la COP, et la raison pour laquelle il faut accentuer les efforts de financement de la nouvelle économie de l’énergie.
Le président de la COP28 subit les contrecoups de ses commentaires sur « l’inexistence de données scientifiques ». Sultan Al Jaber, président de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) de cette année, tenue à Dubaï, a dû défendre l’engagement pris par son pays au sujet des changements climatiques, puisqu’il aurait ouvertement affirmé douter du lien entre les combustibles fossiles et le réchauffement de la planète lors d’une rencontre tenue avant la Conférence des parties (COP). Il a soutenu que ses commentaires avaient été pris « hors contexte », mais la situation a ravivé les critiques de l’hôte, dont celles du Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) Les Émirats arabes unis (EAU) figurent parmi les pays les plus susceptibles de perdre la moitié de leurs revenus en cas d’effondrement de la demande de combustibles fossiles, selon Carbon Tracker (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement)
Soumises à des pressions, les sociétés pétrolières s’engagent à décarboner leurs activités d’ici 2050. Cinquante sociétés pétrolières, dont 29 sociétés d’État telles que Saudi Aramco (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), se sont engagées à décarboner leurs activités d’ici 2050 et à rendre pratiquement nulles les émissions de méthane en amont d’ici 2030. Cette décision a été prise alors que les négociateurs de la COP envisagent d’exiger une élimination progressive formelle des combustibles fossiles dans le cadre d’une entente définitive. Al Gore, ancien vice-président américain (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), dit ne pas croire à l’engagement des grandes sociétés pétrolières : « Elles parviennent beaucoup plus aisément à capter l’intérêt des politiciens qu’à capter les émissions de carbone ». Les critiques s’inquiètent aussi du nombre croissant de lobbyistes des combustibles fossiles (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) présents à l’événement de cette année.
Certains parlent d’un projet de règlement « avant-gardiste » sur le méthane. Le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault, en compagnie de John Kerry (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), envoyé spécial des États-Unis pour le climat au sommet de la COP28 à Dubaï, a annoncé un nouveau projet de règlement sur le méthane. Ce projet établit une cible de réduction des émissions de méthane provenant du secteur pétrolier et gazier d’au moins 75 % par rapport aux niveaux de 2012, et ce, d’ici 2030. Au Canada, les dissensions se font déjà entendre, puisque l’Alberta (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) a juré de contester les mesures « coûteuses, dangereuses et anticonstitutionnelles ».
Un professeur originaire de l’Île-du-Prince-Édouard gagne un prix sur le climat à la COP28. Lucas Olscamp, professeur au Collège Pearson UWC de l’île de Vancouver, a gagné le concours Burjeel Holdings-Oxford Saïd Climate Change Challenge (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), à Dubaï, pour ses travaux sur l’intégration des croyances autochtones dans son cours. M. Olscamp était le seul finaliste canadien parmi les 600 candidatures. Portant sur le narratif écologique, l’individualisme et la réflexion, son cours est offert depuis deux ans dans le cadre du diplôme de leadership en matière d’action climatique de son établissement.
TECHNOLOGIES PROPRES
Moment décisif pour l’énergie nucléaire
L’Ontario doit éprouver une fierté sans borne. Plus tôt cette année, la province a lancé la plus grande expansion du secteur de l’énergie nucléaire au Canada pour doubler la capacité de Bruce Power, déjà le plus vaste réacteur nucléaire au monde. Elle envisage aussi la construction d’une nouvelle centrale nucléaire de 17 800 mégawatts, soit à peu près l’équivalant de la construction d’une autre centrale nucléaire comme celle de Bruce, de deux centrales semblables à celle de Darlington et d’une autre équivalente à celle de Pickering. Elle étudie aussi l’éventuel emploi de trois réacteurs modulaires plus petits.
Des mois plus tard, jusqu’à 22 pays, dont le Canada et les États-Unis, se sont engagés à tripler leur capacité nucléaire (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) à la COP28 cette semaine.
L’énergie nucléaire, longtemps dénigrée, semble se forger une nouvelle notoriété. Point focal de la haine des groupes environnementaux depuis longtemps, cette source d’énergie, qui produit peu d’émissions de carbone et qui fait ses preuves depuis des décennies en tant qu’énergie de base pouvant être acheminée proprement, fait désormais fermement partie des plans climatiques de la plupart des pays. L’avantage qu’offre l’énergie nucléaire sur le plan de la sécurité la rend aussi irrésistible pour certains en ces temps où la géopolitique joue un rôle prédominant.
Accentuation De L’énergie Nucléaire
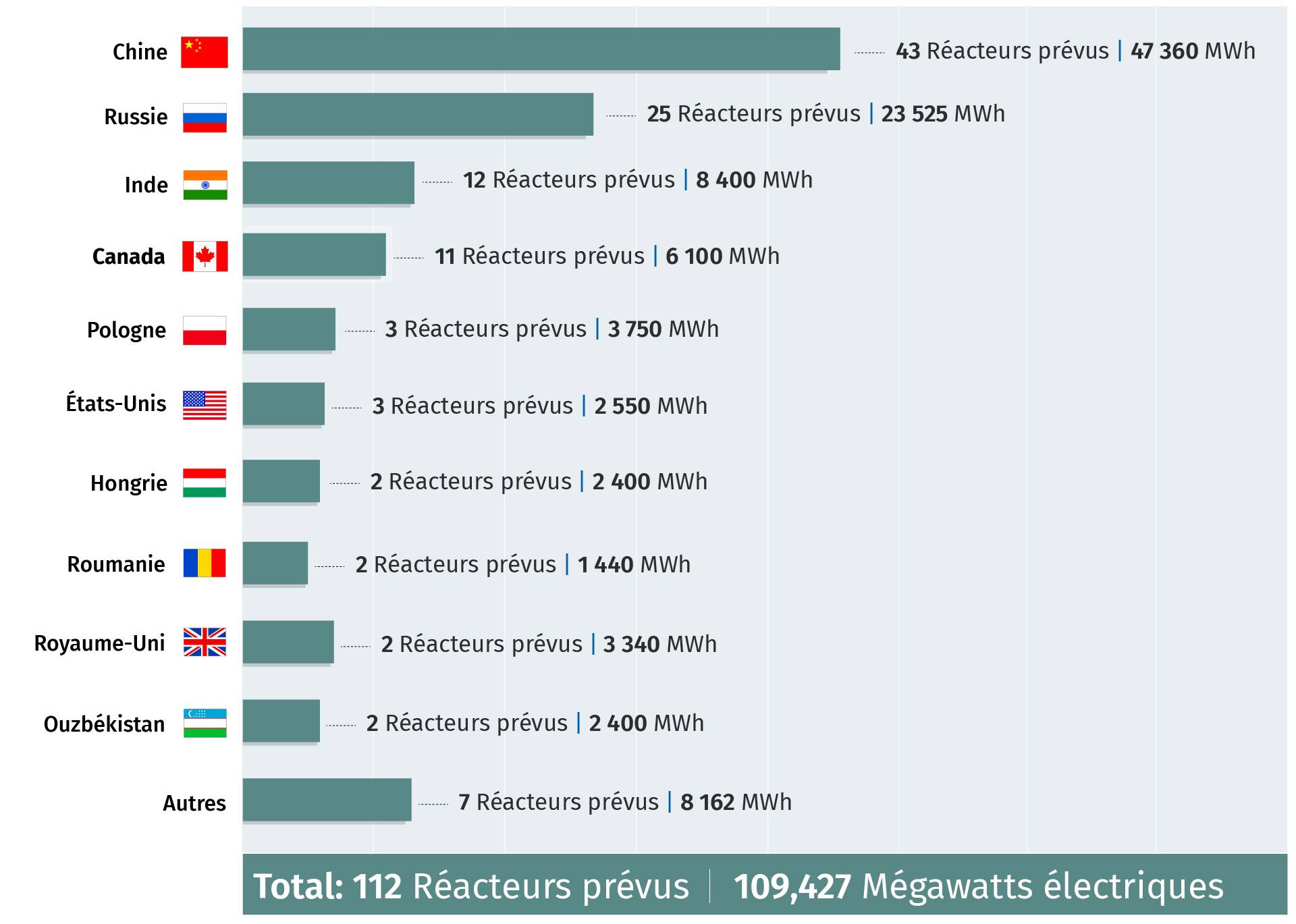
Source : World Nuclear Association.
Actuellement, environ 10 % de l’énergie électrique mondiale est produite à l’aide de l’énergie nucléaire. Soixante réacteurs sont en cours de construction, et 110 autres sont prévus. Trente pays, dont le Bangladesh, l’Égypte et la Turquie, envisagent de recourir à l’énergie nucléaire pour la première fois, allongeant ainsi la liste des 33 pays exploitant déjà ce type d’énergie.
Pour le Canada, il s’agit d’une occasion d’étendre son avance et d’exploiter sa technologie à l’échelle internationale. Les crédits d’impôt fédéral à l’investissement de 15 % pour la construction de réseaux électriques sans émission pourraient aussi donner un élan indispensable à cette source d’énergie.
Le secteur a toutefois des défis à relever au Canada et ailleurs dans le monde. Par le passé, un seul accident d’envergure (Fukushima, Three Mile Island) a fait reculer le secteur de plusieurs décennies, et ce, malgré tous les efforts déployés pour rehausser les normes de sécurité.
L’Agence internationale de l’énergie atomique (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) soutient que le financement, les considérations économiques et la complexité de la chaîne logistique, comme l’approvisionnement en uranium, demeurent des problèmes persistants, qu’ils pourraient entraver la croissance du secteur, et qu’il y a encore fort à faire pour déployer en toute sécurité de petits réacteurs modulaires. Le secteur estime qu’il peut relever ces défis. Il lutte contre les perceptions du public depuis des années, et la résolution de problèmes technologiques est sa spécialité.
TABLEAU DE LA SEMAINE
Jusqu’à 118 pays, dont le Canada et les États-Unis, se sont engagés à tripler leurs capacités en matière d’énergies renouvelables d’ici 2030 et à doubler leur efficacité énergétique pour se débarrasser des « combustibles fossiles sans mesures d’atténuation (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) » Cet engagement manque toutefois de vigueur, puisque la Chine et l’Inde, deux des pays consommant le plus d’énergie produite à partir de combustibles fossiles, ne font pas partie des signataires.
Accentuation Des Énergies Renouvelables
(térawatts heures)
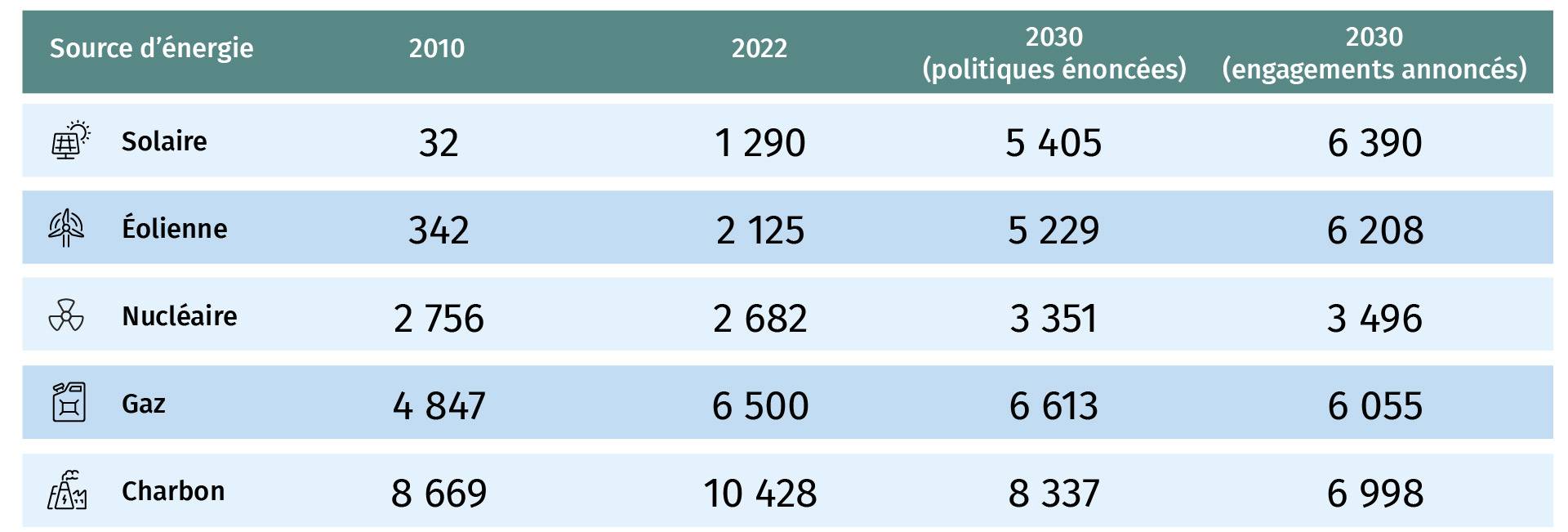
Source : Perspectives énergétiques mondiales 2023 de l’Agence internationale de l’énergie
EN VEDETTE
Huit fois
La hausse estimée des émissions de dioxyde de carbone à l’échelle mondiale en raison de la saison des feux de forêt extrêmes au Canada, selon le Global Carbon Budget. (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) Les émissions de 8 milliards de tonnes provenant de ces incendies correspondent environ à 70 % des émissions produites par la Chine à partir de combustibles fossiles.
Dans l’édition de cette semaine : Au moment où s’ouvre le sommet sur le climat des Nations Unies de cette année, le président de la COP28, Sultan Al Jaber, s’affiche comme un homme plein de contradictions ; l’Alberta s’oppose au Règlement sur l’électricité propre proposé par Ottawa ; et de nos jours, il est compliqué d’être un investisseur dans les technologies propres.
La COP28 a vu une avancée dès le premier le jour. Les Émirats arabes unis – hôtes de la conférence – et l’Allemagne se sont engagés à verser 100 millions de dollars américains chacun dans un nouveau fonds « pertes et dommages » de 429 millions de dollars destiné à aider les pays en développement à faire face aux répercussions des changements climatiques. Ce geste est perçu comme une première victoire pour la conférence annuelle des Nations Unies sur le climat qui a lieu cette année à Dubaï. Le Royaume-Uni participe à hauteur de 75 millions de dollars, mais les États-Unis ont été montrés du doigt pour leur contribution « embarrassante » de 17,5 millions de dollars.
Le Canada a un vaste programme pour la COP. Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement climatique, a une longue liste de thèmes à aborder lors de la conférence sur le climat : l’objectif de financement climatique de 100 milliards de dollars, l’élimination progressive du charbon dans le monde, l’engagement mondial sur le méthane, et le Défi mondial sur la tarification du carbone présenté par le Canada.
Manger moins de steaks pour sauver la planète. La diminution de la consommation de viande et l’augmentation de la productivité de l’élevage figurent parmi les recommandations dévoilées par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture à la COP28, dans le cadre d’un plan zéro émission nette pour les systèmes alimentaires. Afin de montrer l’exemple, deux tiers des repas du sommet de Dubaï seront d’origine végétale.
De nos jours, il est compliqué d’être un investisseur dans les technologies propres. L’indice U.S. S&P Global Clean Energy, qui regroupe les 100 plus grandes sociétés d’énergie propre, a plongé de 30 % depuis le début de l’année, comparativement à un déclin de 1 % pour l’indice S&P 500 Energy largement pondéré en combustibles fossiles. L’annulation d’importants projets d’énergie renouvelable aux États-Unis en raison des taux et des coûts plus élevés a entraîné une liquidation massive. Compte tenu de la vague d’investissements dans les énergies renouvelables, les investisseurs ont-ils une vision trop courte ?

SOMMET SUR LE CLIMAT
Nous vous présentons M. COP28
Sultan Al Jaber est un homme de contradictions. En tant que chef de la direction de la société Abu Dhabi National Oil Company (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), il a conclu des plans d’investissement de 150 milliards de dollars sur cinq ans pour accroître la production de pétrole et de gaz aux Émirats arabes unis. Et en tant que président du sommet COP28 qui a commencé cette semaine à Dubaï, Sultan Al Jaber dirige la lutte mondiale contre les changements climatiques – au moins pour cette année. Selon certains rapports, (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) le pays hôte était en train de mettre en place un fonds d’investissement climatique de 30 milliards de dollars américains avec BlackRock, TPG et Brookfield à la veille du sommet. Sultan Al Jaber s’intéresse au thème du « progrès transformationnel » qui sera abordé à l’occasion du sommet, car il estime que la sortie progressive des combustibles fossiles est « inévitable ». D’un autre côté, plusieurs rapports suggèrent que les EAU comptent mettre à profit leur rôle d’hôtes du sommet sur le climat des Nations Unies pour conclure des accords pétroliers et gaziers, notamment avec le Canada (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) Sultan Al Jaber a nié ces informations. Rien que l’année dernière, ADNOC a investi dans des projets de captage du carbone et de captage direct dans l’air, mais la société a aussi expédié du GNL vers l’Allemagne (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) pour la toute première fois, ce qui a ouvert un nouveau flux de revenus issus des combustibles fossiles.
Beaucoup de contradictions, en effet. Ou est-ce que les dirigeants du secteur de l’énergie doivent garder deux idées contradictoires en tête pour résoudre un défi extrêmement complexe ?
Bien que ADNOC ait prospéré dans le secteur du pétrole, le bilan de Sultan Al Jaber dans le domaine de l’énergie renouvelable n’est pas aussi enviable. Son projet de construction de Masdar City, une nouvelle ville à faibles émissions de carbone aux abords de la capitale Abu Dhabi, en 2008, n’a guère avancé (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) malgré les 15 milliards de dollars injectés par le gouvernement dans ce projet.
Les observateurs de l’action climatique se sont opposés à sa présidence. Ainsi, 400 groupes climatiques et environnementaux ont écrit aux Nations unies plus tôt cette année pour « expulser les grands pollueurs », dans la crainte que les principaux pays exportateurs de pétrole entravent le progrès en matière de climat. Parmi les sociétés pétrolières et gazières, ADNOC est l’un des plus grands émetteurs (ce contenu est disponible en anglais seulement) de gaz à effet de serre au monde, et la société a un intérêt pour freiner la réglementation sur le captage ainsi que les politiques entraînant un déclin de la demande internationale de pétrole et de gaz.
Bien que tout cela soit vrai, la politique climatique est compliquée. Les EAU sont un représentant de la coalition des économies émergentes appelées le « Sud mondial », qui sont le moteur de la croissance mondiale. À ce titre, ils souhaitent que les politiques climatiques soient encadrées de manière à ne pas affecter leurs perspectives de croissance. Les Émirats arabes unis et d’autres grands exportateurs comme l’Arabie saoudite ont des politiques climatiques semblables à celles des principaux consommateurs d’énergie que sont la Chine, l’Inde et la Corée du Sud. Ensemble, ils forment un groupe d’influence puissant à la COP28. Sultan Al Jaber est leur porte-parole cette année.
GRAPHIQUE DE LA SEMAINE
La Conférence annuelle des Nations Unies sur les changements climatiques, ou COP, attire de plus en plus de participants. Nous y voyons à présent des diplomates, scientifiques, environnementalistes, lobbyistes, dirigeants et médias côtoyer des présidents, premiers ministres et chefs d’État. L’évènement qui se déroule à Dubaï jusqu’au 12 décembre devrait être la plus grande concentration d’intervenants du climat à ce jour, compte tenu de l’urgence de la crise.
Pic de la nouvelle conférence sur le climat
Le nombre de participants à la COP28 pourrait battre un nouveau record
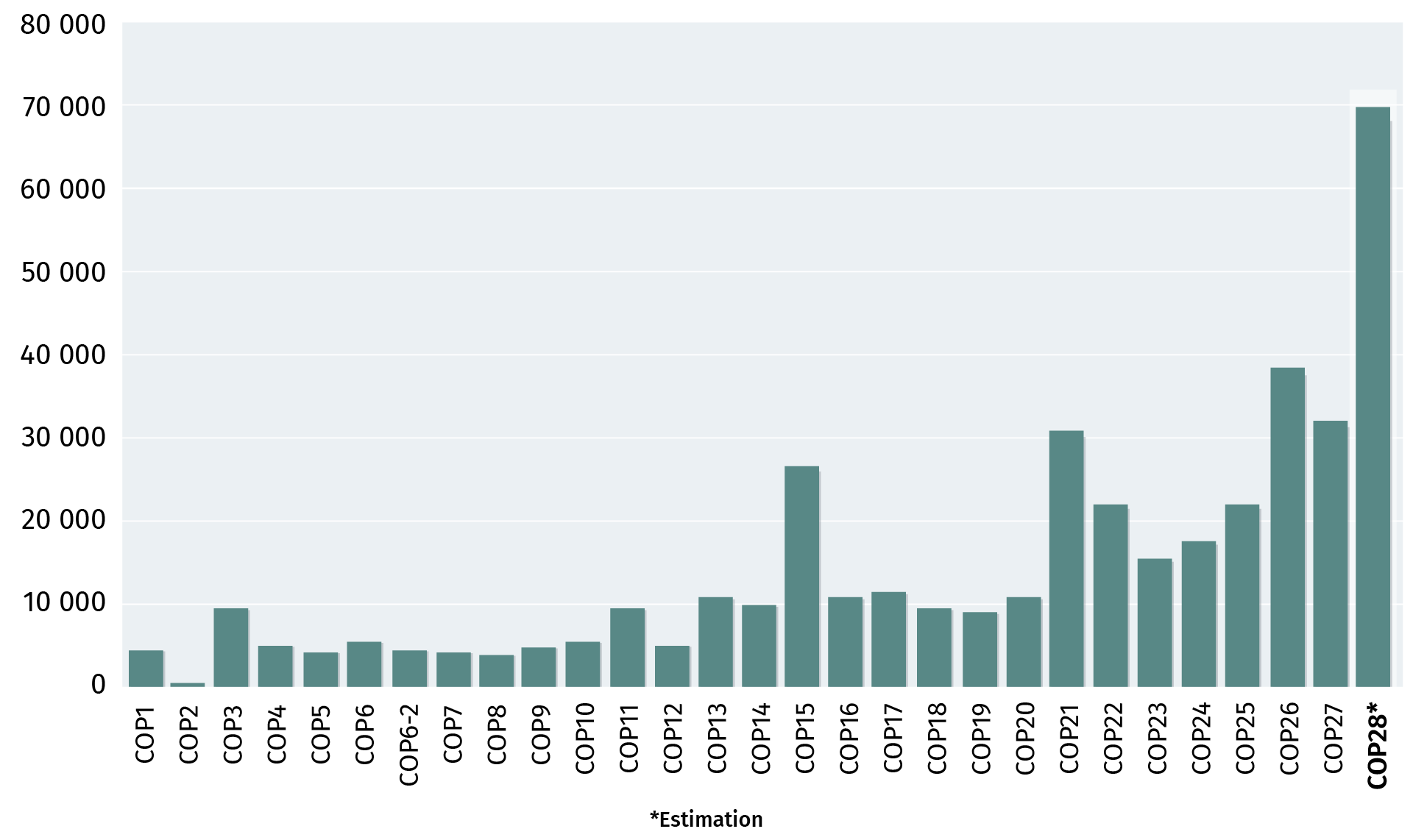
Source : Carbon Brief
POLITIQUE CANADIENNE
Le Règlement sur l’électricité propre est en train de s’embourber
L’Alberta appuie sur le frein. En invoquant la loi sur la souveraineté, le gouvernement de Danielle Smith conteste le projet de Règlement sur l’électricité propre préparé par le gouvernement fédéral. Ce projet vise à réduire les émissions issues de l’électricité à partir de 2035, ce qui laisse peu de temps à l’égard du gaz naturel du réseau. L’Alberta affirme que l’échéance ne convient pas, du fait que la province vient à peine de mener sa transition du charbon vers le gaz naturel, et que le bond vers les énergies renouvelables risque fortement de pousser les prix vers le haut ou de nuire à la fiabilité du réseau.
Réseau d’électricité au gaz de l’Alberta
Distribution de l’électricité produite en Alberta par source
La province réfléchit également à la création d’une société d’État, qui pourrait exploiter les sites de production de gaz naturel sans avoir à se soucier des règlements fédéraux.
Source : Statista
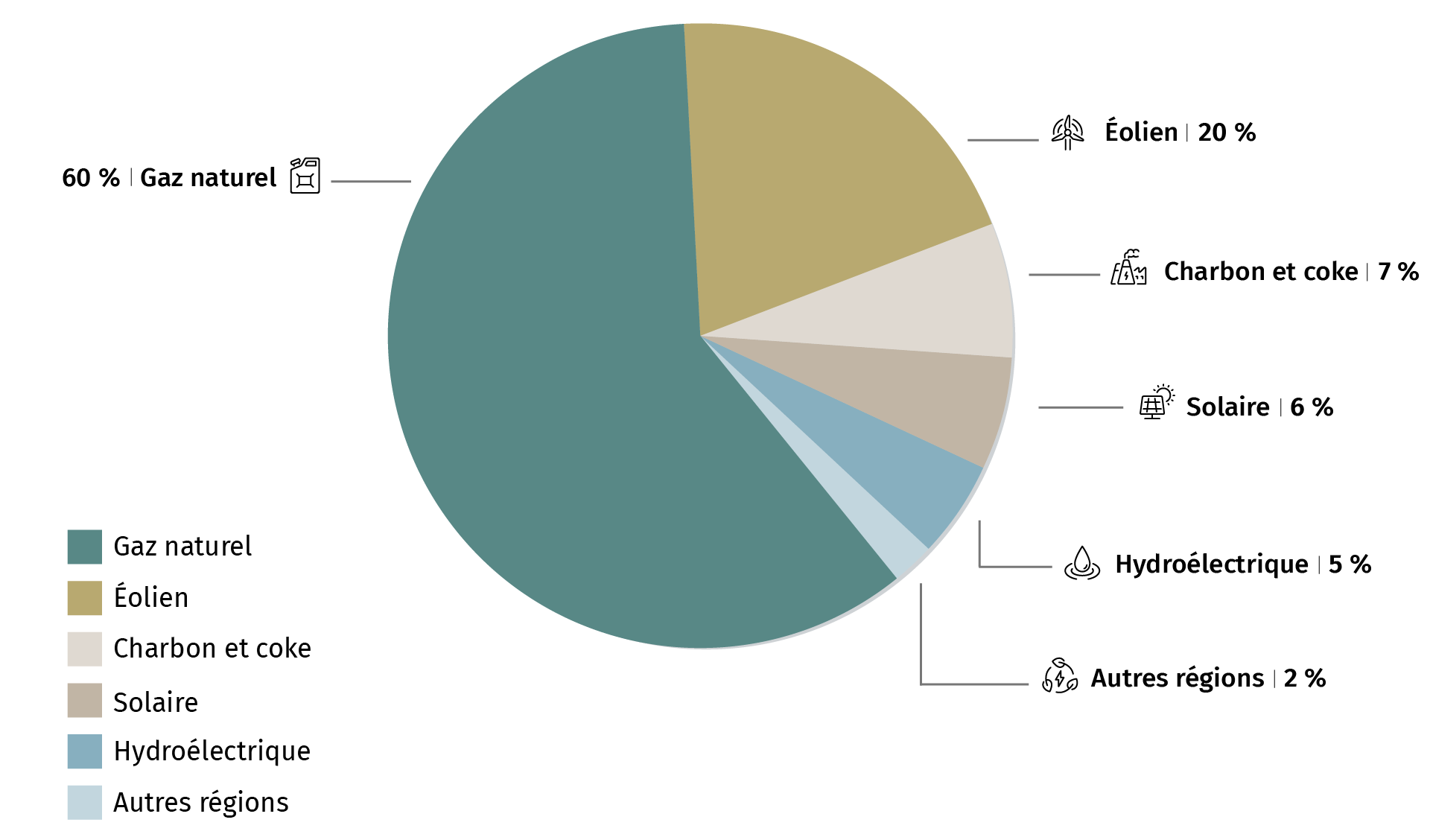
Source:
Ottawa a récemment rencontré une certaine résistance face à ses politiques climatiques. Au cours des derniers mois, le gouvernement fédéral a annoncé une exonération de la taxe carbone sur le mazout de chauffage dans les provinces de l’Atlantique, tandis que ce mois-ci, une cour fédérale a rejeté l’interdiction du plastique à usage unique (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) proposée par Ottawa. Une récente décision de la Cour suprême a limité l’influence du gouvernement fédéral sur les projets liés aux ressources, mais ce n’est pas tout à fait le renversement que les opposants espéraient. Bien que cette décision soit considérée comme un obstacle aux politiques fédérales en matière de climat, elle relève surtout d’allers et retours dans la négociation des politiques.
Sur d’autres fronts, nous voyons des signes de progrès dans la réduction des émissions. Pathways Alliance en est un bon exemple. Selon un consortium composé des six plus grands producteurs canadiens de sables bitumineux, des travaux d’ingénierie sont en cours relativement à un projet de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CUSC) dans le nord-est de l’Alberta, avec une date de lancement potentielle en 2030. Le gouvernement de l’Alberta a contribué à cette tendance cette semaine, fournissant jusqu’à 12 % des nouveaux coûts de projet d’investissement admissibles à l’aide du crédit d’impôt à l’investissement fédéral lié au CUSC. Il est crucial que les crédits fédéraux s’appliquent rétroactivement à compter du début de 2022 aux sociétés ayant engagé des dépenses admissibles au titre du CUSC. Le progrès du Canada en matière de climat n’est peut-être pas linéaire, mais il ne déraille pas.
EN VEDETTE
43 %
Réduction des émissions nécessaire d’ici 2030 par rapport au niveau de 2019 pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 o Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de l’ONU. L’un des éléments clés de l’agenda de la COP28 est le « bilan mondial » qui évalue les progrès réalisés par chaque pays dans la réduction des émissions.
Dans l’édition de cette semaine : Ce qui figure sur la liste de souhaits des libéraux fédéraux pour Noël, cinq thèmes à surveiller lors de la COP28, et les raisons pour lesquelles même Taylor Swift ne peut échapper aux ravages du changement climatique.
La place du climat dans la mise à jour économique
Par John Stackhouse
Quiconque entretenait des doutes sur la place qu’occupe désormais le climat dans la liste de souhaits de Noël du gouvernement Trudeau est invité à prendre connaissance de l’Énoncé économique de l’automne de Chrystia Freeland. Elle a présenté la stratégie économique annuelle du gouvernement sans mentionner ne serait-ce qu’une seule fois les termes « changement climatique » ou « environnement ». (On pourrait faire un jeu de mots en évoquant la populaire chanson de Noël intitulée « All I Want For Christmas Is You » et prétendre que la ministre Freeland en aimerait une version intitulée « All I Want For Christmas Is Two » tant elle semble rêver à un taux d’inflation de 2 %.) Il se pourrait fort bien qu’une attention si étroitement mise sur le consommateur représente une mauvaise nouvelle pour son caucus vert. Cependant, l’attention renouvelée de Mme Freeland envers l’exécution pourrait être la bienvenue. Dans la stratégie de son gouvernement relativement à une « économie propre » – formule retenue par Ottawa pour évoquer le climat –, elle précise un certain nombre de choses.
En premier lieu, le nouveau Fonds de croissance du Canada consacrera près de la moitié de son budget de 15 milliards de dollars à des « contrats sur différence » – lesquels représentent en quelque sorte des garanties sur le prix du carbone dans l’éventualité où la politique du gouvernement changerait. Si cela représente indiscutablement une somme d’argent considérable, ce montant pourrait ne pas être suffisant pour garantir une économie propre. En deuxième lieu, le gouvernement présentera bientôt des dispositions législatives créant des crédits d’impôt à l’investissement pour des projets de captage du carbone et de technologies propres, lesquels ont été promis il y a un an mais n’ont jamais été menés à bien. Ils s’avéreront essentiels pour les projets de décarbonation, et certains s’inquiètent du fait qu’ils demeurent toujours non concurrentiels avec les mesures incitatives américaines. Ottawa ira également de l’avant avec son programme en matière d’hydrogène en promettant des allègements fiscaux pour l’ammoniac et en consentant davantage de mesures incitatives pour les déchets de biomasse (sous forme de copeaux de bois et de résidus de culture) qui pourraient être utilisés dans le carburant d’aviation durable. Pour attirer davantage de capitaux, Mme Freeland a donné le feu vert à une « taxonomie » qui vise à aider les banques et les caisses de retraite à qualifier les investissements de « verts » ou de « transition ». De surcroît, elle incitera les caisses de retraite à investir davantage dans l’« économie propre » du Canada.
De quelle manière une taxonomie traitera le gaz naturel soulèvera la controverse, au même titre qu’une autre proposition de Mme Freeland sous forme d’un programme national de garantie de prêts pour les Autochtones. Ottawa limitera-t-il ce que les communautés autochtones peuvent acheter en fonction de leur impact climatique ? Un groupe de 130 nations autochtones n’a pas tardé à manifester son désaccord complet. Après des siècles de colonisation, ces nations n’hésiteront certainement pas à choisir leurs propres projets, y compris ceux qui concernent le gaz naturel. Ces débats domineront la session d’hiver, alors que les libéraux du premier ministre Justin Trudeau s’emploieront à démontrer qu’ils peuvent gérer l’économie actuelle et contribuer à en construire une nouvelle.
La facture en matière d’investissement énergétique d’Hydro-Québec atteindra les 185 milliards de dollars d’ici 2035. Si ce chiffre est quatre fois plus élevé que le budget annuel moyen des cinq dernières années de ce service public provincial (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), l’entreprise s’est engagée à maintenir les tarifs d’électricité à un niveau abordable. Le service public prévoit qu’il devra produire d’ici 2050 deux fois plus d’électricité qu’il n’en produit actuellement – soit 150 à 200 TWh de plus – pour subvenir aux besoins des foyers ainsi que du secteur industriel et des technologies propres en pleine croissance de la province.
L’article 6.4 pourrait être adopté d’ici 2024. C’est en effet ce qu’estime le président de l’organisme de surveillance (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) des Nations Unies auquel incombe la responsabilité de fixer les règles qui permettraient à une entreprise, par exemple un exportateur de GNL au Canada, de réduire ses émissions au niveau national pour ensuite les faire créditer et parvenir à les vendre à une entreprise différente dans un autre pays. Après deux années de négociations « tendues », l’organisme est parvenu à un accord qui sera passé en revue par les négociateurs nationaux lors de la COP28.
L’Ontario aide la Saskatchewan à s’intéresser aux petits réacteurs modulaires. Profitant de l’expérience acquise auprès de l’organisme Ontario Power Generation, la société Laurentis Energy Partners et SaskPower travailleront de concert pour appuyer les processus d’autorisation de projets et de gestion du programme nucléaire du service public provincial. SaskPower s’est fixé pour objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 50 % par rapport à ses niveaux de 2005 d’ici 2030.
Personne n’est à l’abri du changement climatique – pas même Taylor Swift. La dynamo tant de la musique pop que de l’économie (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) a reporté le volet brésilien de sa tournée Eras après que le décès d’un adepte de 20 ans survenu lors de son concert eut été relié à la vague de chaleur extrême qui a frappé Rio de Janeiro. Des milliers de villes brésiliennes sont sous le coup de vagues de chaleur « insupportables » (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) Cet événement a résonné comme un coup de tonnerre pour le secteur des événements extérieurs, qui représente plusieurs milliards de dollars.
POLITIQUE CLIMATIQUE
Cinq thèmes à surveiller lors de la COP28
La COP28 espère donner le ton pour lutter contre le changement climatique au cours de cette décennie. Règne cependant un certain pessimisme quant à la capacité des Émirats arabes unis, pays hôte qui est également un important producteur de pétrole, à rassembler environ 200 pays autour d’au moins certains des défis liés au changement climatique. Depuis fort longtemps déjà, les Émirats arabes unis jouent dans la cour des grands, en plus de caresser l’ambition intéressée de tenir un sommet qui soit aussi mémorable que le fut celui de Paris en 2015.
L’événement, qui se tiendra à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre, abordera pratiquement tous les sujets climatiques. Cependant, les cinq thèmes suivants méritent une attention particulière car ils pourraient jouer un rôle déterminant dans la lutte contre les émissions.
Réduction des émissions de méthane: L’engagement sino-américain conclu plus tôt ce mois-ci (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) envers la réduction des émissions de méthane est perçu comme représentant une étape majeure au vu de la nocivité de ce polluant. S’appuyant sur leur approche étonnamment collaborative sur la question du climat, les États-Unis et la Chine prévoient organiser dans le cadre de la COP une réunion portant sur les émissions de méthane et d’autres gaz à effet de serre. Un certain nombre de pays, au rang desquels figure le Canada, ont signé l’engagement mondial sur le méthane, qui vise à réduire les émissions de méthane d’au moins 30 % par rapport aux niveaux de 2020 d’ici 2030. Cependant, les pays non signataires de l’engagement offrent un potentiel de réduction de 46 % des émissions (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) On devrait s’attendre à ce que ces pays subissent des pressions pour les enjoindre à apposer leur signature à l’engagement.
Lutter contre la menace du méthane
Pays dont l’empreinte méthane est la plus importante
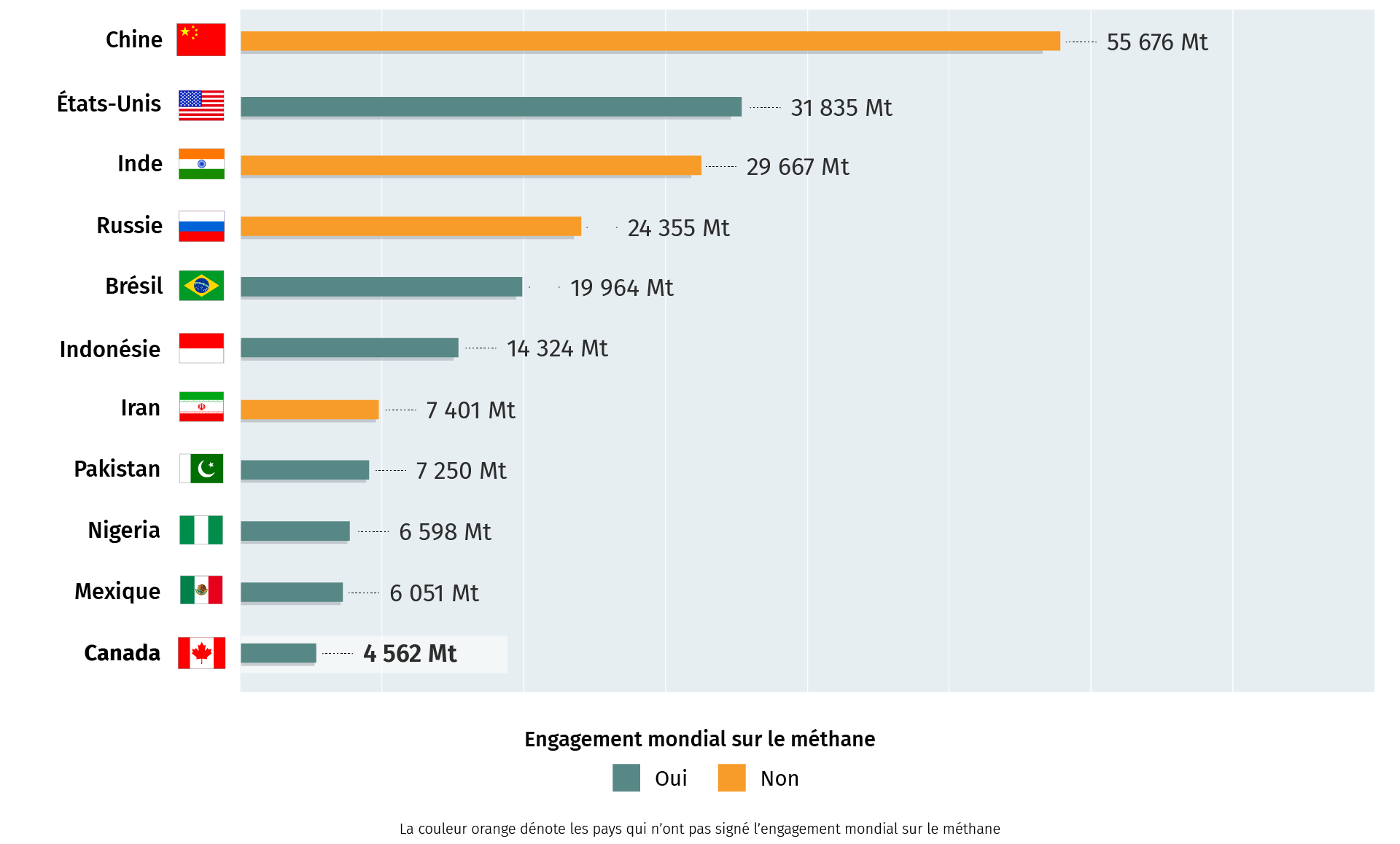
Source : Agence internationale de l’énergie
Multiplication par trois des énergies renouvelables : Les États-Unis et l’Europe (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) souhaitent tripler la capacité des sources d’énergie renouvelable et doubler les économies d’énergie d’ici la fin de la décennie. Considéré comme un facteur clé de l’approbation, la Chine s’est engagée à développer les énergies renouvelables aux côtés des États-Unis durant leur sommet, décision qui pourrait stimuler un développement additionnel. Fait curieux, ce même engagement pourrait conduire à une dépendance continue à l’égard des chaînes d’approvisionnement chinoises en matière de technologies propres.
Retour du nucléaire : Il y a lieu de s’attendre à ce que les États-Unis mènent une campagne visant à multiplier par trois la capacité nucléaire installée à travers le monde d’ici 2050. Cela représenterait un revirement important pour une industrie qui a subi les foudres des militants du climat. Le Canada, qui poursuit activement quelques projets de réacteurs nucléaires et de petits réacteurs modulaires, pourrait jouer un rôle dans l’expansion mondiale de l’industrie.
Fonds pour faire face aux pertes et dommages : On s’attend à ce que la finance représente l’un des sujets de débat les plus chauds et qui suscitera le plus de passion lors de l’événement. En effet, l’Union européenne (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) s’est engagée à apporter une contribution « substantielle » au fonds destiné à faire face aux pertes et dommages qui vise à fournir une aide financière aux pays les plus durement touchés par le changement climatique. Cependant, il sera difficile de convaincre les autres pays au vu des pressions budgétaires qui pèsent sur la plupart des économies. On s’attend des Émirats arabes unis à ce qu’ils apportent une contribution significative qui pourrait aider le fonds à se concrétiser.
L’agriculture sous les feux de la rampe : Le secteur sera sous les feux de la rampe lors de la COP alors que le monde en vient, tardivement, à établir un lien entre l’alimentation et le climat. La sécurité alimentaire mondiale se trouve en effet menacée alors que le nombre de catastrophes touchant les systèmes agroalimentaires a quadruplé au cours des 20 dernières années, estiment les Nations Unies (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) Des pressions se manifestent envers la signature d’une Déclaration des dirigeants sur les systèmes alimentaires, l’agriculture et l’action climatique, l’objectif étant d’intégrer les systèmes alimentaires et l’agriculture aux ordres du jour climatiques nationaux. L’accent que met la COP sur le méthane s’intègre bien avec l’enjeu de l’agriculture puisqu’elle représente la principale source d’émissions anthropiques de méthane.
TABLEAU DE LA SEMAINE
Contrarié par la taxe sur le carbone
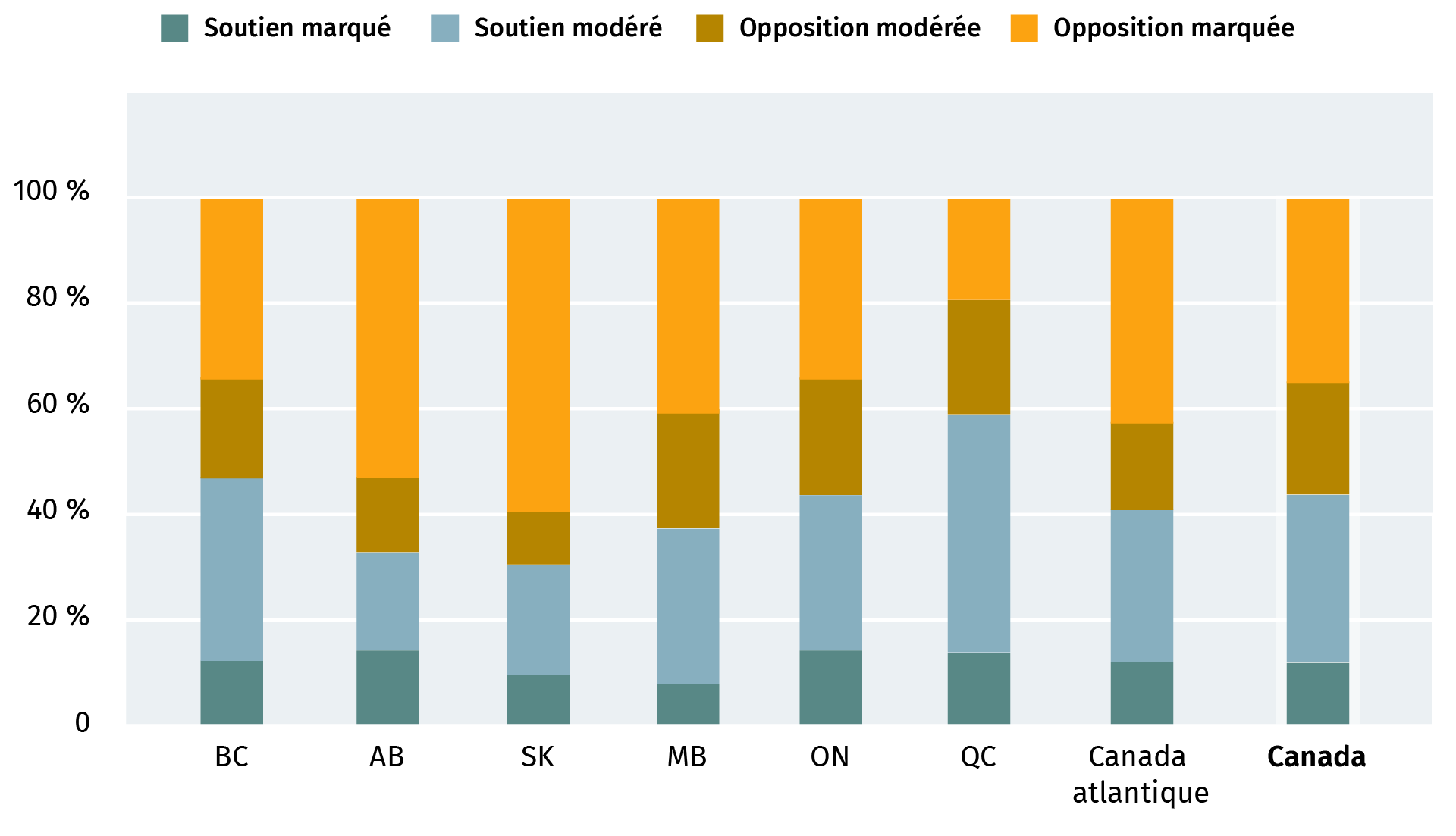
Source : Angus Reid Institute
Un nouveau sondage révèle un profond manque de sensibilisation ainsi que l’existence d’idées fausses quant au montant de la taxe sur le carbone que croient payer les Canadiens, le fait qu’ils reçoivent ou non un rabais et ses avantages financiers nets pour les ménages. Pendant ce temps, la crise actuelle du coût de la vie et le scepticisme à l’égard du rôle de la tarification du carbone dans la lutte contre le changement climatique amènent 42 % des Canadiens à demander l’abolition de la taxe, selon un sondage mené par l’Angus Reid Institute (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) Ce sondage fait écho à un récent sondage européen (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) qui laisse poindre une lassitude face au climat malgré la profonde conviction que le changement climatique constitue une menace pour l’économie du continent.
35 millions
Il s’agit du nombre de personnes qui travaillent dans le secteur des sources d’énergie à faibles émissions de carbone, par rapport aux 32 millions qui ont travaillé dans le secteur des hydrocarbures en 2022, selon l’Agence internationale de l’énergie (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) L’emploi dans le secteur de l’énergie a progressé de 5 % (par rapport à 2019) comparativement à la croissance mondiale de l’emploi de 1 %. Cette croissance est principalement provenue de l’énergie solaire photovoltaïque, de l’énergie éolienne, de la fabrication de véhicules électriques et de batteries, des pompes à chaleur et de l’exploitation minière des minéraux critiques.
Dans l’édition de cette semaine : Pourquoi la formule « sans dispositif d’atténuation » sera à la mode lors de la COP28, la diplomatie climatique de l’Australie éclipse la Chine et l’ambition des États-Unis en matière de petit réacteur modulaire subit un coup dur
Les États-Unis et la Chine unissent leurs forces en matière de climat. Les deux plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde ont convenu de tripler leur capacité d’énergie renouvelable afin d’« accélérer la substitution à la production à base de charbon, de pétrole et de gaz », alors que les deux puissances s’emploient à rétablir leurs relations glaciales. Le plan en 25 points (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) vise également à réduire les émissions de méthane, à faire progresser les projets de capture de carbone ainsi qu’à mettre fin à la disparition des forêts et à inverser le phénomène d’ici 2030.
La première installation de capture directe du dioxyde de carbone des États-Unis présente un lien avec le Canada. La jeune entreprise américaine Heirloom Carbon Technologies (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) a dévoilé une installation commerciale capable d’éliminer et de stocker 1 000 tonnes de dioxyde de carbone, ce qui représente un début certes limité, mais néanmoins révolutionnaire. L’entreprise déploie la technologie de béton jeune de CarbonCure Technologies, société basée à Halifax, pour stocker en permanence le CO2 atmosphérique capturé dans les matériaux de construction.
La diplomatie climatique aide l’Australie à contrecarrer l’influence chinoise dans le Pacifique. En vertu d’une garantie de sécurité climatique offerte à ce pays isolé qui se présente sous la forme d’un atoll et qui est menacé par la hausse du niveau de la mer, l’Australie offrira, tous les ans, la résidence permanente (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) à 280 citoyens de Tuvalu. Le traité confère à l’Australie la possibilité de bloquer tout rapprochement en matière de services de police conclu entre la Chine et Tuvalu, au même titre que toute entente dans le domaine des télécommunications, de l’énergie ou des ports.
L’industrie estime qu’un accord européen historique sur la déforestation entraînerait une hausse du prix des denrées alimentaires. La nouvelle loi (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) en vertu de laquelle les entreprises alimentaires sont tenues de démontrer que leurs biens ne sont pas produits sur des terres récemment déboisées entrera en vigueur d’ici la fin de 2024. Les économies émergentes affirment par ailleurs que la nouvelle loi est « incompatible avec les obligations de l’OMC ». Parmi les produits dont on s’attend à ce qu’ils soient touchés figurent l’huile de palme, le café, le cacao, le bœuf et le caoutchouc.
POLITIQUE CLIMATIQUE
La formule floue de la COP28 qui pourrait avoir une incidence sur des milliards de dollars
Une formule floue, soit « sans dispositif d’atténuation », pourrait avoir une incidence sur des flux de milliards de dollars, voire y mettre un terme. En effet, la position de départ adoptée par l’Union européenne lors de la COP28 prévoit l’« élimination progressive à l’échelle mondiale des combustibles fossiles sans dispositif d’atténuation ». Le Canada (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) et les États-Unis (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) ont également adhéré à cette formule « sans dispositif d’atténuation » et ont engagé des pressions en faveur de la technologie de captage et de stockage de carbone (CSC), qui représente une option clé en matière de réduction du carbone.
Les Émirats arabes unis, qui seront l’hôte du sommet (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), ont appelé à la mise en place d’un « système énergétique exempt de combustibles fossiles sans dispositif d’atténuation au milieu de ce siècle », tandis que les producteurs de pétrole et de gaz que sont l’Arabie saoudite et la Russie, de même que les pays dépendants des combustibles fossiles tels que l’Inde et la Chine, sont en faveur d’une formulation plus vague.
Cette formule est riche de conséquences. En effet, l’emploi de la formule « sans dispositif d’atténuation » laisse entrevoir que l’accent soit mis sur les émissions plutôt que sur la production, des investissements importants dans les technologies naissantes de capture de carbone, voire un évincement des investissements dans les énergies renouvelables. Et cela pourrait conduire à davantage de forages pétroliers et gaziers induisant des émissions (qui seraient cependant captées).
Et, quoi qu’il en soit, que veut dire la formule « sans dispositif d’atténuation » ? Certains sont d’avis que pour être acceptable, la technologie de CSC doit séparer des niveaux élevés de dioxyde de carbone des émissions – préférablement à hauteur d’au moins 95 % – et présenter de faibles fuites de méthane ou d’émissions fugitives. Les compensations devraient-elles être exclues ? L’ensemble du cycle de vie des émissions devrait-il être couvert ? Et y aurait-il lieu d’adopter des lois pour garantir que le carbone capturé ne soit pas utilisé pour la récupération assistée des hydrocarbures ? Ces questions donneront lieu à des débats houleux lors de la COP28. Les réponses aideront à leur tour les entreprises à choisir entre le financement du CSC et l’adoption de l’électricité ou de l’hydrogène en guise de combustible.
La traque mondiale pour la capture du carbone
Croissance de la capacité de capture des projets de CSC en construction et en développement
(exclut la capacité en exploitation)
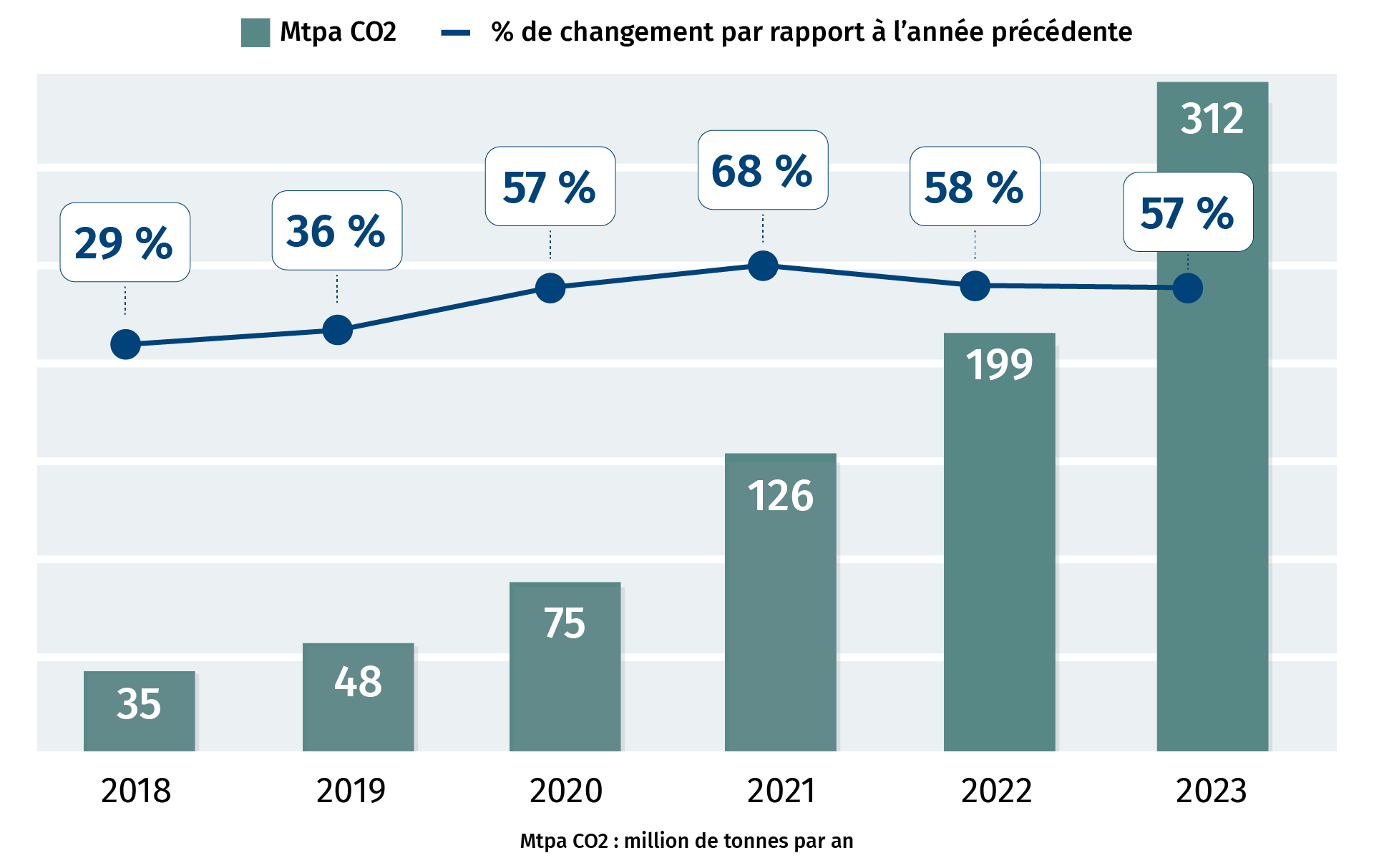
Source : Global CCS Institute
À défaut de règles empiriques mondiales claires ou de normes établissant ce que signifie véritablement la formule « sans dispositif d’atténuation », de nombreux investissements pourraient se retrouver bloqués, prévoit un rapport du Centre for Global Economic Policy (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement)
Des milliards de dollars sont sur le point d’être injectés en fonction de l’interprétation de la formule : en 2023, la capacité en matière de technologie de captage, d’utilisation et de stockage du carbone en cours de développement a bondi de 57 % à l’échelle annuelle pour atteindre 312 tonnes métriques (ce contenu est disponible en anglais seulement) McKinsey (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) estime que, pour atteindre les objectifs mondiaux en matière de décarbonation, l’industrie a besoin d’investissements annuels de 130 milliards de dollars US jusqu’en 2050.
Ce débat d’interprétation linguistique survient alors que le monde vacille quant à ses objectifs climatiques. Selon ce qu’estime un récent organisme scientifique des Nations Unies, d’ici 2030, on s’attend à ce que les émissions augmentent d’environ 9 % par rapport aux niveaux de 2010 sur la base des engagements climatiques actuels. Dans un rapport distinct des Nations Unies, on souligne que de nombreux objectifs à zéro émission nette qui demeurent incertains ou qui ont été repoussés doivent se concrétiser dès aujourd’hui pour que puissent être réduites les émissions et que soit « maintenue en vie la cible 1,5 degré Celsius », ce qui constitue une référence au maintien du réchauffement climatique aux niveaux convenus à Paris en 2015. Par ailleurs, le dernier rapport intitulé State of Climate Action 2023 du World Resources Institute (ce contenu est disponible en anglais seulement) est tapissé de qualificatifs tels que « non respecté » (qui apparaît 98 fois) et « insuffisant » (qui apparaît 66 fois).
TABLEAU DE LA SEMAINE
Aucune émission, ambitions élevées
Principaux projets de production d’hydrogène vert proposés au Canada
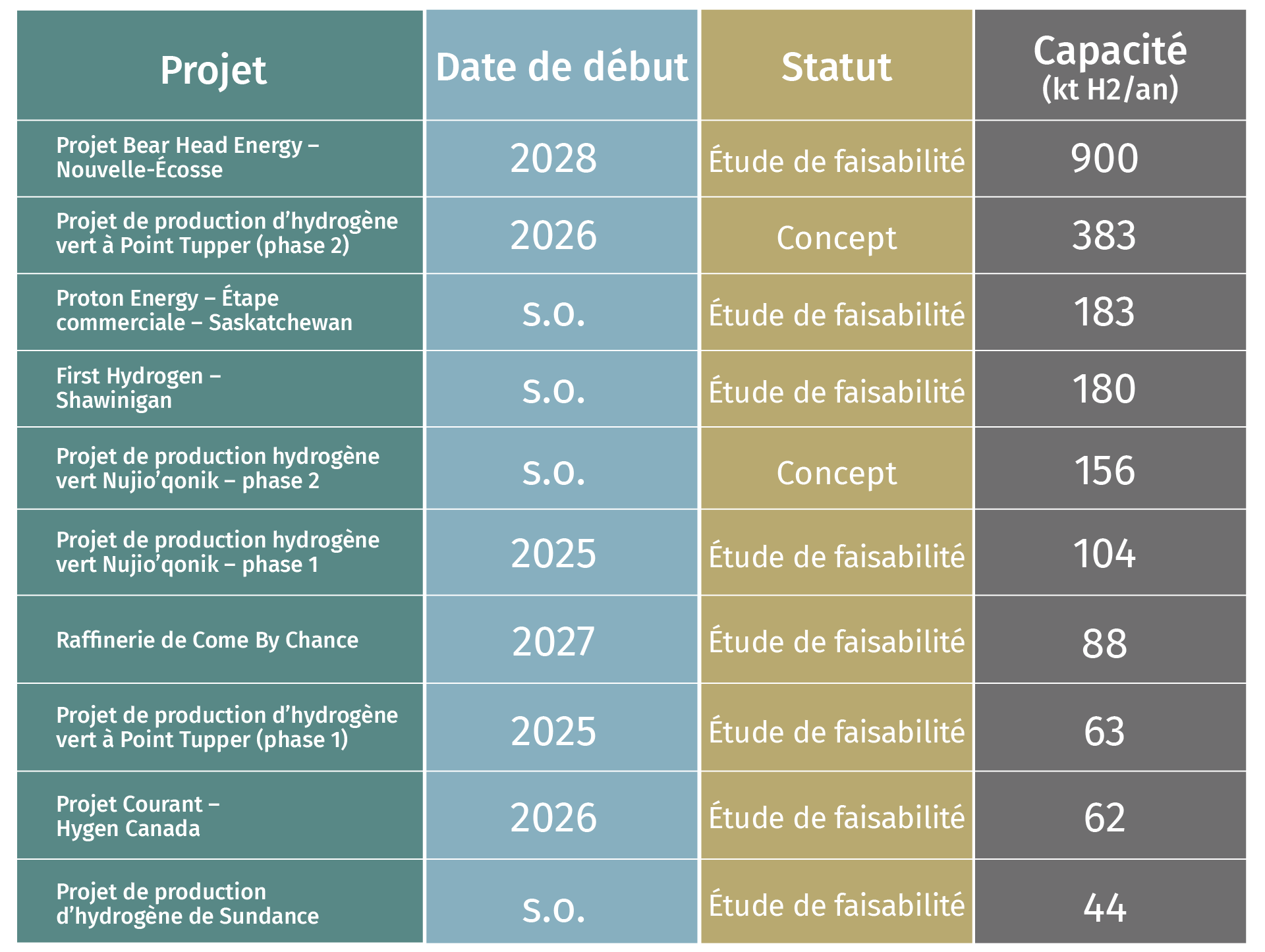
Source : Agence internationale de l’énergie
L’hydroélectricité bon marché a permis d’obtenir un important projet de production d’hydrogène vert. En effet, la société belge Tree Energy Solutions envisage de construire une usine de 4 milliards de dollars US dans la province pour produire du « gaz naturel électrique ». Outre l’hydroélectricité bon marché, l’entreprise a évoqué, à l’appui de sa décision de construire ce projet d’une capacité de 70 000 tonnes d’ici 2028, les incitatifs fiscaux fédéraux. À elle seule, on s’attend de l’installation à ce qu’elle aide le Québec à réduire ses émissions de 3 % d’ici 2030. Ce projet figure parmi les nombreux projets annoncés au Canada au cours des derniers mois (voir le tableau), alors que le pays se retrouve en situation de concurrence avec les États-Unis et d’autres pays pour obtenir sa part des budgets consacrés à l’hydrogène vert.
EN VEDETTE
75 %
Hausse estimée du coût d’un projet américain de petit réacteur modulaire (PRM), lequel passera à 9,3 milliards $ US. La société NuScale Power basée en Oregon a abandonné le projet, alors que ses coûts ont grimpé en flèche, les clients se montrant hésitants face à la hausse de 53 % des tarifs d’électricité. On estime que l’annulation du projet porte un dur coup aux ambitions américaines en matière de PRM.
Dans le numéro de cette semaine : L’horizon s’assombrit pour le climat au Canada, Enbridge s’impose en tant qu’acteur important dans le domaine du gaz « vert » et une clause obscure de l’Accord de Paris pourrait stimuler les perspectives du Canada en matière de GNL.
ÉDITORIAL
Un malaise climatique s’installe au Canada
Par John Stackhouse
La météo s’est gâtée cette semaine à Ottawa, tout comme la politique entourant la carboneutralité. Notre malaise climatique prendrait-il de l’ampleur ? J’ai passé la journée de jeudi à la troisième conférence annuelle de l’Institut climatique du Canada, et on pouvait difficilement ignorer le refroidissement. Le ciel ensoleillé de la dernière décennie est maintenant assombri par la réalité économique, alors que les gouvernements (et les consommateurs) cherchent de plus en plus des solutions économiquement viables pour décarboner la planète. L’époque de l’abondance financière est révolue, ce qui nuit au capital de risque et à tous les innovateurs qui essaient de créer et de développer des technologies énergétiques. Le réservoir budgétaire des gouvernements (et des consommateurs) étant presque à sec, les milliards de dollars espérés pour stimuler l’action climatique risquent d’être amputés. La poigne réglementaire semble également se desserrer, si l’on en juge par la discrète présentation du gouvernement Trudeau au sujet de l’imposition d’un plafond sur les émissions du secteur pétrolier et gazier (maintenant appelé un « cadre ») lors de l’événement. Et puis, il y a toute cette volatilité mondiale – deux guerres brûlantes et une guerre froide – qui ébranle les marchés (et la confiance des investisseurs) partout dans le monde.
On pourrait croire que l’année 2024 n’augure rien de bon pour l’action en faveur du climat. Mais s’il y a de l’espoir, c’est du côté du secteur privé. Cette année, la conférence de l’Institut climatique du Canada était davantage axée sur les affaires. Des aciéristes, des producteurs de pétrole et des constructeurs sont venus présenter leur plan de décarbonation – non seulement pour la planète, mais aussi pour leur propre avantage concurrentiel. Ce fut également l’occasion pour l’administration Biden de lancer un appel : elle a envoyé à Ottawa son meilleur diplomate en matière d’énergie pour promouvoir l’action climatique menée par les entreprises. Geoffrey Pyatt a expliqué comment la loi sur la réduction de l’inflation transforme les systèmes énergétiques des États-Unis (et leur compétitivité), créant ainsi d’importantes opportunités d’affaires et de commerce pour leurs alliés. À cet égard, M. Pyatt voulait connaître la « géographie politique » du Canada et savoir quelle pourrait être notre place dans une stratégie énergétique continentale qui englobe le pétrole, le nucléaire, l’hydrogène et le gaz naturel. Autrement dit, la sécurité climatique relève maintenant de la sécurité énergétique, et les deux sont liées à la sécurité nationale. Les défenseurs du climat n’ont pas adhéré à toutes ses paroles, mais ils ont compris le message. C’est le début d’un temps nouveau.
Enbridge est maintenant une puissance du domaine du gaz « vert ». Pour 1,2 milliard de dollars US, la société pipelinière basée à Calgary (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) a mis la main sur sept installations de gaz naturel renouvelable (GNR) qui appartenaient à l’entreprise américaine Morrow Renewables, grâce à de solides mesures incitatives de la part des États-Unis. L’acquisition fait d’Enbridge la troisième société en importance du domaine du GNR, après BP et Shell. Le GNR est produit à partir de déchets alimentaires et agricoles et peut être mélangé au gaz conventionnel.
La capture du carbone est sur le point de décoller. Selon BloombergNEF (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), les investissements dans les infrastructures de capture, d’utilisation et de stockage du carbone se sont élevés à 6,4 milliards de dollars US en 2022, et devraient atteindre 5 milliards de dollars US en 2023, l’industrie s’attaquant à des secteurs où les émissions sont difficiles à réduire. Les États-Unis sont susceptibles d’obtenir une part de marché de 40 % d’ici 2035, suivis du Royaume-Uni (14 %) et du Canada (12 %). La capture du carbone a toutefois ses détracteurs, notamment le milliardaire des technologies (et aujourd’hui des technologies propres) Bill Gates (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement)
C’est la ruée vers la loi sur la réduction de l’inflation. Selon un rapport du Lawrence Berkeley National Laboratory (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), plus de 10 000 projets d’énergie verte étaient en attente d’être raccordés au réseau électrique des États-Unis à la fin de 2022, la loi sur la réduction de l’inflation ayant déclenché une flambée des investissements. Cela dit, les annulations sont aussi en hausse, en raison des taux d’intérêt élevés, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des retards dans l’octroi des permis.
La facture alimentaire mondiale a augmenté de 10 000 milliards de dollars US en partie à cause des émissions. Un nouveau rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) nous apprend que si notre goût pour les aliments ultra-transformés est responsable de 70 % des coûts cachés de la production alimentaire, un cinquième des coûts totaux des systèmes agroalimentaires est lié à l’environnement. Cette situation est principalement attribuable aux émissions de gaz à effet de serre et d’azote, aux changements d’affectation des terres et à l’utilisation inefficace de l’eau.
ÉNERGIE
Comment une clause obscure de l’Accord de Paris pourrait raviver les espoirs du Canada en matière de GNL
C’est délicat. Le Canada s’apprête à se joindre à une nouvelle vague de production de gaz naturel liquéfié (GNL) qui modifiera radicalement le commerce mondial de cette ressource. Cela intervient à un moment où le Canada envisage d’imposer un plafond sur les émissions du secteur pétrolier et gazier (et non la production, précisons-le) et où la Colombie-Britannique met en place des règles strictes et oblige l’exécution de tests rigoureux sur les émissions pour les projets futurs de GNL. Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), ne croit pas non plus que le pétrole et le gaz canadiens puissent résoudre la crise énergétique européenne déclenchée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
Mais le train du GNL poursuit sa route au pays. En Colombie-Britannique, l’achèvement du gazoduc Coastal GasLink reliant le projet LNG Canada de Shell (qui est terminé à 85 % (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) et pour lequel l’expédition de la première cargaison est prévue d’ici 2025) au gisement de Montney constitue un jalon important pour l’industrie. Le projet Cedar LNG (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), soutenu par les Premières Nations, a obtenu des approbations environnementales et vise une décision finale en matière d’investissement d’ici le quatrième trimestre de 2023, et le projet Woodfibre LNG (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) d’Enbridge avance.
Tout cela s’inscrit dans le cadre d’une domination imminente de l’Amérique du Nord au niveau de la production de GNL. Les grands exportateurs que sont le Qatar et l’Australie sont en passe de perdre leur mainmise sur le marché. En effet, on s’attend à ce que les États-Unis et le Canada comptent pour 39 % de la capacité de production totale de GNL d’ici 2030.
Le GNL à faible intensité de carbone du Canada entre dans la mêlée
(intensité carbone des projets de GNL en 2021 – t d’éq. CO2/t)
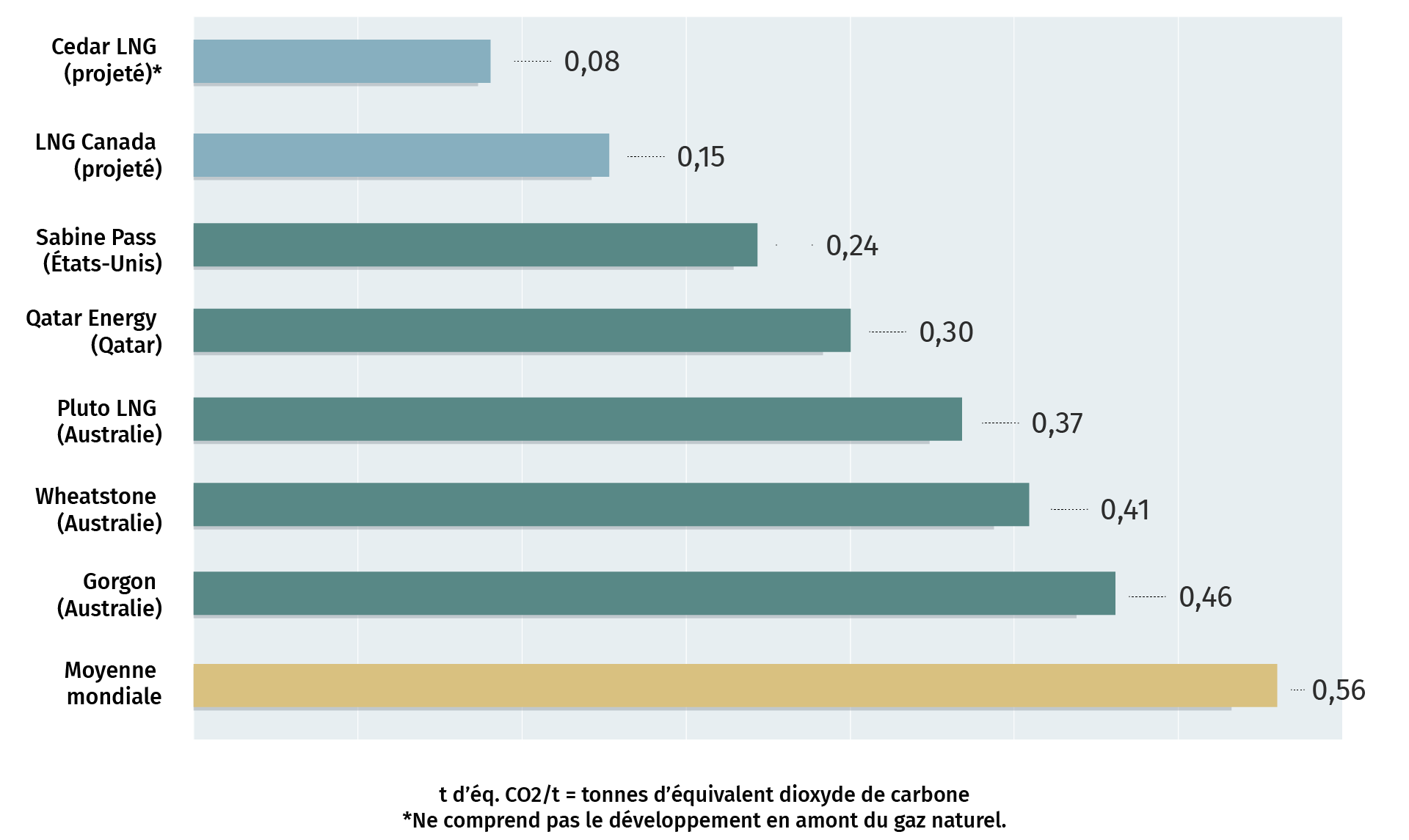
Source : Evaluate Energy/sociétés
Un récent rapport d’Evaluate Energy (ce contenu est disponible en anglais seulement) indique que cette nouvelle offre va remodeler les flux commerciaux mondiaux.
De plus, d’après les prévisions de cette société de données, le Canada pourrait devenir le cinquième producteur mondial de GNL d’ici la fin de la décennie. Fait important, le pays est susceptible d’être l’un des fournisseurs à l’intensité de carbone parmi les plus faibles si la Colombie-Britannique continue de décarboner son réseau électrique.
Par ailleurs, les rouages de la réglementation climatique mondiale s’engrènent actuellement de façon à aider les autorités canadiennes à surmonter leur malaise, avec l’évolution en coulisse de l’article 6.4 de l’Accord de Paris – bien qu’il reste du travail à faire.
Cet article prévoit un mécanisme pour l’établissement d’un marché de crédits de carbone sur lequel les réductions ou les absorptions de gaz à effet de serre peuvent être transférées à l’échelle internationale. En principe, cela signifie qu’un projet de GNL en Colombie-Britannique pourrait obtenir des crédits pour le remplacement de l’électricité produite à partir du charbon en Chine. Un rapport de 2020 (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) révèle que les exportations canadiennes de GNL pourraient réduire les émissions chinoises liées au charbon dans une proportion de 34 à 62 %.
Ces dernières semaines, cette clause a attiré l’attention en arrière-scène, l’organisme de contrôle ayant pris plus de 100 décisions cruciales (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) En octobre, Olga Gassan-zade, présidente de l’organisme de contrôle de l’article 6.4, a déclaré à S&P Global qu’elle était confiante mais nerveuse quant à la ratification d’un document final à la COP28 qui se tiendra à Dubaï. Toutefois, le groupe n’a pas réussi à finaliser (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) le texte sur le commerce du carbone, et de nouvelles réunions sont prévues à cette fin. Advenant que le texte soit approuvé par les pays à la COP28, les Nations Unies pourraient procéder à l’inscription de projets au titre de l’article 6.4 l’année suivante (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) Mais il s’agit là d’un gros « si ».
TABLEAU DE LA SEMAINE
Repérez la valeur aberrante
Performance des pays du G7 au chapitre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre
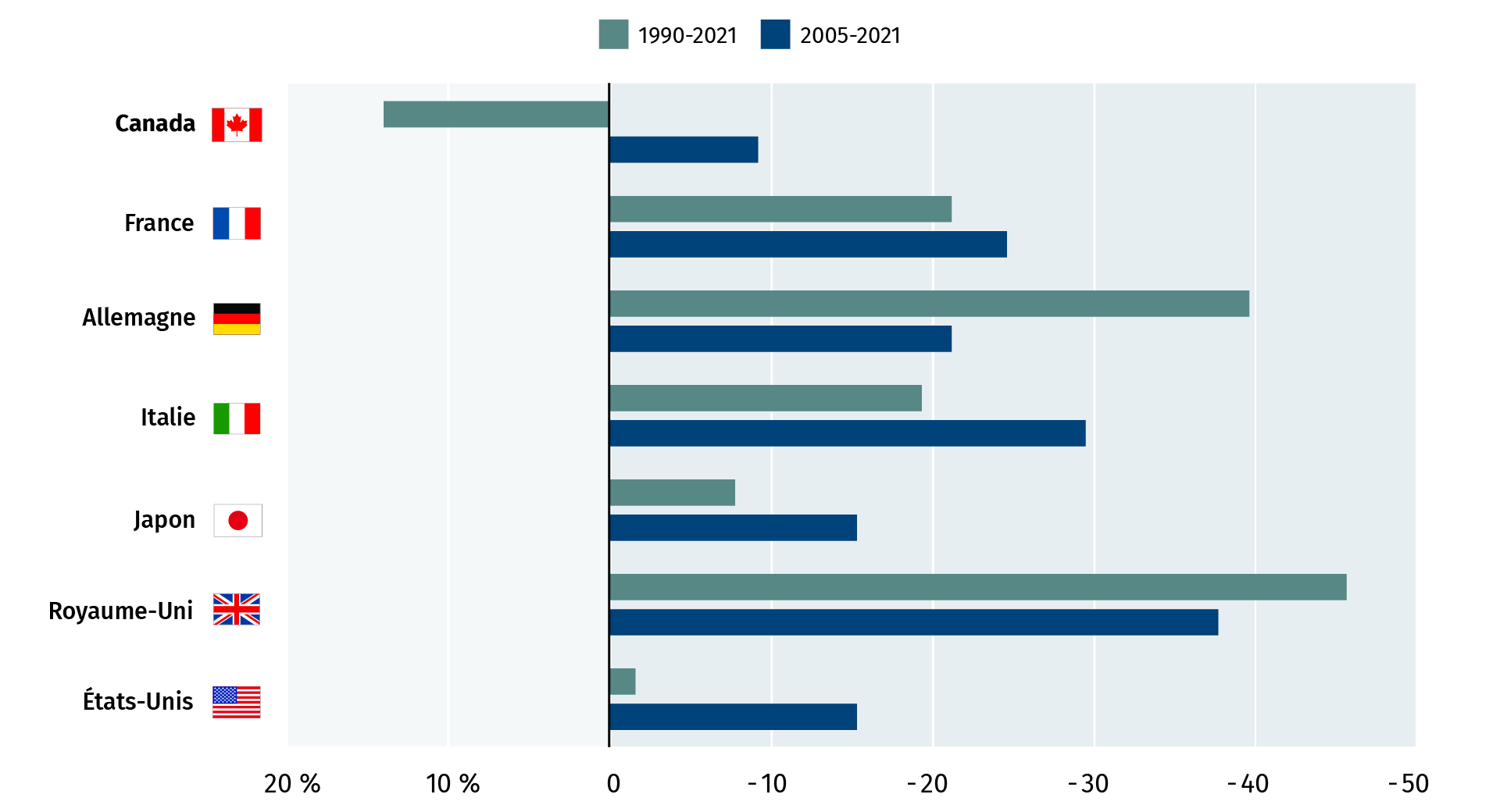
Source : Bureau du vérificateur général du Canada
Selon un rapport du commissaire fédéral à l’environnement, le Canada est le pays du G7 qui a le moins réduit ses émissions depuis 1990. Les États-Unis et le Royaume-Uni sont les deux autres producteurs de pétrole et de gaz. Cette évaluation pessimiste laisse aussi entendre que le Plan de réduction des émissions (politique phare d’Ottawa en matière de climat) est insuffisant pour assurer l’atteinte des objectifs climatiques de 2030.
EN VEDETTE
90 %
Le pourcentage de graphite raffiné (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) par la Chine. Les nouvelles restrictions à l’exportation imposées par la Chine sur un matériau essentiel à la fabrication de batteries pour véhicules électriques poussent les constructeurs automobiles à chercher d’autres sources d’approvisionnement.
Dans le numéro de cette semaine : Des provinces fulminent contre les nouvelles exemptions à la taxe fédérale sur le carbone, le secteur de l’énergie éolienne en mer confronté à des vents contraires et la grande question de la COP 28 : qui devrait contribuer davantage au fonds pour les pertes et les dommages liés aux changements climatiques ?
Ottawa n’a pas l’intention de bonifier les subventions au captage du carbone dans le secteur des sables bitumineux. Le gouvernement fédéral estime que le crédit d’impôt de 50 % qu’il propose à la communauté pétrolière devrait suffire pour construire des usines de capture et de stockage de carbone (CSC). L’Alberta n’a pas encore manifesté clairement son appui. Les entreprises du secteur des sables bitumineux, qui planifient des projets de CSC pour réduire leurs émissions d’environ 27 % (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) d’ici 2030, espéraient plus de soutien du gouvernement fédéral.
La construction du gazoduc côtier est achevée. Certaines Premières Nations s’y opposent, mais 17 groupes autochtones envisagent de devenir copropriétaires du gazoduc qui relie l’usine LNG Canada, située à Kitimat et appuyée par Shell (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), à des gisements de schiste en Colombie-Britannique. Le projet d’exportation de gaz naturel liquéfié devrait entraîner une hausse de 4 % des émissions de gaz à effet de serre du Canada au moment de son démarrage en 2025.
Le secteur mondial de l’énergie éolienne en mer dans la tourmente. La hausse des coûts de financement, l’engorgement des chaînes logistiques et la pénurie de main-d’œuvre ont réduit la marge de manœuvre des promoteurs (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) et mis un terme à la formidable croissance du secteur. Cette semaine, Orsted (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), le plus grand constructeur au monde de parcs éoliens en mer, a annulé deux projets au large du New Jersey en raison de l’augmentation des coûts. Selon Wood Mackenzie, ce ralentissement pourrait avoir une incidence sur les installations mondiales, qui doivent faire passer leur production moyenne annuelle actuelle de 3 GW (en dehors de la Chine) à 77 GW d’ici 2030 pour atteindre leurs objectifs de zéro émission nette.
Coup de frein des constructeurs de véhicules électriques. Tesla a retardé son projet (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) d’usine au Mexique et Ford a ralenti la production de sa camionnette F1-50 Lightning, la hausse des taux d’intérêt minant la confiance des consommateurs. Bien qu’au troisième trimestre on ait franchi pour la première fois la barre des 300 000 véhicules électriques vendus aux États-Unis, les constructeurs prévoient une période de morosité en raison de l’essoufflement de la croissance économique mondiale.
POLITIQUE PUBLIQUE
L’incidence néfaste de la hausse des prix de l’énergie sur la politique climatique du Canada
Le Canada subit le même sort que l’Europe.
De l’autre côté de l’Atlantique, les décideurs politiques ont revu petit à petit leurs ambitions à l’égard des changements climatiques afin de juguler la hausse des prix de l’énergie et de contenir la colère des consommateurs et des entreprises. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), a récemment averti les progressistes en matière de climat des revers qu’ils pourraient subir lors des élections européennes de l’an prochain s’ils ne parviennent pas à concilier leurs politiques à long terme sur le climat avec les priorités immédiates liées au coût de la vie.
Ce débat à connotation politique a traversé l’Atlantique avant de se propager d’un océan à l’autre.
L’exemption de trois ans à la taxe carbone (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) sur le mazout domestique, qu’Ottawa a accordée aux provinces de l’Atlantique dans le cadre d’une série de mesures visant à réduire le coût de l’énergie et à consolider ses appuis dans la région, a suscité la colère des autres provinces qui affirment que leurs citoyens souffrent également des coûts élevés de l’énergie.
Le Parti libéral est lui-même responsable de ce coup porté à l’une de ses politiques auxquelles il tenait pourtant le plus. Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), estime que seulement 0,15 % de l’inflation est attribuable à la taxe carbone. C’est ce même discours qu’a tenu le Parti libéral, jusqu’à ce qu’il adopte cette nouvelle « série de mesures visant à réduire le coût de l’énergie ».
Les autres provinces ont désormais un argument convaincant à faire valoir : pourquoi ne pas étendre l’exemption au gaz naturel, qui présente un bilan carbone moins élevé que le mazout domestique et qui a une plus grande incidence sur la facture d’énergie des ménages canadiens ?
Les données de Statistique Canada montrent que les dépenses d’énergie des ménages sont traditionnellement plus élevées dans les provinces de l’Atlantique qu’ailleurs au pays. Cela est dû à la forte dépendance de la région au mazout domestique, qui coûte plus cher et est soumis aux fluctuations des marchés pétroliers mondiaux. En fait, le pourcentage des dépenses consacrées à l’énergie dans le total des dépenses des ménages des provinces de l’Atlantique a légèrement baissé depuis 2021 par rapport à la période précédant la taxe fédérale sur le carbone (2018). En revanche, l’Alberta, l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique ont vu la part de l’énergie augmenter dans les dépenses par rapport à 2018.
Les prix du gaz naturel et du carburant demeurent élevés dans l’ensemble du Canada
Variation (%) au cours des trois derniers mois, par rapport à la moyenne de 2018
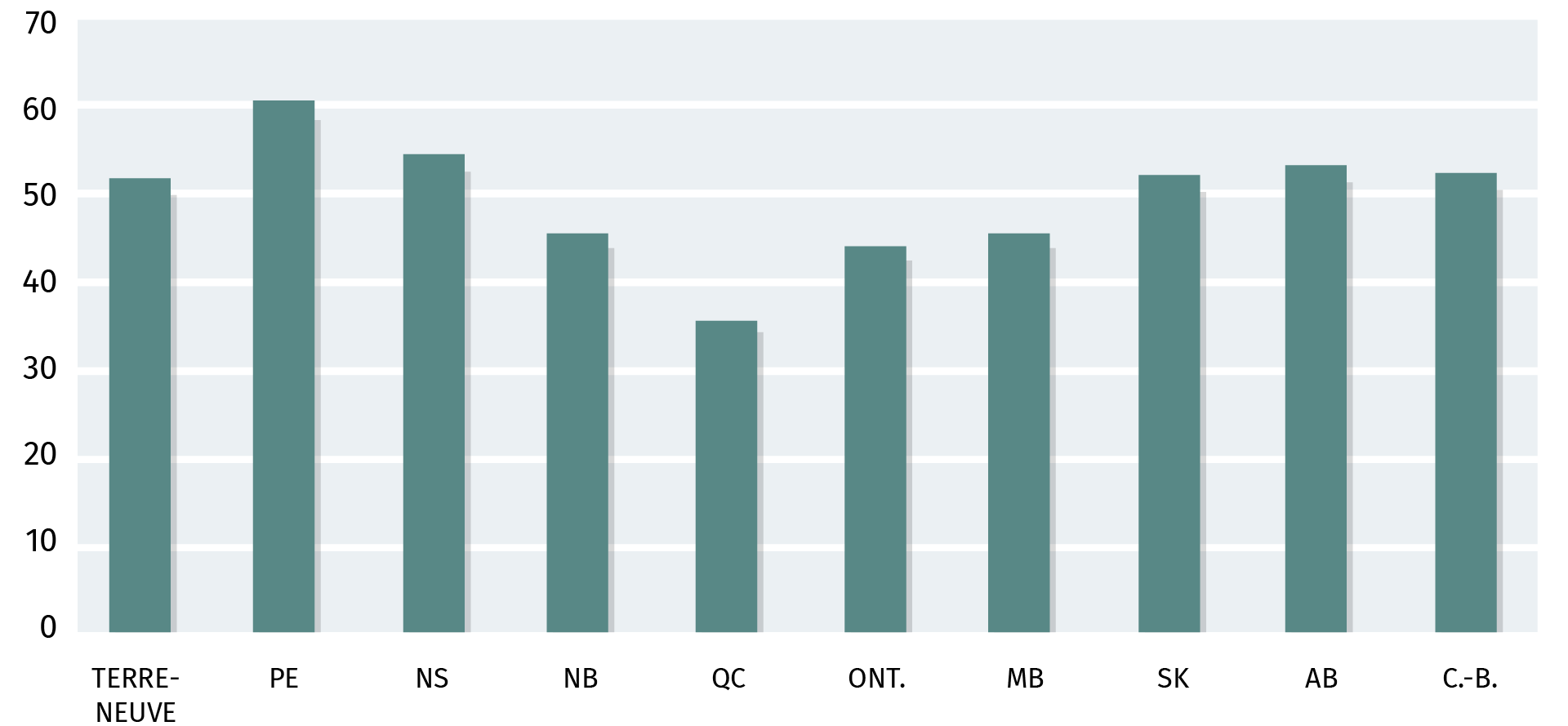
Sources : Statistique Canada, Recherche économique RBC
À plus grande échelle, le gouvernement fédéral se voit contraint de redéfinir sa politique climatique pour éviter qu’elle ne soit complètement démantelée lors des prochaines élections (le Parti conservateur fédéral (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), qui mène actuellement dans les sondages, s’est engagé à « Réduire les impôts »).
Ce ne sera pas chose facile. Le recul du Parti libéral sur le climat a eu rapidement des retombées politiques, et ce premier assouplissement majeur a été perçu comme une mauvaise décision.
Par contre, il est indéniable que nous évoluons dans une nouvelle conjoncture où le prix des produits de base et des intrants manufacturiers a augmenté en raison des problèmes géopolitiques, du réchauffement planétaire et des contraintes liées à la chaîne logistique. Tout cela contribue à compliquer davantage la lutte contre les changements climatiques.
Bâtiments
Trois façons de tirer parti du bois massif canadien
Le Canada peut puiser dans ses abondantes ressources forestières pour mettre au point un nouveau matériau de construction à faibles émissions de carbone : le bois massif. Ce matériau, fait de bois d’ingénierie, peut être utilisé dans les tours de taille moyenne pour remplacer ou compléter le ciment et l’acier, qui proviennent de secteurs où il est difficile de réduire les émissions. En plus, le bois massif pourrait contribuer à résoudre la crise du logement au Canada.
Alors pourquoi n’en produisons-nous pas à grande échelle ? Un nouveau rapport publié par l’Institut d’action climatique RBC, intitulé Structure en bois d’œuvre : quel est l’apport du bois pour les constructions écologiques au Canada ? (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), se penche sur le rôle que pourrait jouer le Canada dans l’éclosion d’une nouvelle industrie à faibles émissions de carbone.
« L’utilisation du bois massif dans les nouveaux appartements et les nouvelles copropriétés et tours de bureaux pourrait réduire les émissions d’au moins 9 Mt, soit près de 10 % des émissions du secteur, d’ici 2030 », écrit Myha Truong-Regan, auteure principale du rapport et cheffe, Recherche climatique, Institut d’action climatique RBC.
Par contre, l’industrie fait face à trois défis de taille :
(1) Les primes d’assurances pour la construction de bâtiments conçus en bois massif peuvent être jusqu’à dix fois plus élevées que pour les bâtiments comparables conçus en acier et en béton, ce qui fait hésiter de nombreux promoteurs.
(2) L’inadéquation entre les lieux de production de bois massif (Ouest du Canada) et la demande pour ce matériau (Est du Canada).
(3) Le coût élevé des équipements de fabrication empêche de nouveaux acteurs de se lancer dans le secteur.
Selon des rapports, le Canada peut devenir un chef de file du secteur du bois massif et s’emparer d’au moins 25 % du marché mondial, mais il doit d’abord venir à bout de ces trois obstacles.
Lisez le rapport intégral ici (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement)
TABLEAU DE LA SEMAINE
Qui paie pour les émissions ?
Le compte à rebours a commencé pour la COP 28, qui aura lieu aux Émirats arabes unis. Il en va de même pour la comptabilisation des émissions (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) Pendant des années, les pays riches, qui ont une responsabilité élevée dans les émissions de gaz à effet de serre à l’origine d’inondations, de sécheresses et de tempêtes extrêmes de plus en fréquentes, ont rejeté les demandes d’indemnisation des pays plus pauvres. Alors, faut-il calculer les réparations selon le nombre d’habitants, ou encore selon les émissions historiques ou actuelles ?
La Lutte Contre Les Émissions
Émissions par habitant de pays membres du G-20 et part historique des émissions mondiales
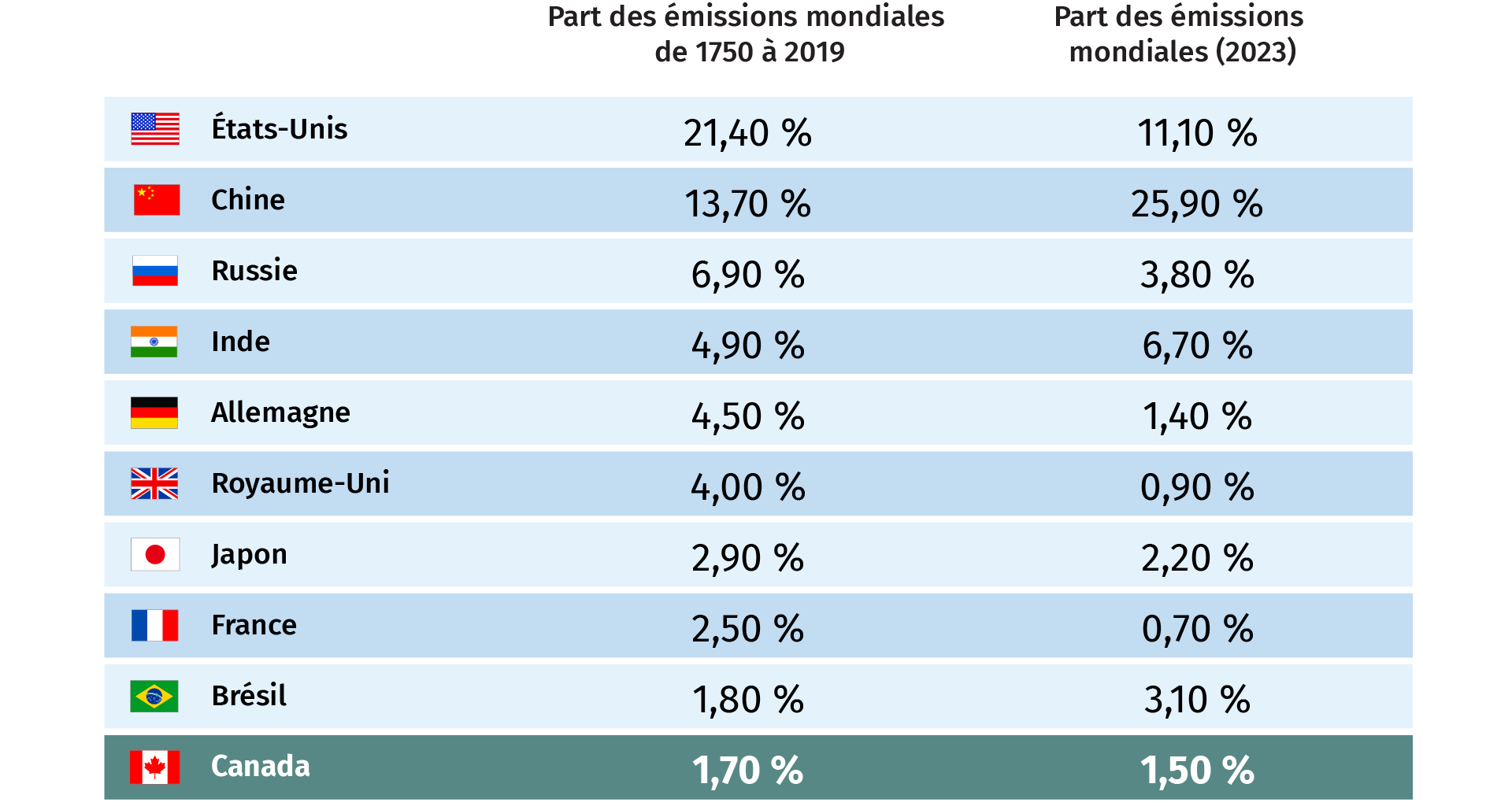
Source : BloombergNEF
EN VEDETTE
1,8 USD
La proportion d’investissements dans les systèmes d’énergie propre en 2022 par rapport à chaque dollar américain investi à l’échelle mondiale (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) dans les combustibles fossiles. Il y a cinq ans, le ratio était de 1:1.
Dans le numéro de cette semaine : L’un des premiers premiers ministres autochtones du Canada pourrait aider le Manitoba à prendre la tête de la course nationale vers la carboneutralité, les compagnies pétrolières défient l’avertissement de l’AIE, et les jeunes Européens sont prêts à faire de gros sacrifices pour sauver la planète.
La voie Wab Kinew
Par John Stackhouse
La semaine dernière, je me suis rendu à Winnipeg, et il y a une nouvelle énergie dans l’air. L’élection de Wab Kinew au poste de premier ministre du Manitoba – l’un des premiers Autochtones à diriger une province – a braqué les projecteurs sur la province, son rôle dans la réconciliation et son leadership dans la course vers la carboneutralité.
J’ai rencontré le premier ministre Kinew pour discuter de ses politiques climatiques, des conclusions de l’Institut d’action climatique RBC et de la possibilité que le Manitoba devienne un nouveau modèle pour la transition du Canada. Il revenait sans cesse à un seul mot : hydrogène. Son gouvernement néo-démocrate veut faire du Manitoba une plaque tournante de l’hydrogène vert, même si la province est à court d’énergie industrielle excédentaire. M. Kinew souhaite également faire progresser l’adoption des véhicules électriques, en particulier pour les autobus, les camions et les machines agricoles qui représentent un tiers des émissions du Manitoba. Il dispose d’un avantage local, New Flyer Industries, un acteur mondial dans le domaine des autobus électriques et à hydrogène, mais il a besoin d’une économie en croissance pour financer la transition.
L’augmentation de la production et de la transmission d’électricité sera un défi supplémentaire pour la promesse de réconciliation de Kinew. La population de sa province compte 20 % d’Autochtones, soit la proportion la plus élevée du Canada, et les nouveaux projets seront soumis à des tests de plus en plus nombreux de « consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause ». Le même défi se posera à la promesse du NPD de produire des minéraux critiques. (La province affirme détenir 29 des 31 minéraux critiques, dont le lithium.) M. Kinew espère qu’un consentement enthousiaste se manifestera dans le cadre de partenariats commerciaux.
L’autre grande opportunité climatique du Manitoba ? L’agriculture. J’ai visité la Glenlea Research Station de l’Université du Manitoba, au sud de Winnipeg, pour voir le plus ancien site de test de piégeage du carbone dans le sol au Canada, destiné à capturer les gaz à effet de serre. La station développe également des technologies pour capturer les gaz émis par les quatre millions de vaches, de porcs et de cochons de la province.
Le Manitoba ne compte que 1,4 million d’habitants. La province aura besoin de toutes les technologies climatiques qu’elle peut développer pour exploiter son énergie.
Les nouvelles règles de l’Union européenne en matière de climat mettent 50 000 multinationales en garde. La nouvelle loi élargit le nombre d’entreprises internationales (10 700 actuellement) qui doivent publier des données détaillées sur l’impact de leurs activités sur les personnes et la planète, ainsi que sur les risques liés au développement durable auxquels elles sont exposées, et ce, à partir de l’année prochaine. Certaines entreprises canadiennes sont déjà sur la sellette.
Toyota va de l’avant avec une technologie prometteuse pour les véhicules électriques. Le plus grand producteur mondial de voitures à moteur à combustion interne, qui se trouve dans la position inhabituelle d’être à la traîne de ses rivaux, est sur le point de mettre au point la prochaine génération de batteries à semi-conducteurs. Cette technologie est considérée comme révolutionnaire, car elle réduit les temps de charge et les risques d’explosion et d’incendie. Le constructeur japonais a fixé la date du lancement commercial à 2027, mais le marché reste sceptique, car Toyota a déjà manqué à plusieurs reprises les délais de développement dans le passé.
Les jeunes Européens sont prêts à faire plus de sacrifices pour aider la planète. Toutes les tranches d’âge sont préoccupées par les changements climatiques, mais les jeunes Européens sont davantage prêts à modifier leur mode de vie pour lutter contre cette réalité, selon un sondage YouGov. Les Européens de 18 à 34 ans sont plus disposés à avoir moins d’enfants pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques et plus enclins à payer un supplément pour les vols à faibles émissions de carbone. Surtout, ils soutiennent davantage les politiques climatiques transformatrices que les groupes plus âgés.
Un manteau à 899 $ US fabriqué à partir de déchets recyclés, ça vous tente ? Le manteau le plus chaud de Patagonia ne contient pas de « produits chimiques éternels » et est entièrement fabriqué à partir de déchets plastiques. Les matériaux utilisés pour le Stormshadow Parka proviennent d’une société qui récupère les plastiques des océans et les transforme en tissus imperméables et durables.
ÉNERGIE
La note de l’AIE a-t-elle échappé à la communauté pétrolière de l’Amérique du Nord ?
Chevron et ExxonMobil semblent avoir manqué les rapports de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) sur la baisse de la demande de pétrole. Les poids lourds américains du pétrole ont récemment conclu deux accords distincts en vue de racheter des compagnies pétrolières concurrentes plus petites, pour une valeur combinée dépassant largement les 110 milliards de dollars américains.
Ces accords interviennent alors que l’AIE a récemment laissé entendre que les combustibles fossiles étaient en phase terminale. Le scénario de statu quo de l’agence (appelé « Scénario des politiques énoncées ») prévoit une baisse de la demande de charbon, de pétrole et de gaz naturel avant la fin de la décennie. Les pics de demande mettent en évidence les risques économiques et financiers de nouveaux projets pétroliers et gaziers d’importance, en plus des risques qu’ils représentent pour les changements climatiques, a averti l’AIE dans son dernier rapport Perspectives énergétiques mondiales publié cette semaine.
Presque par défi, les secteurs pétroliers américain et canadien ont entamé une série de fusions sur la base d’un sentiment haussier plutôt que de craintes. Le chef de la direction de Chevron, Mike Wirth, a affirmé que l’affectation des capitaux visait à répondre aux demandes du monde réel, et non à des scénarios. Pendant ce temps, Royal Dutch Shell supprime des emplois dans son unité d’énergie propre et les producteurs de gaz du Moyen-Orient concluent des accords pluriannuels.
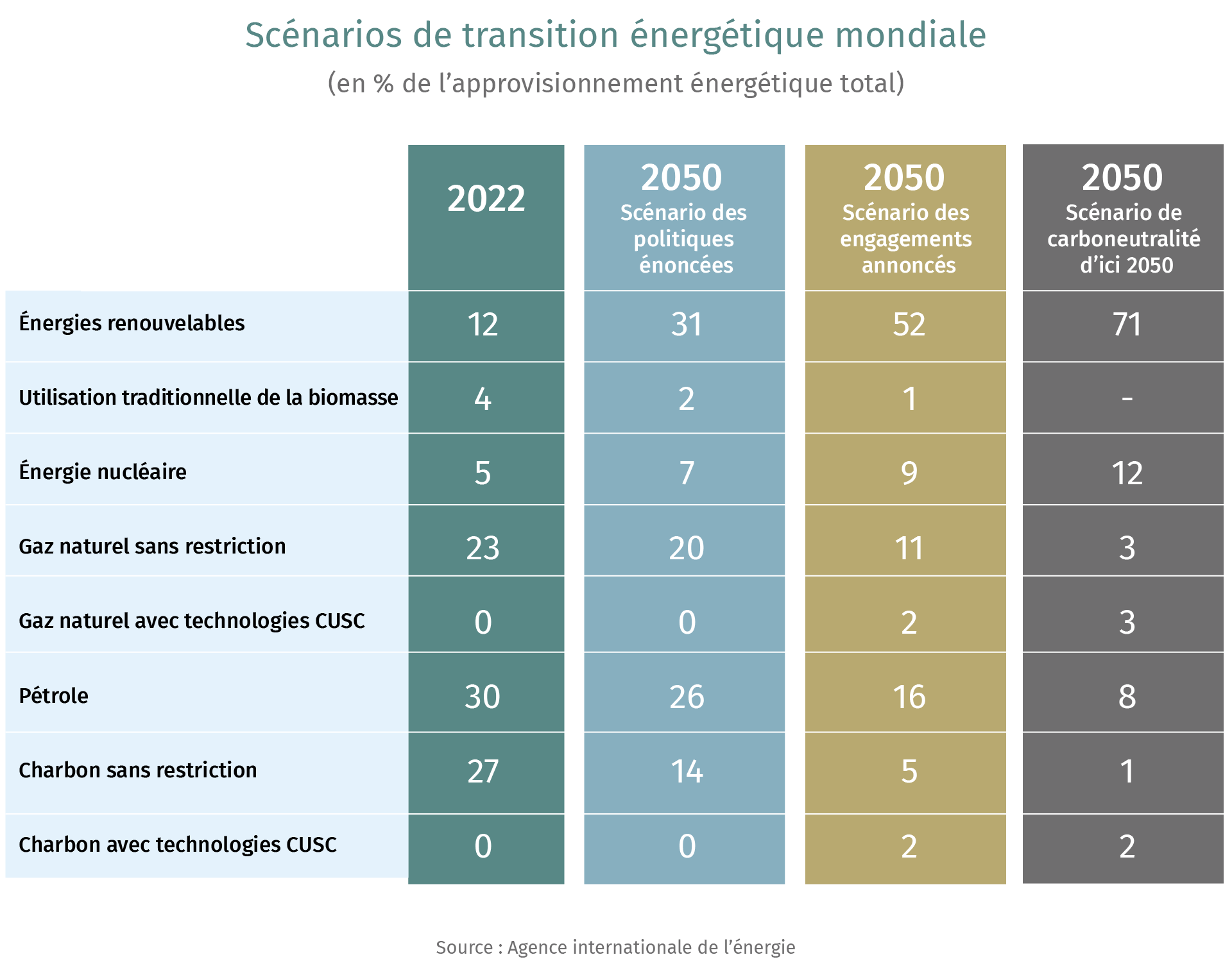
Il pourrait s’agir d’un pari à fort enjeu pour les compagnies pétrolières et gazières. Le monde se trouve à un point d’inflexion, la transition énergétique inarrêtable attirant des milliards de dollars. Si le scénario le plus ambitieux de l’AIE se concrétise – la carboneutralité d’ici 2050 –, la demande de pétrole pourrait s’effondrer (187 exajoules en 2022 contre 42 exajoules en 2050), tandis que celle du gaz naturel (146 EJ contre 14 EJ) et du charbon (170 EJ contre 12 EJ) pourrait pratiquement cesser.
Il semble que nous soyons dans une transition énergétique bipolaire, avec deux camps opposés qui investissent des milliards de dollars à un moment de grande incertitude, de flux géopolitique et d’économie mondiale vacillante. Le débat entre molécules et électrons sera au cœur de la COP28 qui se tiendra à Dubaï dans un mois. Cela ne semble pas être la recette d’une discussion ordonnée, ni d’un atterrissage en douceur pour la transition énergétique.
TABLEAU DE LA SEMAINE
Les sociétés de capital-risque et les investisseurs privés canadiens ont injecté des niveaux records de financement dans le secteur des technologies propres l’année dernière. Mais une grande partie de cet argent est investie dans des projets en démarrage à un stade avancé. Exportation et développement Canada indique dans un nouveau rapport que le manque de capitaux pour les entreprises en prédémarrage et en premier développement est une défaillance du marché, qui témoigne d’un écart de financement critique et d’occasions manquées.
EN VEDETTE
290 millions de tonnes d’émissions d’équivalent CO2
Ce sont les émissions estimées des incendies de forêt de cette année au Canada – soit l’équivalent de 43 % des émissions du Canada en 2022. Mais l’inventaire officiel du Canada n’évaluera qu’une partie de ces émissions et aucune d’entre elles ne sera comptabilisée dans le total du pays.
Dans le numéro de cette semaine : La plus haute cour du Canada met un frein aux ambitions climatiques du gouvernement fédéral, la façon dont les Canadiens peuvent économiser 800 $ sur leurs factures énergétiques mensuelles, et ce qui stresse les arbres dans le monde entier.
Une région éloignée de l’Est du Canada balayée par les vents pourrait devenir le principal centre d’énergie éolienne du pays. Le banc de l’Île de Sable pourrait abriter 1 000 turbines extracôtières générant 70 000 gigawattheures d’électricité, soit près du double de la consommation annuelle dans les provinces de l’Atlantique, selon une étude du Forum des politiques publiques (ce contenu est disponible en anglais seulement) Bien qu’il n’existe actuellement aucune turbine dans la région, des investissements opportuns pourraient permettre de tirer parti des grands vents qui y règnent, de même que de ses zones maritimes profondes et libres de glace, pour un déploiement d’éoliennes à grande échelle, a noté le rapport.
Suncor maintient ses engagements climatiques. Le géant des sables bitumineux a rassuré les législateurs canadiens (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) cette semaine au sujet de son intention d’atteindre la cible zéro émission nette d’ici 2050. Ottawa s’en inquiétait depuis que le chef de la direction de Suncor, Rich Kruger (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), avait déclaré en août que Suncor avait négligé « ses moteurs opérationnels » (c.-à-d. les sables bitumineux) et mis un accent « disproportionné » sur la transition énergétique.
On compte aux États-Unis pas moins de sept projets régionaux de production d’hydrogène financés à hauteur de 7 milliards de dollars US (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), qui viendront accélérer le marché intérieur de l’hydrogène propre et abordable. S’ajouteront à ce financement des investissements commerciaux de 43 milliards de dollars US visant l’établissement de raffineries, de ports, de camions de gros tonnage et d’installations de production d’engrais. Cet investissement aux États-Unis pourrait-il mettre en péril la stratégie canadienne en matière d’hydrogène (ce contenu est disponible en anglais seulement), qui repose en partie sur l’exportation de ce carburant à son voisin du Sud ?
Les arbres partout dans le monde se portent mal. Une nouvelle étude (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) affirme que les changements climatiques augmentent les risques de maladie des arbres, de nombreuses éclosions ayant été liées au réchauffement planétaire. La fréquence accrue des phénomènes climatiques extrêmes pourrait stresser les arbres, privant le monde de leurs capacités d’absorption du carbone, a mis en garde l’écologiste Andrew Gougherty du Forest Service des États-Unis.
RÉGLEMENTATION
La Cour suprême vient-elle d’ébranler le plan climatique d’Ottawa ?
La semaine a été difficile pour Ottawa au chapitre du climat.
La semaine dernière, la Nouvelle-Écosse (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) et le Nouveau-Brunswick se sont retirés du projet de la boucle de l’Atlantique, qui vise à faire passer ces deux provinces du charbon à l’énergie hydroélectrique de Terre-Neuve-et-Labrador et du Québec. Rebutée par les coûts du projet, la Nouvelle-Écosse cherche d’autres moyens d’atteindre ses objectifs en matière d’émissions d’ici 2030.
Le coup fatal a été porté vendredi : cinq des sept juges de la Cour suprême (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) se sont rangés du côté de l’Alberta, déclarant que certaines parties de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) (l’ancien projet de loi C 69 controversé) étaient inconstitutionnelles.
L’Alberta avait intenté un procès à Ottawa au motif que la LEI, qualifiée de « loi sur l’élimination des pipelines » dans certains milieux, empiétait sur les compétences provinciales en donnant au gouvernement fédéral d’importants droits de veto de grands projets énergétiques.
La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, et le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, ont salué la décision du tribunal. Cette dernière ne va cependant pas aussi loin que les provinces l’espéraient, puisque la Cour suprême n’a pas abrogé la LEI. Ottawa pourrait donc en modifier le libellé pour assurer qu’elle n’outrepasse pas son champ de compétence constitutionnel. Surtout, la Cour confirme la légitimité du rôle du gouvernement fédéral dans ce dossier, même lorsqu’un projet relève principalement d’une compétence provinciale. « Elle s’est simplement bornée à préciser que les pouvoirs d’Ottawa sont beaucoup plus restreints que ceux que lui accorde la LEI, telle qu’elle est actuellement rédigée », selon un avocat (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement)
La partie n’est donc pas gagnée pour les adversaires de la LEI. « Nous pensons que les tribunaux seraient enclins à approuver toute demande du gouvernement fédéral visant à suspendre les litiges en la matière pendant une période raisonnable afin d’accorder à Ottawa le temps de donner suite à la décision de la Cour suprême », disent Martin Olszynski, Nigel Bankes et David Wright (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), professeurs à l’Université de Calgary. Messieurs Olszynski et Wright sont intervenus à l’appui de la LEI devant la Cour suprême.
La Cour ayant donné, du moins en partie, raison aux critiques des politiques climatiques fédérales, il sera intéressant de voir comment sera accueillie la prochaine annonce fédérale de plafonnement des émissions de gaz à effet de serre, prévue cet automne, et la version définitive du Règlement sur l’électricité propre, prévue l’an prochain. « D’autres batailles juridiques se profilent vraisemblablement à l’horizon », ont fait remarquer les professeurs de l’Université de Calgary.
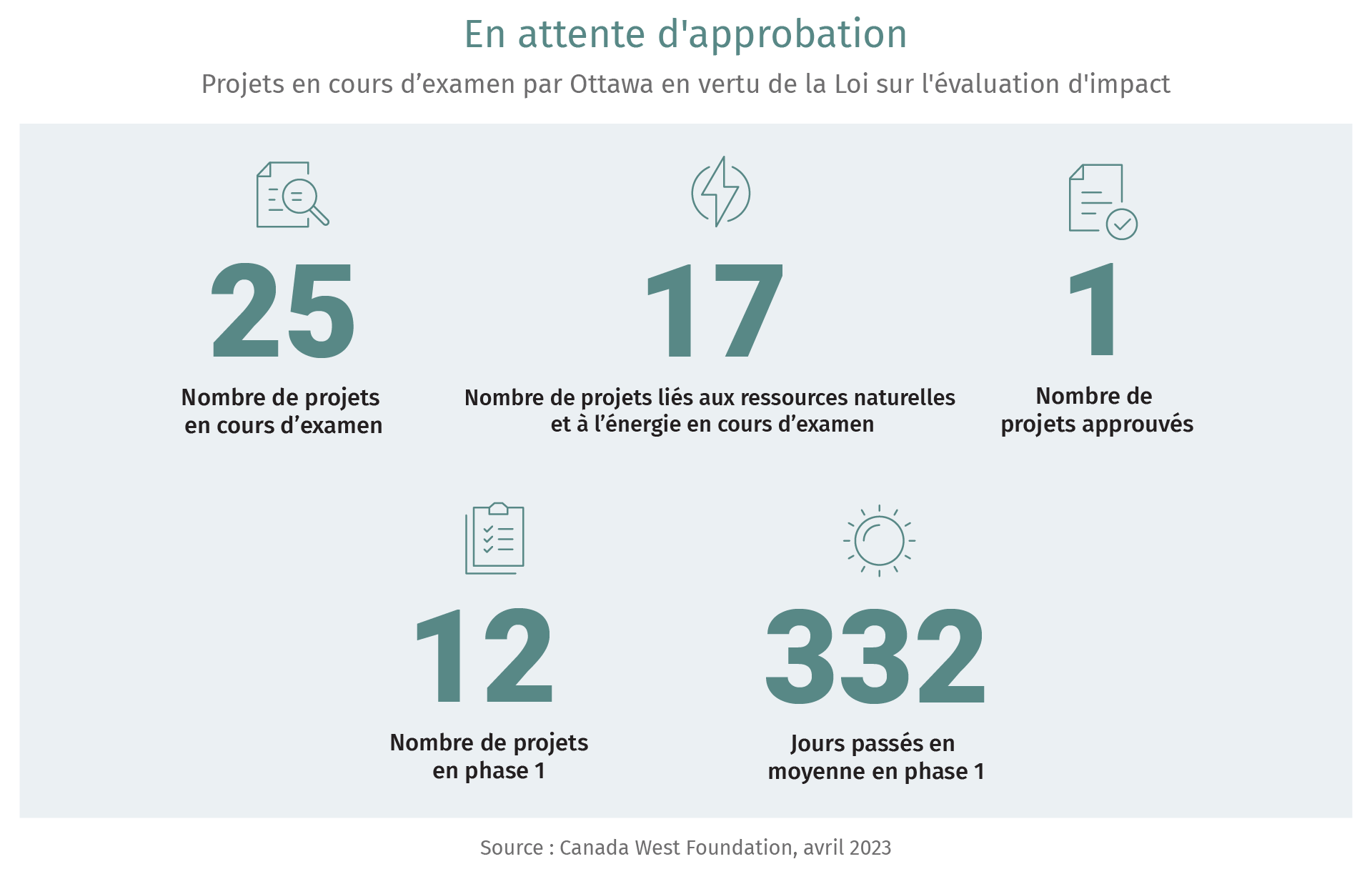
Bien que provoquant plus d’incertitude au chapitre de la réglementation climatique canadienne, la décision de la Cour suprême donne au gouvernement fédéral l’occasion de revoir la LEI, qui a suscité son lot de controverse depuis son adoption en 2019. La plupart des projets relevant de sa compétence, en effet, demeurent bloqués aux étapes de la planification et des déclarations d’impact des promoteurs, selon un rapport de la Canada West Foundation (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) plus tôt cette année. Un seul projet (le Cedar LNG, soutenu par les Premières Nations) a été approuvé depuis l’entrée en vigueur de la LEI.
GRAPHIQUE DE LA SEMAINE
Baisses des émissions et des factures d’énergie
En passant aux véhicules électriques et en remplaçant leur chaudière au mazout par une thermopompe, les ménages de quatre personnes de Toronto pourraient réduire leur bilan carbone tout en économisant 800 $ par mois, selon un nouveau rapport de Clean Energy Canada (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) Les gouvernements peuvent favoriser cette transition en prolongeant leurs programmes d’énergie propre et en stimulant l’amélioration de l’efficacité énergétique des maisons.
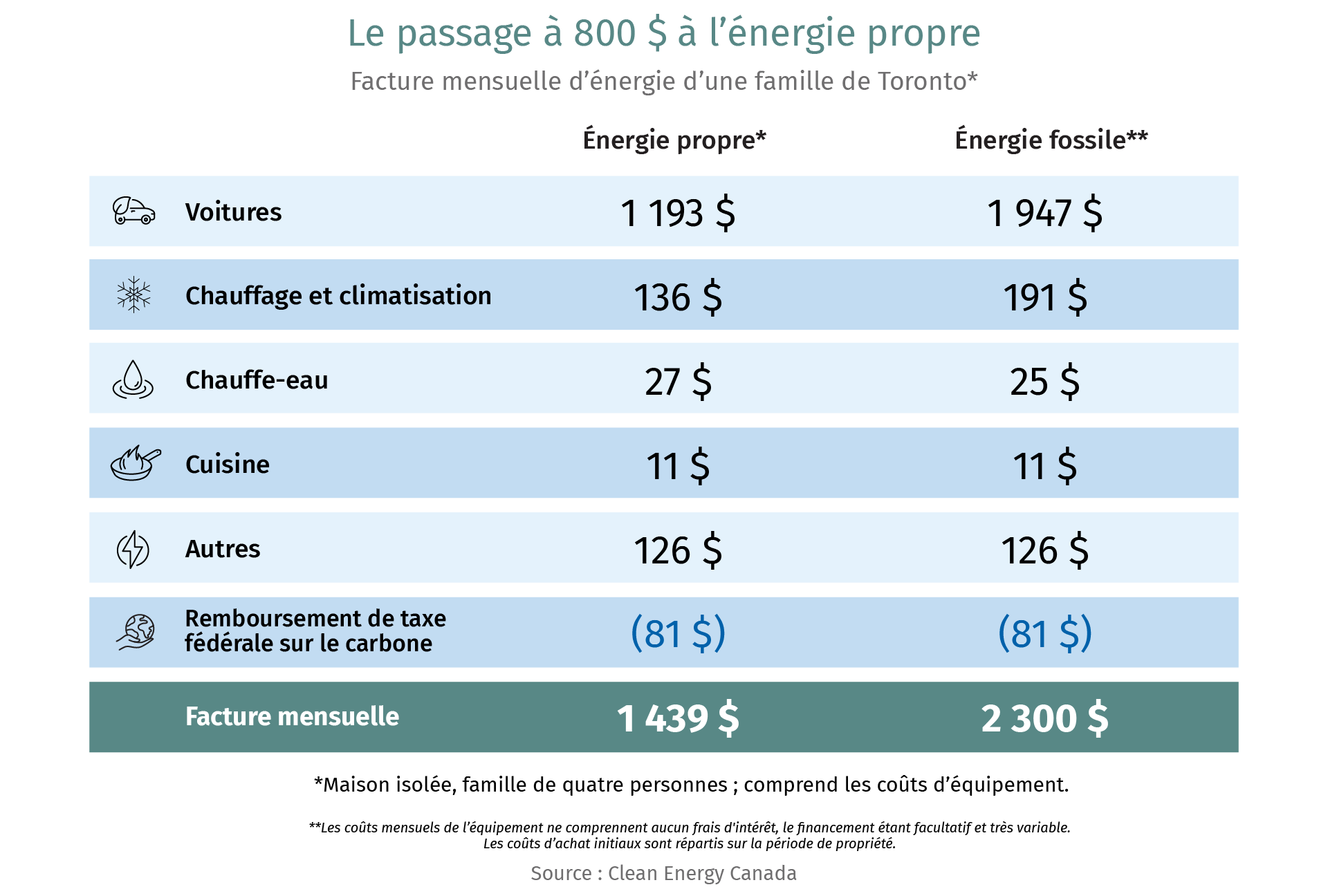
EFFICIENCE PRESQUE PARFAITE
1000 kilomètres
C’est la distance parcourue par une voiture électrique alimentée à l’énergie solaire (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) dans le désert du Sahara : une première mondiale. La plupart des voitures électriques ont une autonomie maximale de 400 kilomètres par charge. La voiture à deux places conçue par des étudiants universitaires des Pays-Bas a enregistré une efficience de 97 % dans la transformation d’énergie solaire en électricité, comparativement à 45 % pour les panneaux solaires les plus efficients.
Dans l’édition de cette semaine : Une nouvelle alliance vise à décarboner le système agroalimentaire du Canada ; les conflits ouverts pourraient ralentir la transition énergétique ; et, une climatologue aspire à la présidence du Mexique.
Éditorial
Les nouvelles frontières de l’agriculture numérique
Nous sommes à l’ère des données agricoles. Dans n’importe quelle exploitation agricole entre Penticton et l’Île-du-Prince-Édouard, il y a maintenant autant de logiciels que d’engrais. L’agriculture de précision aide les agriculteurs à stimuler leurs rendements et leurs exportations depuis une génération. Aujourd’hui, cette technologie vient soutenir la lutte contre les changements climatiques. Dans un monde fracturé, l’agriculture de l’ère numérique peut aider le Canada à produire plus d’aliments en générant moins d’émissions. Cela rejoint l’ambition de la Canadian Alliance for Net-Zero Agri-food (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) (CANZA). Cette alliance a été lancée cette semaine par les plus grandes sociétés et exploitations agricoles canadiennes dans l’objectif de réduire les émissions provenant des animaux, des déchets alimentaires, de la perturbation des sols et de la machinerie. Bien que l’agroalimentaire représente 20 % des émissions, ce secteur peut aussi agir en tant que puits de carbone à condition de récompenser les agriculteurs pour la gestion durable des terres et des animaux. Le secteur a déjà réduit l’intensité de ses émissions de 50 % en vingt ans. Et au cours des deux prochaines décennies, des pratiques respectueuses du climat pourraient lui permettre d’éliminer 150 millions de tonnes de carbone, soit l’équivalent du parc automobile du Canada.
Créée par RBC, Aliments Maple Leaf, McCain Foods, Loblaw et Nutrien, CANZA estime que les réductions d’émissions ne dériveront pas uniquement de la technologie. Changement de système. L’alliance a lancé un premier projet pilote, en Saskatchewan, dans le but de montrer comment les agriculteurs peuvent capter et stocker les émissions de gaz à effet de serre dans le sol. Les agriculteurs auront ensuite l’occasion de gagner de l’argent en vendant des crédits carbone aux transformateurs et aux détaillants de produits alimentaires, puis aux investisseurs. Mais avant tout, le Canada a besoin de définir une méthode de mesure, de déclaration et de vérification des résultats qui soit acceptable. Selon une estimation de l’Institut d’action climatique RBC (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), l’adoption d’un dispositif approprié pour mesurer, déclarer et vérifier les résultats aiderait les agriculteurs canadiens à générer au moins 2 milliards de dollars. Pour ce faire, les gouvernements devront soutenir les agriculteurs dans le développement de nouvelles méthodes de culture. Des marchés transparents et responsables seront nécessaires. Et les consommateurs devront faire preuve de plus de discernement. La clé de la réussite sera la confiance. Tous les agriculteurs le savent : si la confiance n’est pas au rendez-vous, les données sont aussi infertiles que des sols sans pluie. – John Stackhouse
Une climatologue est en lice pour présider le Mexique. Candidate à la présidentielle et actuelle maire de Mexico, Claudia Sheinbaum (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) a participé à deux des rapports marquants publiés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Parfois comparée à l’ex-chancelière allemande Angela Merkel, Mme Sheinbaum souhaite tirer parti des politiques progressistes du président sortant Andrés Manuel López Obrador à l’occasion des prochaines élections présidentielles de juin 2024. Bien que le Mexique soit producteur de pétrole, il est le seul pays du G20 à ne pas avoir fixé d’objectifs de carboneutralité.
Un organisme d’Ottawa consacré au financement des technologies vertes est montré du doigt pour ses mauvaises pratiques de gestion concernant un fonds d’un milliard de dollars. Un rapport indépendant accuse la fondation Technologies du développement durable Canada (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) d’avoir enfreint son règlement interne relatif aux conflits d’intérêts et à la gestion financière, dans le cadre des subventions accordées aux sociétés pour développer et déployer des technologies durables. C’est un coup porté au financement de la lutte contre les changements climatiques au Canada, à un moment où il est urgent et coûteux de construire des infrastructures d’énergies propres.
Lors d’un sommet perçu comme une répétition générale de la COP28, les dirigeants de l’OPEP ont plaidé en faveur du pétrole et du gaz. À l’occasion de la Semaine du climat du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord organisée par l’ONU à Riyad, les dirigeants de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et de l’Irak (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) ont déclaré que le monde avait besoin de ressources en hydrocarbures pour assurer une transition « à un prix responsable ». L’entreprise d’État détenue par le gouvernement des Émirats arabes unis fait partie des 20 sociétés du secteur des combustibles fossiles proposant une alliance mondiale pour la décarbonation, dont l’objectif est de parvenir à la carboneutralité d’ici 2050.
L’application Floodhub de Google pourrait servir d’alerte. Cet outil utilise des milliers d’images satellites pour construire un modèle numérique capable de prédire les inondations (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) de deux à sept jours à l’avance, ce qui donnerait suffisamment de temps pour planifier une évacuation en urgence. La société mère Alphabet a déjà déployé le service dans 20 pays et 60 de plus sont attendus cette année, ce qui inclut certaines régions du Canada et des États-Unis.
POLITIQUE PUBLIQUE
Conflits ouverts, un frein à la lutte mondiale contre les changements climatiques
Le monde se prépare à un deuxième conflit majeur. Le conflit entre Israël et le Hamas intensifie les tensions sur le marché mondial de l’énergie, alors que l’économie mondiale souffre encore des répercussions de l’invasion russe en Ukraine. La situation pourrait s’aggraver : le secrétaire au Trésor des États-Unis a averti l’Iran, qui entretient d’étroites relations avec le Hamas, qu’aucune éventualité n’est écartée s’il s’avère que Téhéran a des liens avec les attaques de militants contre Israël cette semaine. Les prix du pétrole s’agitent.
La hausse des prix sape déjà le moral des sociétés et retarde les investissements indispensables à la transition énergétique. Les dernières données de l’indice de confiance des entreprises de l’OCDE montrent que la confiance a chuté à des niveaux jamais vus depuis août 2020, alors que la pandémie plongeait le monde dans une profonde paralysie. Ce résultat fait écho aux opinions émises par 57 % des dirigeants de sociétés lors du sondage d’Eurasia Group-Deloitte réalisé cet été. Selon eux, leurs activités pourraient être perturbées par des éléments géopolitiques au cours de la prochaine année.
Les risques menaçant la transition énergétique sont évidents. Les divisions géopolitiques figurent parmi les risques majeurs (au même titre que les phénomènes météorologiques extrêmes) qui peuvent conduire à une « fragmentation » des marchandises (énergie, métaux, et chaînes logistiques des technologies propres) tout en augmentant le coût de la décarbonation, a averti le Fonds monétaire international (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) dans ses dernières perspectives mondiales.
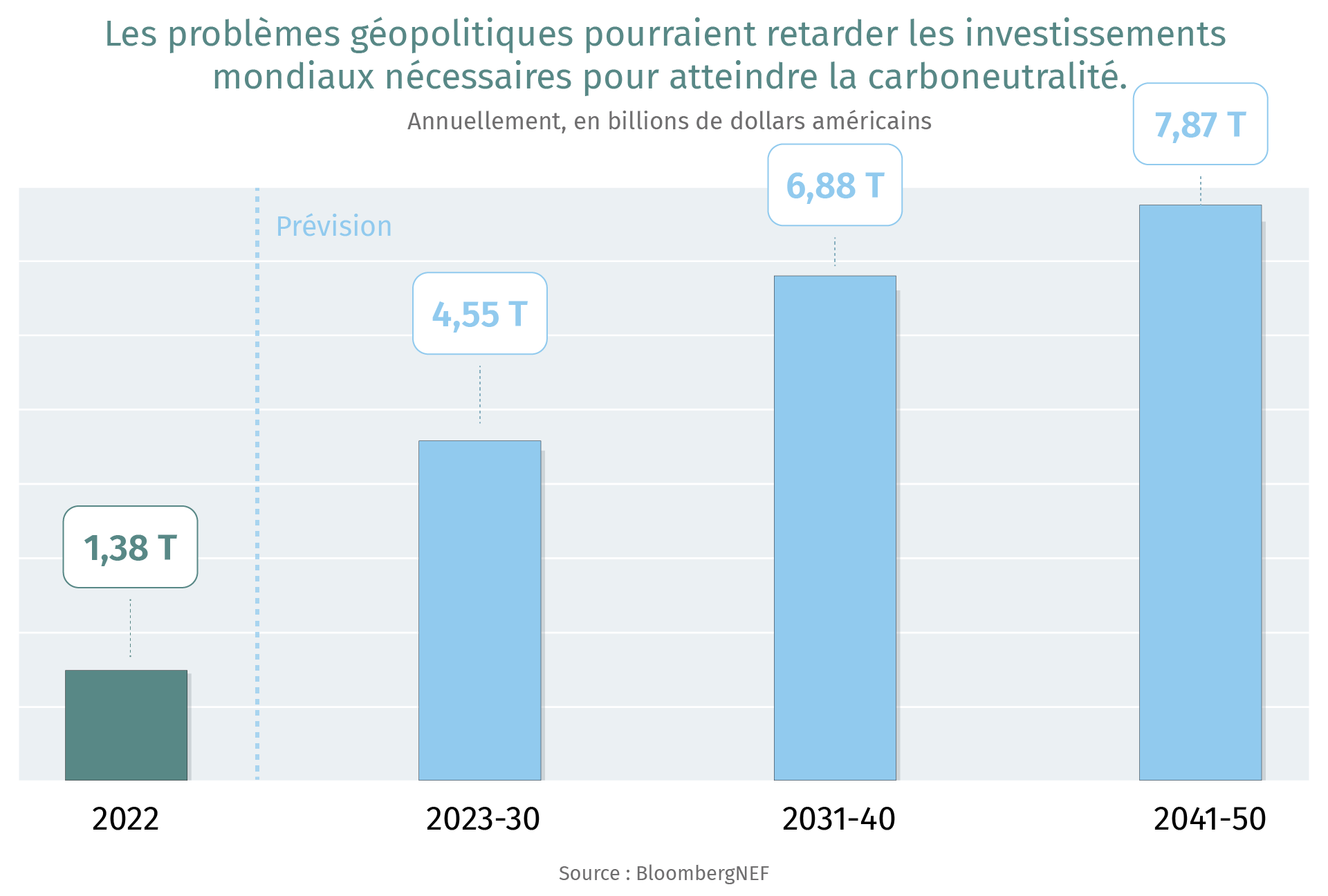
Selon les prévisions du FMI, « un monde fragmenté serait plus volatil », au risque de faire grimper les prix des aliments et des marchandises tout en augmentant le coût de la décarbonation.
La hausse des prix de l’énergie a refroidi les consommateurs à l’égard des politiques susceptibles de gonfler davantage les prix de l’énergie. Le gouvernement conservateur du Royaume-Uni bat en retraite sur le front des objectifs climatiques, tandis que le mécontentement au sujet du Pacte vert pour l’Europe (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) prend de l’ampleur dans le pays. Un nouveau sondage mené auprès des consommateurs européens révèle que les inquiétudes concernant la hausse des prix de l’énergie prennent le dessus sur les préoccupations relatives à l’environnement et aux changements climatiques, pour la première fois depuis des années.
Pour ajouter à la tourmente, les gestionnaires de portefeuille ont abandonné les fonds pour l’énergie renouvelable à une vitesse record entre juillet et septembre, au moment où les taux d’intérêt élevés et la flambée des coûts des matériaux réduisaient les marges bénéficiaires pour les sociétés de technologies propres. Le total des actifs sous gestion s’élève maintenant à 65,4 milliards de dollars américains, ce qui marque un déclin de 23 % par rapport à juin, selon les données de LSEG Lipper (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) C’est un coup dur pour un segment qui a bien du mal à gagner du terrain et ne représente que 0,14 % de tous les actifs des fonds d’investissement (ce contenu est disponible en anglais seulement)
Les décideurs politiques et les dirigeants d’entreprises ont à peine sept années devant eux pour réduire les émissions de 45 % d’ici 2030 comme l’exige l’Accord de Paris. Malheureusement, ils doivent faire face à des situations d’urgence et aux profondes répercussions de la situation géopolitique sur leurs activités. Sauront-ils corriger le tir à temps pour atteindre les objectifs de 2030?
GRAPHIQUE DE LA SEMAINE
Le crépitant mois de septembre annonce l’année la plus chaude jamais enregistrée
Les températures exceptionnelles relevées à terre et en mer sont de mauvais augure en ce qui concerne la vitesse à laquelle les gaz à effet de serre changent le climat, selon les dernières données du Service Copernicus concernant le changement climatique (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) mis en place dans l’Union européenne (C3S). L’ONU prévoit que ces températures record se maintiendront pendant plusieurs mois, « avec des effets en cascade sur notre environnement et notre société ».
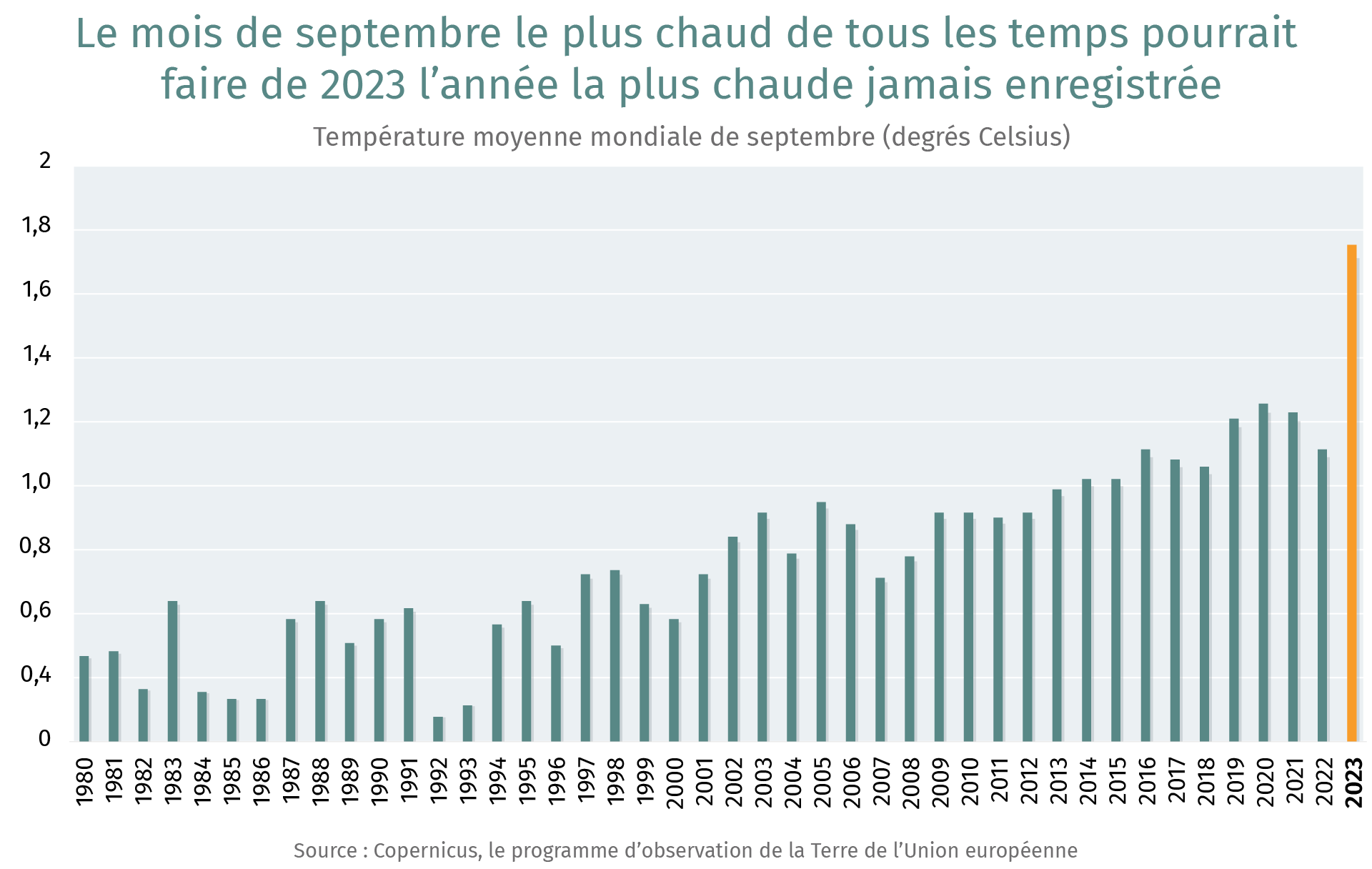
ZÉRO ÉMISSION NETTE
16 millions de dollars US
Ce que coûtent les phénomènes météorologiques extrêmes à l’économie mondiale toutes les heures, selon une étude (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), publiée par le journal scientifique Nature. Des chercheurs d’une université néo-zélandaise affirment que leur modélisation pourrait être utilisée pour calculer le financement nécessaire au Mécanisme de financement pour les pertes et dommages (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) mis en place par l’ONU au bénéfice des pays pauvres.
Dans l’édition de cette semaine : Pourquoi Bill Gates, le fameux milliardaire et auteur du livre Climat : comment éviter un désastre n’est pas un amoureux des arbres ; l’Alberta se prépare à lutter contre deux politiques climatiques d’Ottawa ; comment les agriculteurs canadiens peuvent profiter d’un marché du carbone évalué à 4 milliards de dollars.
Planter des arbres pour combattre le changement climatique est une « absurdité totale », selon Bill Gates. « Sommes-nous des scientifiques ou sommes-nous des idiots ? », a sèchement déclaré le fondateur de Microsoftlors d’un sommet à New York la semaine dernière. La diatribe anti-arbres de Bill Gates va à l’encontre de la course effrénée menée dans le monde pour planter des milliards d’arbres sur une surface plus grande que la taille des États-Unis. Cet argument peut se discuter. L’année dernière, une étude australienne a averti qu’une plantation d’arbres excessive pourrait engloutir les terres dont nous avons désespérément besoin pour produire des aliments et protéger la nature.
Les investissements dans les énergies renouvelables pourraient baisser de 30 % d’ici 2030 si les restrictions commerciales persistent. Les frictions géopolitiques pourraient ralentir le commerce des marchandises essentielles à la transition énergétique, a averti le Fonds monétaire international dans ses dernières Perspectives de l’économie mondiale. Si la coopération entre les pays reste incertaine, les décideurs partageant le même état d’esprit devront mettre en place des « corridors écologiques » pour soutenir la transition énergétique, selon le Fonds.
Les préoccupations climatiques ont pris le pas sur la sécurité énergétique en Irlande. Le premier organisme de planification de Dublin a rejeté un projet visant à construire un important terminal de gaz naturel liquéfié dans le cadre d’une action sur le climat. Le rejet d’un projet lié aux combustibles fossiles est plutôt inhabituel, à un moment où l’Irlande, comme de nombreux importateurs d’énergie en Europe, fait face à un grave défi en matière de sécurité énergétique.
La transition énergétique a dominé la liste des meilleurs livres d’affaires de l’année selon le Financial Times. Material World : A Substantial Story of Our Past and Future, par Ed Conway, souligne les risques environnementaux associés au secteur minier alors que la planète est engagée dans une voie plus durable. Cobalt Red : How the Blood of the Congo Powers Our Lives, par Siddharth Kara, passe à la loupe les atteintes aux droits de la personne qui entachent l’exploitation du cobalt, un composant essentiel des technologies propres. La biographie de Walter Isaacson, par le fondateur anticonformiste de Tesla Elon Musk, a également fait sensation.
POLITIQUE PUBLIQUE
Alerte de pannes d’électricité
L’Alberta s’apprête à monter au front contre deux politiques climatiques phares d’Ottawa : le Règlement sur l’électricité propre, et l’imminent plafonnement des émissions du secteur pétrolier et gazier.
La semaine dernière, l’Alberta Electric System Operator (AESO) a averti que la province pourrait subir des pannes d’électricité si elle poursuit sur la voie du Règlement sur l’électricité propre. Selon l’AESO, la province ne dispose pas de ressources suffisantes pour assurer une production d’électricité fiable jusqu’en 2030, et la mise hors service de ses actifs de production d’électricité poserait problème si elle se pliait entièrement à l’avant-projet de règlement. En effet, les enjeux de fiabilité et de coûts liés à l’objectif du Règlement sur l’électricité propre pour 2035 pourraient « mettre en péril » le parcours vers l’électrification dans les secteurs difficiles à modérer comme le pétrole et le gaz, le ciment minier et la pétrochimie, a indiqué l’exploitant indépendant. Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, a qualifié l’avertissement de pannes d’électricité de l’AESO de « désinformation », tandis que le célèbre économiste de Calgary, Blake Shaffer, a demandé à AESO de fournir des précisions sur ses travaux et hypothèses de modélisation.
Cela dit, les lignes de front sont établies. Danielle Smith, première ministre de l’Alberta, prépare une loi sur la souveraineté afin de défendre les intérêts économiques de la province contre ce qu’elle considère comme une ingérence du gouvernement fédéral. Cette loi aiderait également l’Alberta à contourner les plafonds d’émissions du secteur pétrolier et gazier que Mme Smith juge « inconstitutionnels. » Ottawa compte publier cette année un projet de plafonnement des émissions qui obligerait le secteur pétrolier et gazier à réduire ses émissions de 42 % par rapport aux niveaux de 2019 d’ici 2030. Par ailleurs, le gouvernement de l’Alberta a imposé un moratoire sur les projets d’énergie renouvelable, ce qui a jeté un froid dans son bouillonnant secteur des technologies propres.
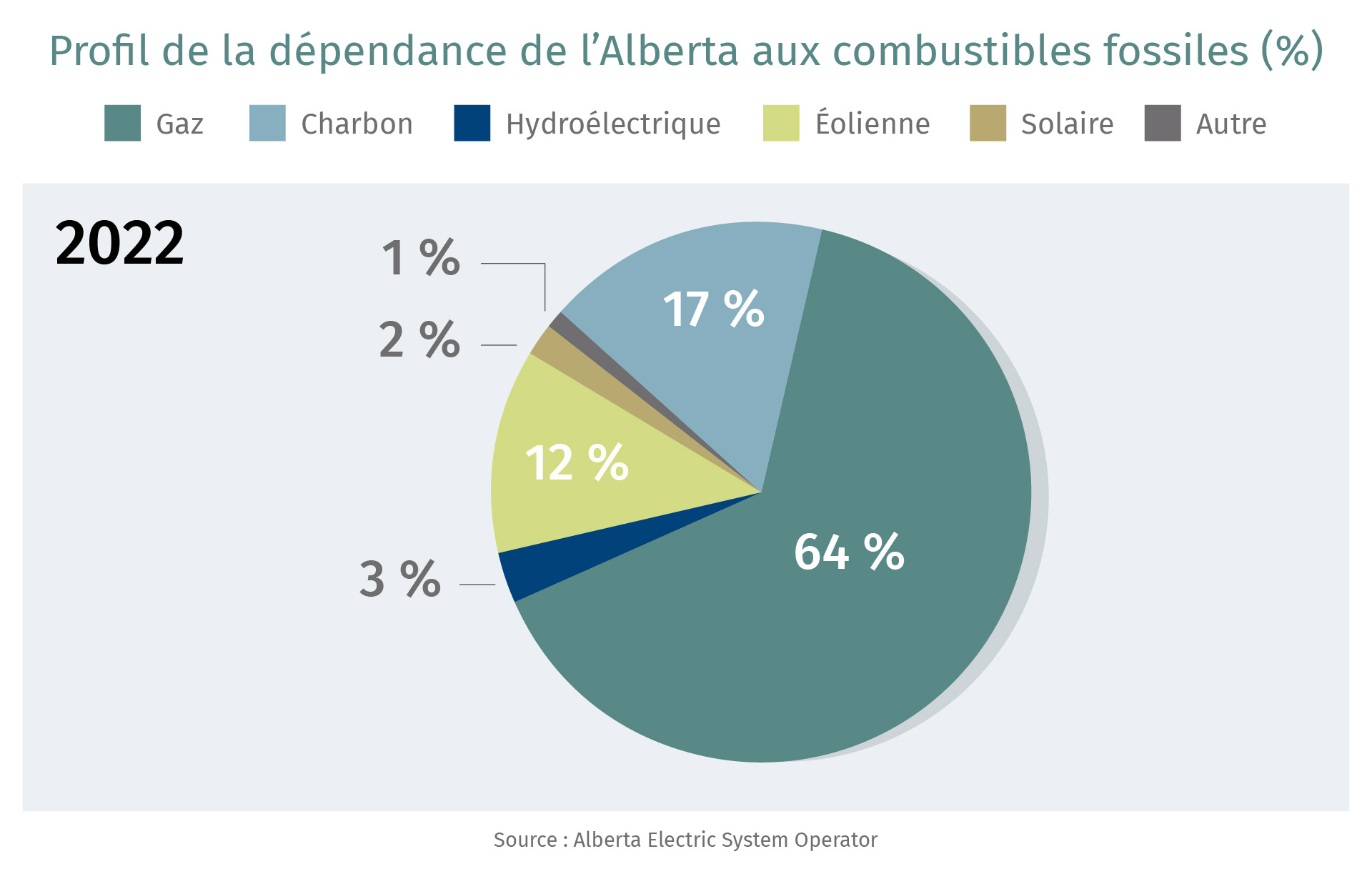
Les mesures prises par Edmonton arrivent à un moment où un sondage de Research Corévèle que 62 % des Albertains sont en faveur d’un plafonnement des émissions du secteur pétrolier et gazier, tandis qu’un autre sondage de Leger suggère que 57 % « sont au moins plutôt en faveur ».
Au-delà de la confrontation publique, l’Alberta et Ottawa ont beaucoup à faire pour collaborer, notamment pour appuyer le mégaprojet de captage, d’utilisation et de stockage de sables bitumineux de Pathways Alliance qui pourrait réduire considérablement les émissions du Canada.
Graphique de la semaine
Augmentations des investissements en technologies propres au Canada
Les investissements dans l’hydrogène et les piles à combustible ont stimulé les dépenses dans les technologies propres au Canada. Selon les dernières données de Statistique Canada, en 2021, les dépenses de recherche et développement (R-D) des sociétés consacrées aux technologies propres ont représenté 2,3 $ pour chaque dollar de dépenses de R-D consacré aux combustibles fossiles.
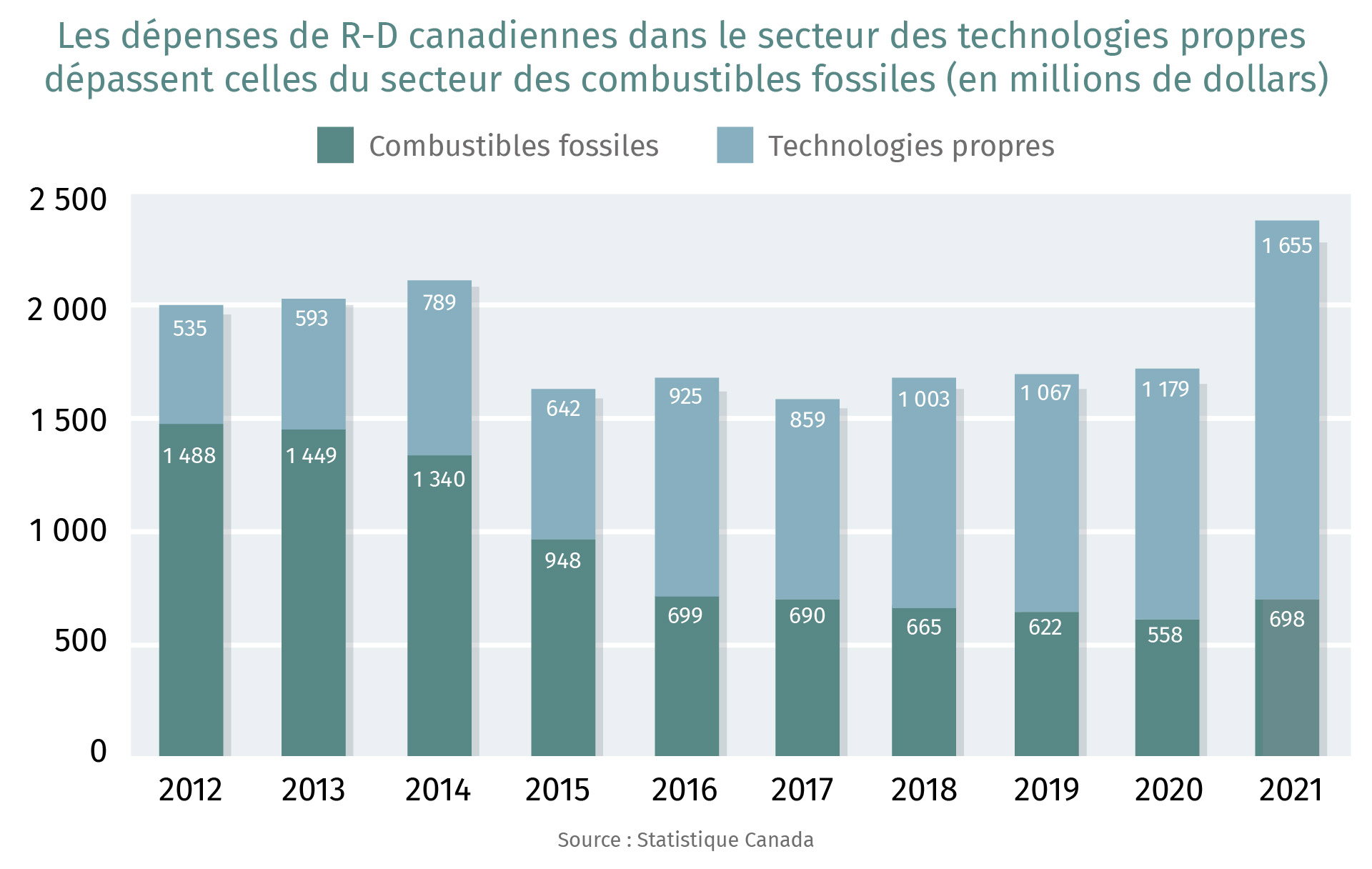
Agriculture
Le marché du carbone pèse 4 milliards de dollars
Les terres agricoles actives du Canada agissent comme un puissant puits de carbone capable de séquestrer de 35 à 38 millions de tonnes de carbone d’ici 2050. Cela représente de 40 % à 45 % des émissions annuelles actuelles des sables bitumineux.
Si le Canada adoptait une politique efficace, ses marchés volontaires du carbone pourraient se transformer en un colosse de 4 milliards de dollars d’ici 2050, selon le rapport Nouveau pacte agricole : un plan en neuf points pour une agriculture adaptée au climat, une nouvelle publication de l’Institut d’action climatique RBC. Un marché actif pourrait se traduire par de nouveaux flux de revenus pour certains exploitants, bien au-delà d’un million de dollars pour les opérateurs d’envergure.
Étant donné que les producteurs alimentaires des États-Unis, de l’Union européenne, de l’Australie et de la Chine reçoivent déjà un financement environ trois fois plus élevé pour la lutte contre les changements climatiques que ce que le Canada accorde à son secteur, le rapport affirme que nous pourrions prendre du retard par rapport à nos pairs.
Cependant, un marché du carbone ne peut prospérer sans un robuste système de mesure et de déclaration du carbone des sols et des émissions, ce qui fait actuellement défaut au Canada. Le rapport Nouveau pacte agricole propose des moyens de créer un marché dynamique grâce à un robuste dispositif de mesure, de déclaration et de vérification. Les investissements du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux sont grandement nécessaires pour améliorer la collecte de données et établir des références d’émissions actuelles et futures, à la hauteur des 300 millions de dollars investis par les États-Unis dans leur infrastructure de mesure, de déclaration et de vérification.
La mise en place d’un solide marché du carbone figure parmi les neuf recommandations politiques du rapport qui visent à propulser le secteur agricole canadien à l’avant-garde de la prochaine révolution verte tout en lui donnant les moyens d’affronter la concurrence mondiale.
Cela va être nécessaire. Les secteurs agricoles des États-Unis, de l’Union européenne, de l’Australie et de la Chine reçoivent un financement environ trois fois plus élevé pour la lutte contre les changements climatiques que ce que le Canada accorde à son secteur. Pourtant, les attentes à l’endroit de nos agriculteurs continuent de croître : produire plus (dans des conditions météorologiques de plus en plus défavorables), réduire les émissions et contribuer à assurer la sécurité alimentaire mondiale. Selon le rapport, le moment est venu pour les gouvernements canadiens d’intensifier leurs engagements et de mettre en place des politiques rigoureuses qui prennent en compte le potentiel économique du secteur, son rôle d’exportateur de produits alimentaires d’envergure mondiale, et sa position de chef de file dans l’agriculture adaptée au climat.
Lisez les neuf recommandations politiques ici.
Zéro émission nette
40 millions de tonnes
C’est l’estimation du gisement de lithium récemment découvert le long de la frontière entre le Nevada et l’Oregon. Ce chiffre représente près du double des gisements des plaines salines de la Bolivie, qui sont actuellement les plus grandes réserves connues au monde. Si l’information est validée, cette découverte dissiperait les craintes des États-Unis à l’égard de leur approvisionnement en lithium, alors qu’ils s’efforcent de renforcer leur chaîne logistique dans le secteur des véhicules électriques.
Une nouvelle victoire pour le Québec : avec l’implantation d’un autre grand nom des technologies propres, la province devient un pôle manufacturier pour les véhicules électriques. Northvolt AB, fabricant suédois de batteries, (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) a choisi Saint-Basile-le-Grand dans le sud-ouest du Québec pour y construire une usine de production de batteries pour véhicules électriques, d’un montant de 7 milliards de dollars US. Soutenu par les gouvernements fédéral et provincial, il s’agit du plus important investissement du secteur privé jamais réalisé au Québec. La province s’est démarquée des autres territoires nord-américains en lice grâce à son hydroélectricité propre et bon marché (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) L’Ontario devrait en prendre note
ACTION SUR LE CLIMAT
La Californie compte les émissions. Vous pouvez quitter le Golden State (350 grandes entreprises ont quitté la Californie au cours des trois dernières années), mais vous devez toujours rendre des comptes sur vos émissions. Le Sénat de la Californie a adopté ce mois-ci une loi qui oblige les entreprises dépassant une certaine taille et exerçant des activités dans l’État à publier leurs émissions de CO2. Les informations à divulguer comprennent les émissions de leurs fournisseurs, de leurs clients, de leurs contractuels et même celles des trajets entre le domicile et le lieu de travail de leurs employés. La Californie poursuit également en justice les grandes sociétés pétrolières et les accuse de « tromperie » sur les risques pour le climat.
Faites attention à votre communication sur le climat. De nouvelles règles de l’UE interdiront les allégations environnementales infondées sur les produits de consommation. Des expressions clés telles que « produit vert », « ami de la nature », « respectueux de l’environnement », « écologique », « neutre pour le climat », « biodégradable » et « économe en énergie » sont visées, l’objectif de l’UE étant de limiter les allégations vagues de durabilité dans le secteur de la consommation. Ces changements entreront en vigueur d’ici 2026.
Lego ne peut pas se passer de pétrole. Il y a deux ans, le fabricant danois de jouets en briques s’était engagé à remplacer le plastique issu du pétrole par le plastique de bouteilles recyclées. Cependant, Lego a finalement découvert que l’utilisation du polyéthylène téréphtalate recyclé (RPET) augmenterait ses émissions de carbone au cours de la durée de vie du produit. Il a également été difficile de reproduire la « force d’assemblage » des briques, autrement dit la facilité avec laquelle on peut les assembler et les séparer, avec des composants alternatifs. La société essaie de réduire son bilan carbone par d’autres moyens.
Sondage sur le climat : Environ 40 % des Canadiens sont prêts à agir contre les changements climatiques, même si cela implique un coût financier, selon un nouveau sondage de Léger. L’enquête menée auprès de 1 500 Canadiens révèle que près des trois quarts des répondants estiment que les changements climatiques sont responsables des intempéries extrêmes, et 65 % d’entre eux pensent que leur fréquence augmentera à l’avenir.
TRANSPORTS
Se préparer à la fin de l’ère du moteur à combustion interne
La loi sur la réduction de l’inflation de Joe Biden, une loi qui vise à réduire les émissions de GES, fait l’objet d’un grand test au Michigan. Le secteur américain de l’automobile s’engage à investir au global 210 milliards de dollars US dans la mise en place d’une chaîne logistique pour les véhicules électriques en Amérique du Nord. Toutefois, les ouvriers de trois constructeurs automobiles américains sont en grève, car ils craignent de perdre leurs emplois avec la fin programmée de la vente des véhicules à moteur à combustion interne.
Le syndicat des Travailleurs unis de l’automobile cherche à accroître les salaires et la sécurité de l’emploi dans un contexte où Ford, General Motors et Stellantis entament une transition générationnelle vers les véhicules électriques (VE). En signe de soutien, Joe Biden s’est même rendu sur un piquet de grève.
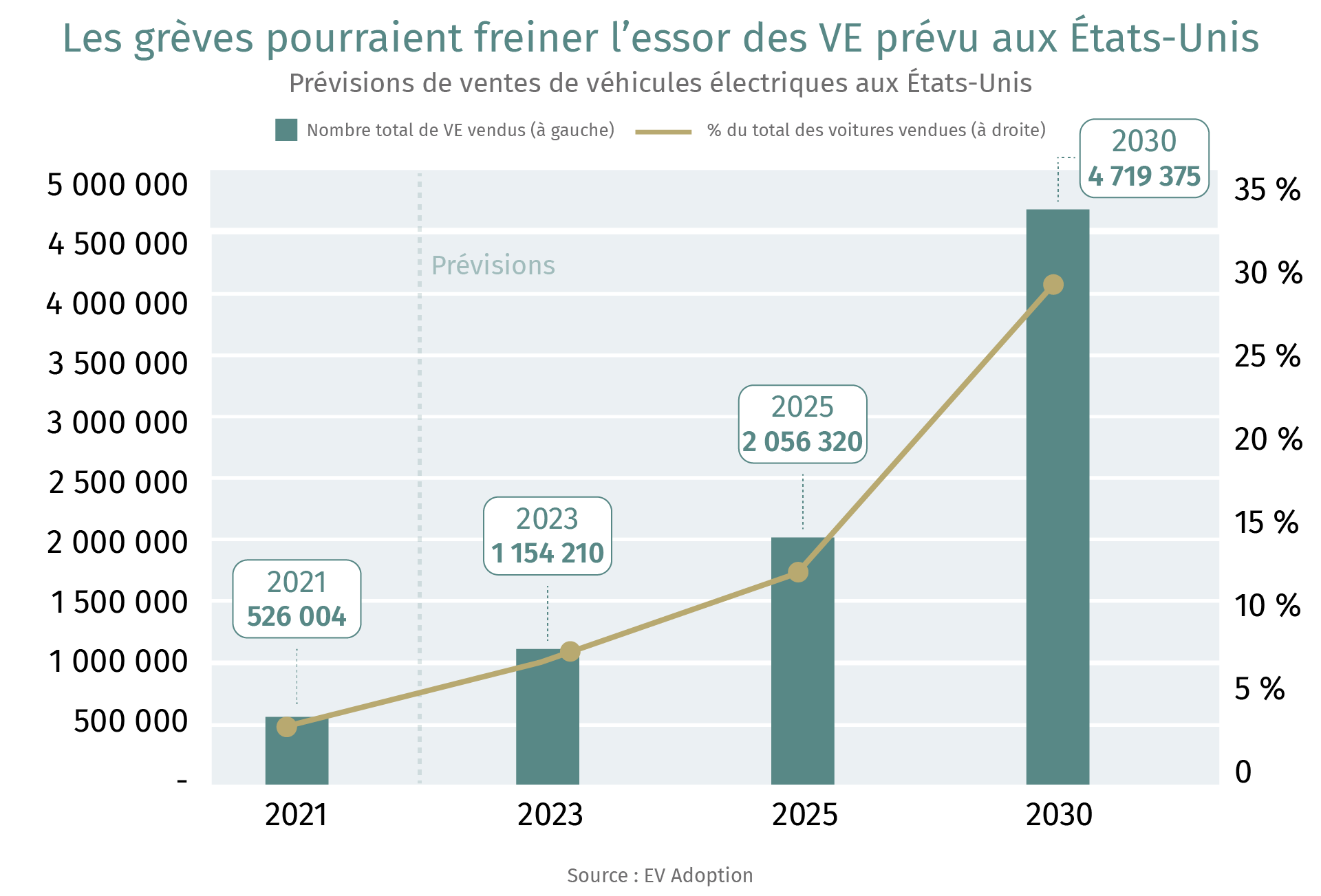
La plus grande préoccupation non pécuniaire du syndicat ? Les licenciements massifs, étant donné que les véhicules alimentés par batterie ne nécessitent pas de lignes d’assemblage de silencieux, de convertisseurs catalytiques et d’injecteurs de carburant, qui exigent beaucoup de main-d’œuvre. L’Organisation internationale du Travail définit une « transition juste » comme suit : s’assurer que la transition vers une économie plus verte crée des « occasions de travail décent » et ne laisse personne de côté.
Mis en difficulté par les réductions de prix de Tesla, le leader des VE, qui n’a pas de syndicat, les trois grands constructeurs automobiles contre-attaquent. Les exigences du syndicat « forceraient Ford à abandonner ses investissements dans les véhicules électriques », a averti Jim Farley, le PDG de Ford. Dans un contexte de pressions financières dues aux grèves, Ford a déjà suspendu ses projets de construction d’une usine de batteries pour VE de 3,5 milliards de dollars US au Michigan.
Une grève prolongée pourrait ralentir les ventes de VE, qui représentent désormais 7 % des ventes de voitures aux États-Unis et devraient dépasser le nombre record d’un million d’unités vendues cette année. Même si les stocks de VE sont pour l’instant suffisants, une grève prolongée pourrait augmenter les coûts et les délais de déploiement des véhicules électriques à un moment où les trois grands constructeurs automobiles cherchent à gagner des parts sur ce marché.
Compte tenu de l’intégration du secteur automobile en Amérique du Nord, les temps d’arrêt dans les usines américaines auraient probablement aussi des répercussions sur la chaîne logistique automobile au Canada. Le Canada a évité une crise en instaurant une « transition juste » : Ford et le syndicat Unifor ont ratifié un contrat de trois ans prévoyant les augmentations salariales les plus élevées de l’histoire des négociations automobiles du pays. Gain tout aussi crucial, ce contrat « offre des protections pendant la transition [vers les véhicules électriques] », a affirmé Lana Payne, la présidente d’Unifor.
Le secteur automobile, reconnu pour sa gestion de production fondée sur le juste à temps, devra réussir sa transition.
GRAPHIQUE DE LA SEMAINE
La menace du méthane
La réduction des émissions de méthane est le prochain grand défi climatique du Canada. Tel était le message du premier ministre Justin Trudeau lors du Sommet sur l’ambition climatique des Nations Unies, la semaine dernière. Selon le premier ministre, Ottawa travaille à l’élaboration de nouvelles règles attendues d’ici la fin de l’année, qui permettront au Canada d’atteindre plus rapidement ses objectifs de réduction de ses émissions de méthane provenant du secteur pétrolier et gazier de 75 % par rapport aux niveaux de 2012 d’ici 2030. Le méthane est considéré comme 86 fois plus nocif que le dioxyde de carbone sur une période de 20 ans. Bien que l’agriculture demeure une source importante d’émissions de méthane, les projections gouvernementales montrent que les acteurs du secteur pétrolier et gazier devront accomplir la majeure partie des efforts de réduction au cours des sept prochaines années.
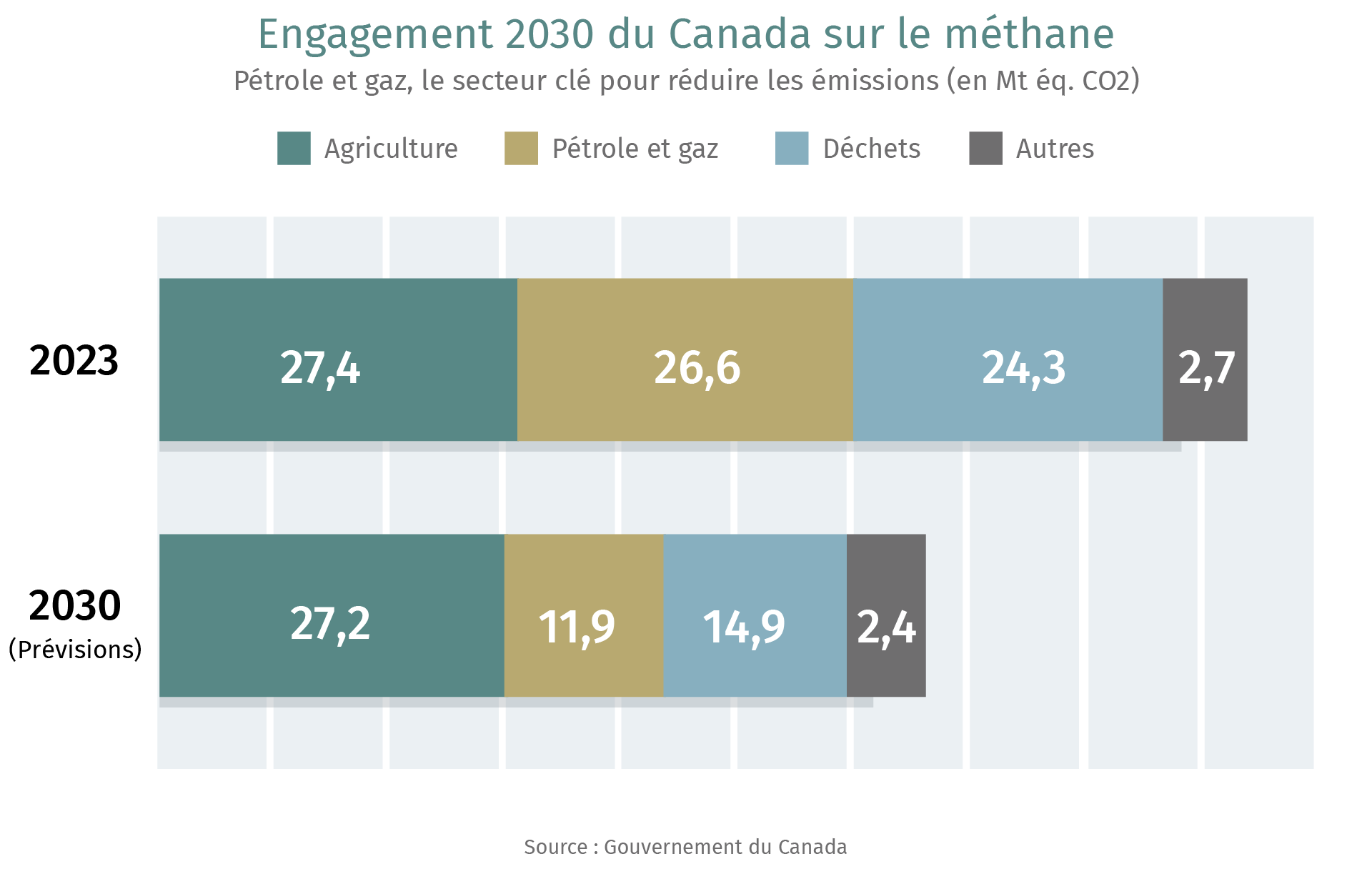
COP28
Des divergences importantes sur l’énergie
Les divergences entre les grandes puissances énergétiques s’accentuent. C’est le constat évident qui a été fait la semaine dernière lorsque certains leaders de l’action climatique internationale ont appelé à une transition rapide vers les énergies renouvelables lors de l’Assemblée générale des Nations Unies et de la Semaine du climat à New York. Parallèlement, les principaux producteurs d’énergie, y compris les Saoudiens, ont choisi un événement international sur le pétrole à Calgary pour avertir des conséquences d’un abandon prématuré du pétrole et du gaz.
Au milieu de ces tensions, le nouveau rapport « Net Zero Roadmap : A Global Pathway to Keep the 1.5 oC Goal in Reach » de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) exhorte à intensifier les efforts de décarbonation.
Selon l’agence rattachée à l’OCDE, il faudrait tripler la capacité d’énergie renouvelable installée d’ici 2030 et doubler le taux annuel d’amélioration de l’intensité énergétique pour réduire les émissions et la demande de combustibles fossiles.
Un montant record de 1 800 milliards de dollars US sera investi dans les énergies propres cette année. Ce montant est toutefois insuffisant : les investissements dans les énergies renouvelables doivent atteindre 4 500 milliards de dollars US par an d’ici le début des années 2030 pour réaliser le scénario zéro émission nette prévu par l’AIE.
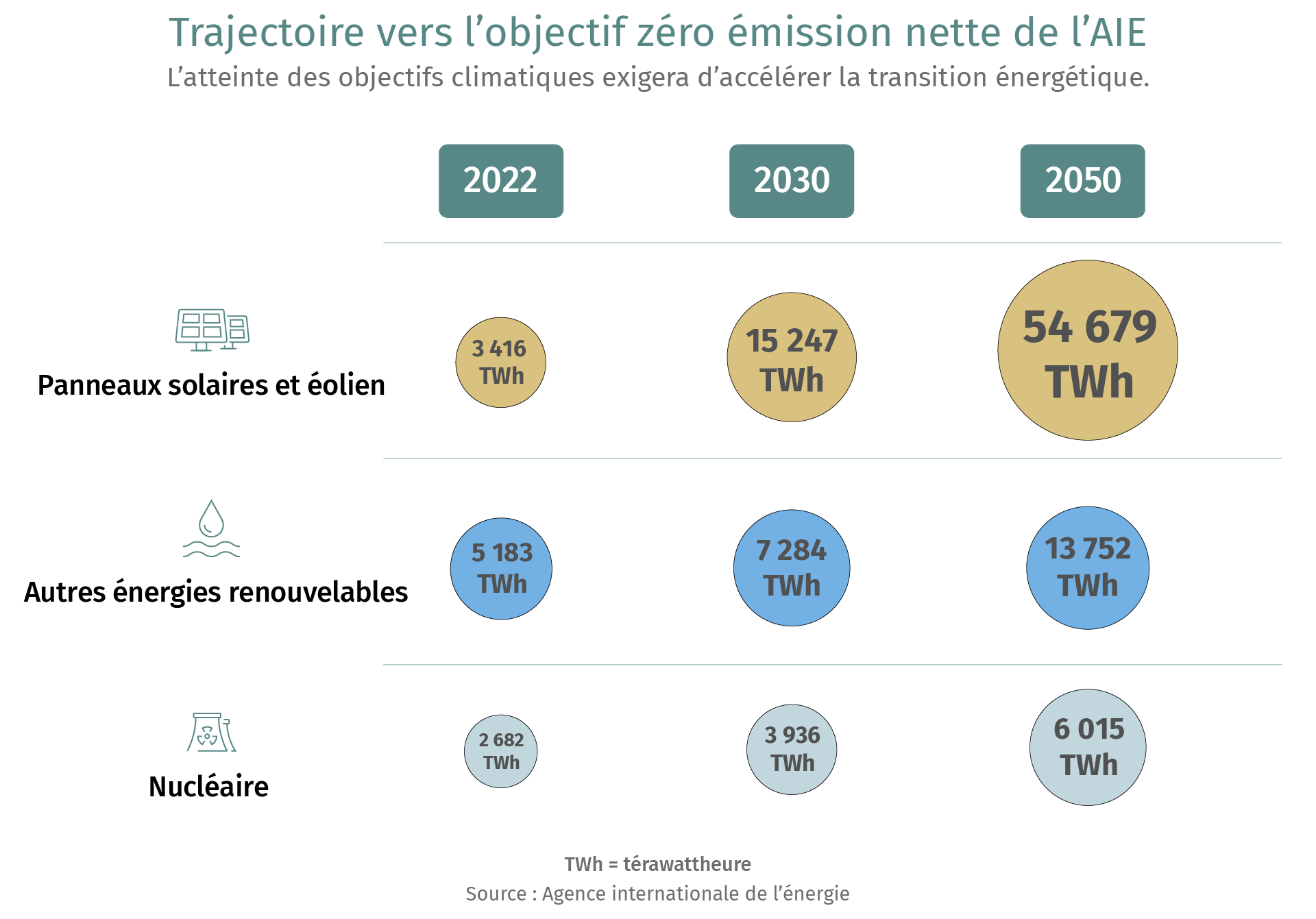
Selon l’AIE, le monde dispose des outils pour augmenter encore plus rapidement la part des énergies renouvelables. Des politiques bien pensées qui mettent l’accent sur l’efficacité et le développement des énergies renouvelables sont essentielles pour réduire la demande de combustibles fossiles de 25 % d’ici 2030, dans le scénario climatique le plus ambitieux de l’AIE (scénario zéro émission nette d’ici 2050).
Le nouveau rapport de l’AIE donne un aperçu de son rapport emblématique World Energy Outlook attendu en octobre, qui devrait prévoir un pic de la demande de combustibles fossiles d’ici 2030.
Le décalage entre les projections de l’AIE et ce que les sociétés du secteur de l’énergie observent sur le marché pourrait ralentir les flux d’investissement dans diverses sources d’énergie à un moment où « urgence, capacité d’agir et équité » sont les maîtres mots pour lutter contre les changements climatiques.
Ces deux rapports devraient être des points de discussion importants lors de la COP28 à Dubaï, aux Émirats arabes unis, en novembre.
ZÉRO ÉMISSION NETTE
2,1%
C’est l’augmentation des émissions totales du Canada en 2022 par rapport à l’année précédente, selon les premières estimations des émissions nationales. Néanmoins, les émissions étaient inférieures de 6,3 % aux niveaux de 2005, ce qui montre que le Canada a réalisé quelques progrès vers l’atteinte de sa cible de réduction de ses émissions de 40 % à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030.
Le monde semble un peu démotivé, et voudrait voir beaucoup plus d’action en faveur du climat. La semaine du climat de New York vient de s’achever. L’impression générale est que les nobles aspirations, orientées vers des plans concrets et un accent sur les 12 prochains mois plutôt que les 12 prochaines années, sont passées à la trappe. La semaine du climat s’articule autour de l’Assemblée générale des Nations Unies où se réunissent les dirigeants du monde une fois par an. À cette occasion, toute une diversité de personnalités telles que des dirigeants de sociétés (Bill Gates), des célébrités (Bono) et des agitateurs (Al Gore) se rencontrent à Manhattan – au prix de grands embouteillages. (L’événement donne lieu à des cortèges de VUS qui font la navette entre les hôtels, accompagnés d’escortes policières). J’ai eu l’occasion de me réunir avec des représentants gouvernementaux, des capitaines d’industrie et des écologistes demandant à l’unisson plus d’action, de toute urgence et avec moins de discours. Comme quelqu’un l’a fait remarquer, nous avons déjà parcouru un tiers de la « décennie décisive » et sommes loin d’avoir réalisé un tiers de ce que nous devions accomplir dans les années 2020.

Le magnifique soleil de septembre n’a pas réussi à dissiper les nuages politiques entourant l’ONU. Joe Biden a participé. Cependant, il n’a échappé à personne qu’il s’agissait probablement de sa dernière Assemblée générale, puisque l’élection présidentielle américaine de 2024 battra son plein en septembre prochain. Les grands projets de Biden pour financer la lutte contre les changements climatiques pèseront dans la balance des votes, tout comme sa campagne pour la révolution des véhicules électriques.
Bon nombre de pays influents – la Grande-Bretagne, la France, la Chine, l’Inde – ont fait profil bas, car leurs gouvernements se sont recentrés sur la sécurité énergétique au détriment de la lutte contre les changements climatiques Tout ce qui pourrait entraîner davantage de pénuries d’énergie – et donc plus d’inflation et des taux d’intérêt plus élevés – figure sur les radars politiques. Alors que le pétrole brut se dirigeait vers 100 dollars US le baril, j’ai rencontré de grands producteurs de pétrole et de gaz qui semblaient s’apprêter à produire plus, et pas moins. Même les pays qui essaient de se débarrasser du charbon – l’Allemagne, l’Indonésie, le Vietnam – m’ont avoué que c’était plus difficile et plus coûteux que prévu. Et ils ne veulent pas facturer un centime de ce programme aux citoyens. Certains représentants politiques ont laissé entendre, en privé, que nous avons besoin de plus de réglementations, et non moins, pour réduire les émissions. Mais alors que j’allais rentrer chez moi, je me suis demandé si tous ces conducteurs, dehors, étaient prêts à accepter de telles mesures, que ce soit à la pompe à essence ou dans les scrutins. – John Stackhouse
LES PETITES PHRASES DU SOMMET
Infléchir la tendance
Les petites phrases ont volé, lors des événements de l’ONU et de la semaine du climat de New York, alors que les conférenciers essayaient de démontrer l’ampleur de l’enjeu climatique que nous avons entre les mains. Mais le thème sous-jacent était le même : nous sommes à un moment charnière et devons redoubler d’efforts pour faire face aux crises.
Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, au Sommet sur l’ambition climatique de l’ONU : « L’humanité a ouvert les portes de l’enfer (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) … Si rien ne change, nous allons vers une augmentation de la température de 2,8 degrés – c’est-à-dire un monde dangereux et instable. Mais l’avenir n’est pas figé. Ce sont les dirigeants comme vous qui peuvent l’écrire. »
Jim Skea, président du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). « Les politiques climatiques (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) ont commencé à infléchir la tendance des émissions, mais les émissions mondiales ne sont toujours pas sur la voie de la réduction. »Helen Clarkson (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) , chef de la direction de la semaine du climat : « Aucun chevalier en armure de panneaux solaires ne va venir à notre rescousse dans un véhicule électrique blanc. Ou plutôt, comme nous sommes à New York, il n’y a pas de Spiderman pour nous sauver. La cavalerie, c’est nous. »
Dr Sultan Al Jaber, président désigné de la COP28 : « Nous encouragerons les nouveaux partenariats à niveaux multiples visant à accélérer la transition énergétique, financer la lutte contre les changements climatiques, privilégier les personnes, les vies et les moyens de subsistance, et faire entendre les voix locales à la table des négociations internationales sur le climat ».
Dee Yang, associée, McKinsey Sustainability (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) « La sensibilisation au risque lié à la nature (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) a fait de grandes avancées. J’estime que cette prise de conscience suit de 12 à 18 mois la sensibilisation aux changements climatiques. Une tendance intéressante est le nombre d’investisseurs institutionnels qui font des promesses de résultats dans une optique de biodiversité ; ce nombre est en augmentation visible. »
Kate Brandt, chef de la durabilité, Google (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) « Grâce à Flood Hub, notre outil de prédiction des inondations alimenté par l’IA, un système qui montre à quel moment et à quel endroit peuvent survenir des inondations, nous pouvons émettre des alertes aux inondations jusqu’à sept jours à l’avance pour les collectivités vulnérables. »
ACTION SUR LE CLIMAT
Coalitions, défis et revirements
Il n’y a pas eu que des discussions, mais aussi beaucoup d’action à New York, avec notamment l’arrestation d’une centaine de militants climatiques réunis dans la ville.
Haute ambition : Alarmés par le dernier Bilan mondial de l’ONU (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), 17 leaders de la Coalition de la haute ambition (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) ont signé une déclaration appelant à réduire d’urgence les émissions de carbone et à mettre en œuvre une « transformation systémique ». Le rapport en question affirme que le monde est loin d’être en bonne voie pour atteindre ses objectifs de zéro émission nette.
Défi du carbone : Le Défi mondial sur la tarification du carbone, dirigé par le Canada, a accueilli la Norvège et le Danemark en tant que nouveaux adhérents (ces deux pays ont déjà mis en place une tarification du carbone). L’objectif du Défi mondial sur la tarification du carbone est de tripler la couverture des mécanismes de tarification du carbone partout dans le monde jusqu’à atteindre 60 % des émissions mondiales avant 2030. La Côte d’Ivoire s’est aussi jointe au défi en tant que « pays ami ». Environ 33 pays ont adopté une tarification du carbone.
Nouveaux traités : Les pays se sont réunis cette semaine pour négocier la version définitive du traité sur la protection de la haute mer (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) Conclu à l’issue de deux décennies de négociations, l’accord renforce les règles sur la protection et l’utilisation durable de la biodiversité marine, et il couvre plus des deux tiers des océans de la planète.
Un revirement : Le premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak, qui n’a pas participé au sommet des Nations Unies, a choisi la grande semaine du climat pour remettre en cause plusieurs engagements de son gouvernement en matière de climat. Downing Street a annoncé un report de cinq ans dans l’interdiction de la vente de nouvelles voitures à essence et diesel, et un report de neuf ans dans l’interdiction de nouveaux appareils de chauffage à l’énergie fossile pour les maisons n’ayant pas accès au réseau de gaz.
Transport
Passage à la vitesse supérieure
Les véhicules électriques sont le meilleur exemple de réussite dans le secteur des technologies propres. Cela dit, les ventes de véhicules électriques devront s’accélérer si le monde souhaite répondre aux ambitions de zéro émission nette. Le Breakthrough Agenda Report (ce contenu est disponible en anglais seulement), nouvelle étude de l’Agence internationale de l’énergie publiée dans le contexte de la semaine du climat de New York, fait ressortir les progrès réalisés pour réduire les émissions du secteur des transports et jusqu’où nous devons encore aller pour atteindre zéro émission nette.
Voici les principales constatations de l’AIE sur les VE :
- Les ventes mondiales de véhicules électriques représentent maintenant 14 % des ventes d’automobiles totales, et le chiffre double chaque 1,2 an.
- À ce rythme, les ventes de véhicules électriques dépasseront le niveau requis pour atteindre zéro émission nette, mais l’électrification d’autres types de véhicules et les politiques encourageant à réduire l’utilisation des véhicules demeurent primordiales.
- La collaboration internationale, qui est essentielle pour stimuler l’industrie mondiale des véhicules électriques, s’est avérée « modeste », selon l’AIE. L’absence de normes de durabilité harmonisées, la lenteur de la réduction des risques d’investissement et les goulets d’étranglement dans l’offre de produits sont autant de facteurs qui ont entravé les progrès.
- Une coalition appelée Accelerating to Zero (AtoZ) (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), dont l’ambition est que les VE représentent 100 % des ventes totales de voitures d’ici 2040, compte plus de 40 pays signataires (dont le Canada). Néanmoins, les États-Unis, la Chine, la Corée du Sud et le Japon brillent par leur absence, de même que plusieurs des plus grands constructeurs automobiles mondiaux.
- À l’heure où les pays et les sociétés se lancent dans des technologies distinctes, le monde doit insister sur la mise en place de normes durables dans le secteur minier, de normes communes dans la production, et d’une gestion responsable des approvisionnements et des données.
Le chemin de la décarbonation est long et épineux
Part des ventes de VE ciblée d’ici 2030 pour atteindre les objectifs de zéro émission nette
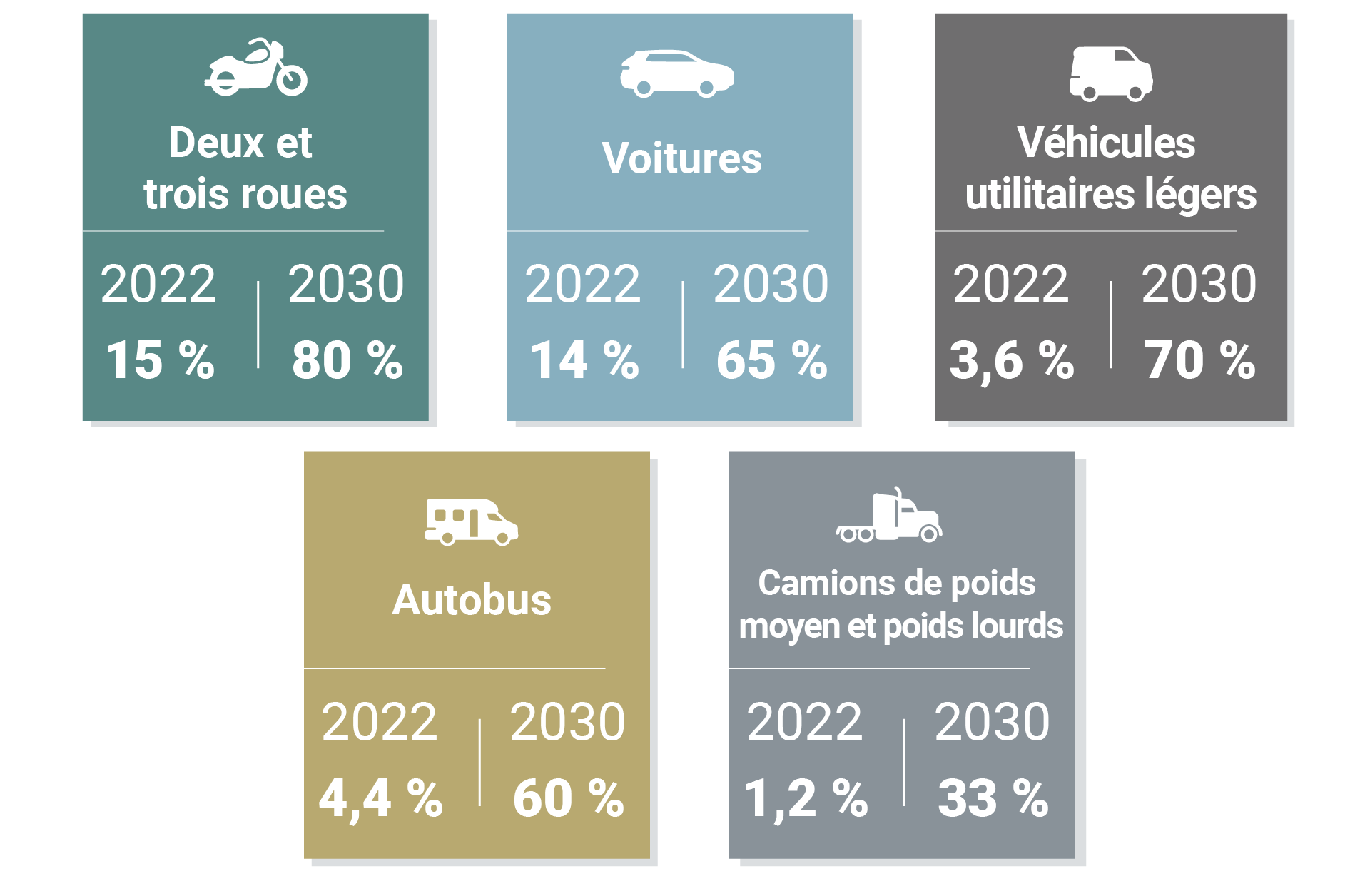
Source: Agence internationale de l’énergie
GRAPHIQUE DE LA SEMAINE
Le grand retard
Tant à l’assemblée de l’ONU qu’à la semaine du climat de New York, l’un des grands sujets de discussion a été l’absence de progrès au regard des 17 objectifs de développement durable (ODD) ratifiés par les membres de l’ONU en 2015.
Toutefois, le monde entier est en retard par rapport à la plupart de ces indicateurs, selon le Rapport sur l’état d’avancement des ODD récemment publié par l’ONU (où l’ONU dévoile une série de solutions audacieuses pour relancer le financement des ODD (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement))
Sur les 17 ODD, 8 portent directement sur des questions environnementales. Voici l’état d’avancement à ce jour :
Le monde a bien du mal à atteindre les objectifs de développement durable
Sur les 17 objectifs de développement durable, 8 concernent directement l’environnement.
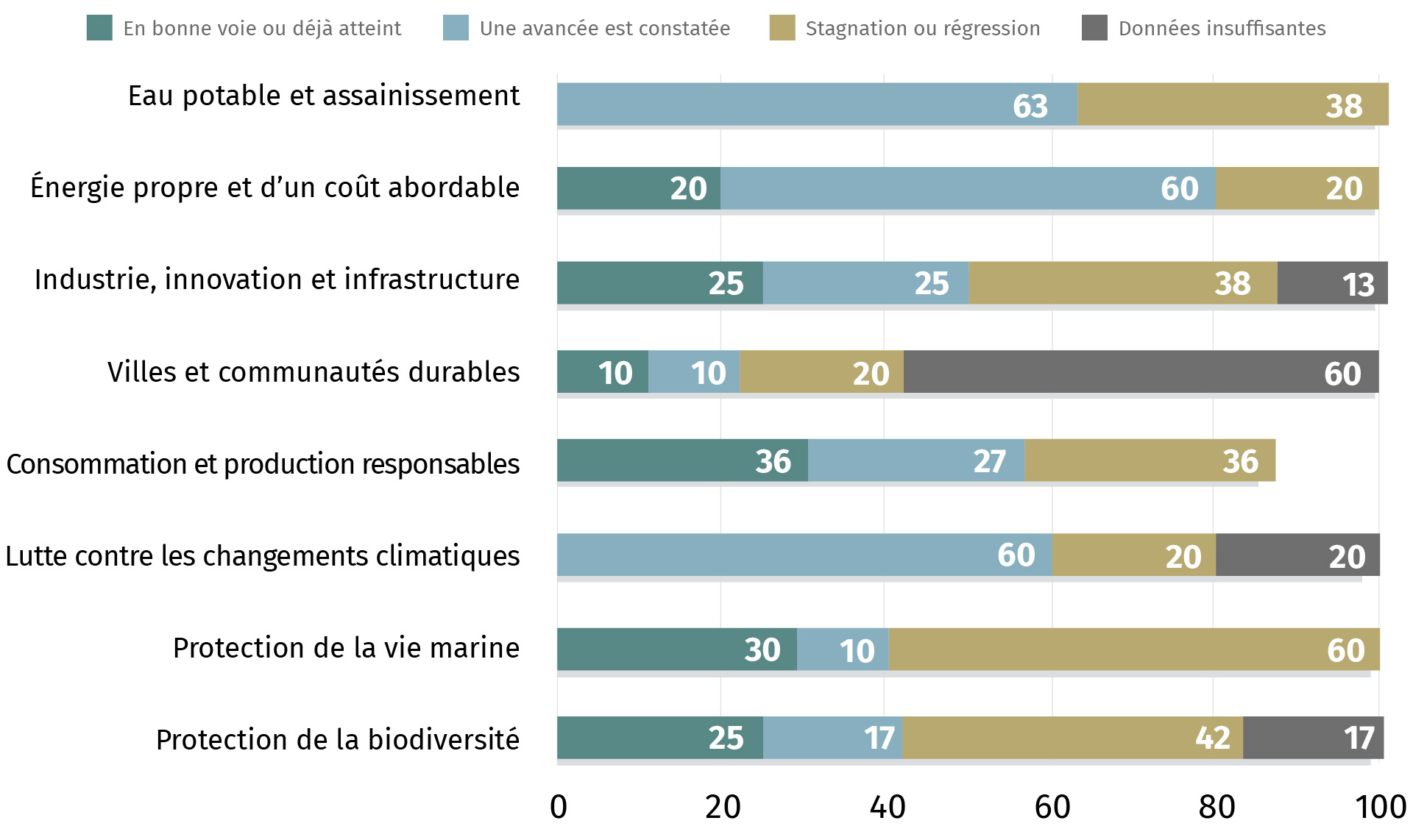
Source: Nations Unies
ZÉRO ÉMISSION NETTE
Mesurer la lutte des sociétés contre les changements climatiques
Certaines des plus grandes sociétés mondiales ont du mal à agir conformément à leurs ambitions, selon un nouveau sondage mené par Oliver Wyman et le Climate Group auprès de 200 sociétés dans le contexte de la semaine du climat (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement)
Voici ce que les sociétés peinent à mettre en œuvre dans le cadre de leur transition climatique :
| 55 % | Pourcentage de sociétés qui n’ont pas encore intégré la lutte contre les changements climatiques à leur stratégie de base. |
| 61 % | Pourcentage de sociétés qui considèrent la décarbonation comme un enjeu important d’ici 2030 ; 31 % pensent que cette menace sera existentielle à la fin de la décennie. |
| 59 % | Pourcentage de sociétés qui ont alloué moins de 6 % de leurs dépenses d’investissement totales à la lutte contre les changements climatiques. |
| 47 % | Pourcentage de sociétés engagées dans la transition climatique qui estiment que le manque d’une politique gouvernementale claire constitue le plus grand obstacle face à la décarbonation. |
Source: Agence internationale de l’énergie, Oliver Wyman et Climate Group (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement)
Des vêtements adaptés au réchauffement planétaire seront bientôt disponibles dans vos magasins. Plusieurs entreprises en démarrage (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) sont en train de confectionner des lignes de vêtements adaptées aux changements climatiques en utilisant des tissus réfléchissants, des techniques de tissage innovantes et des textiles thermorégulateurs capables d’abaisser la température corporelle de 8 o Celsius. Initialement destinés aux travailleurs de l’agriculture et du bâtiment, les vêtements pour un monde « en ébullition (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) » sont maintenant proposés aux employés de bureau (et même à leurs animaux de compagnie). Compte tenu des éprouvantes journées de canicule qui nous attendent les prochains étés, il est peut-être temps de revoir le contenu de nos armoires.
Les petits États insulaires devant les tribunaux. Dans la crainte d’être submergés par la montée des mers, 9 petits États insulaires, dont les Bahamas et Tuvalu, ont intenté une action en justice contre les pays à fortes émissions devant le Tribunal international du droit de la mer (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) de Hambourg cette semaine. Il s’agit de la première affaire de justice climatique visant à protéger l’océan. Les îles ne réclament pas de dommages-intérêts, mais un avis de la Cour sur les obligations juridiques des grands émetteurs en matière de protection des océans.
Les entreprises coréennes aiment le Canada. La société sud-coréenne Solus Advanced Materials Co. (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) est la dernière en date à étudier une occasion de technologie propre dans le pays. Grâce à l’appui d’Ottawa et du Québec, Solus redonne vie à une ancienne usine pour un coût de 750 millions de dollars. L’investissement vise à produire 25 000 tonnes de feuilles de cuivre destinées aux batteries de véhicules électriques à compter de 2026. Les sociétés sud-coréennes Sk On et EcoProBM ont également fait équipe avec Ford Motor pour construire une usine de fabrication de cathodes de 1,2 milliard de dollars au Québec (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement)
New York, New York. Une semaine du climat est organisée à New York du 17 au 24 septembre. Sous le slogan « We Can. We Will », l’évènement compte s’attaquer à de grandes idées comme le déploiement des technologies vertes et la canalisation des investissements là où les besoins sont les plus importants. Cette semaine, vous trouverez une couverture spéciale de Signaux climatiques consacrée à la semaine du climat.
ÉMISSIONS
Le monde est en mauvaise voie
Alors que le G20 était réuni à New Delhi pour se pencher sur les enjeux des changements climatiques, les Nations Unies ont lancé un avertissement sans appel la semaine dernière : le monde n’est « pas sur la bonne voie » pour atteindre les objectifs à long terme de l’Accord de Paris.
Le premier « bilan mondial » de l’agence cherche à évaluer la progression du monde vers son objectif, à savoir zéro émission nette avant 2050. L’ONU estime que les politiques actuelles sont globalement inadéquates et qu’il est de moins en moins probable que la planète se réchauffe de moins de 1,5 oCelsius, comme cela a été décidé à Paris en 2015. Malgré les milliards de dollars investis dans l’action sur le climat (au rythme de 803 milliards de dollars américains par an ces dernières années) et la pléthore de mesures politiques mises en place, les émissions continuent de s’accroître et l’humanité a commencé à subir des pertes et des dommages liés au climat.
Selon l’ONU, « une mise en œuvre plus ambitieuse et un soutien beaucoup plus important sont nécessaires » pour accélérer les mesures d’atténuation et rehausser les objectifs nationaux, afin de réduire les émissions mondiales de GES de 43 % d’ici 2030 et de 60 % d’ici 2035 par rapport au niveau de 2019 et finalement d’atteindre zéro émission nette de CO2 d’ici 2050.
Bien que les prévisions climatiques soient de plus en plus maussades depuis quelques années, le rapport de l’ONU propose des solutions, parmi lesquelles des actions crédibles, responsables et transparentes de la part de toutes les parties prenantes, la transformation du système énergétique, l’abandon progressif des combustibles fossiles, l’arrêt de la déforestation et le transfert rapide des nouvelles technologies propres vers les pays en développement.
Les émissions mondiales sont en hausse
Émissions annuelles de dioxyde de carbone (CO 2) dans le monde (en milliards de tonnes métriques)
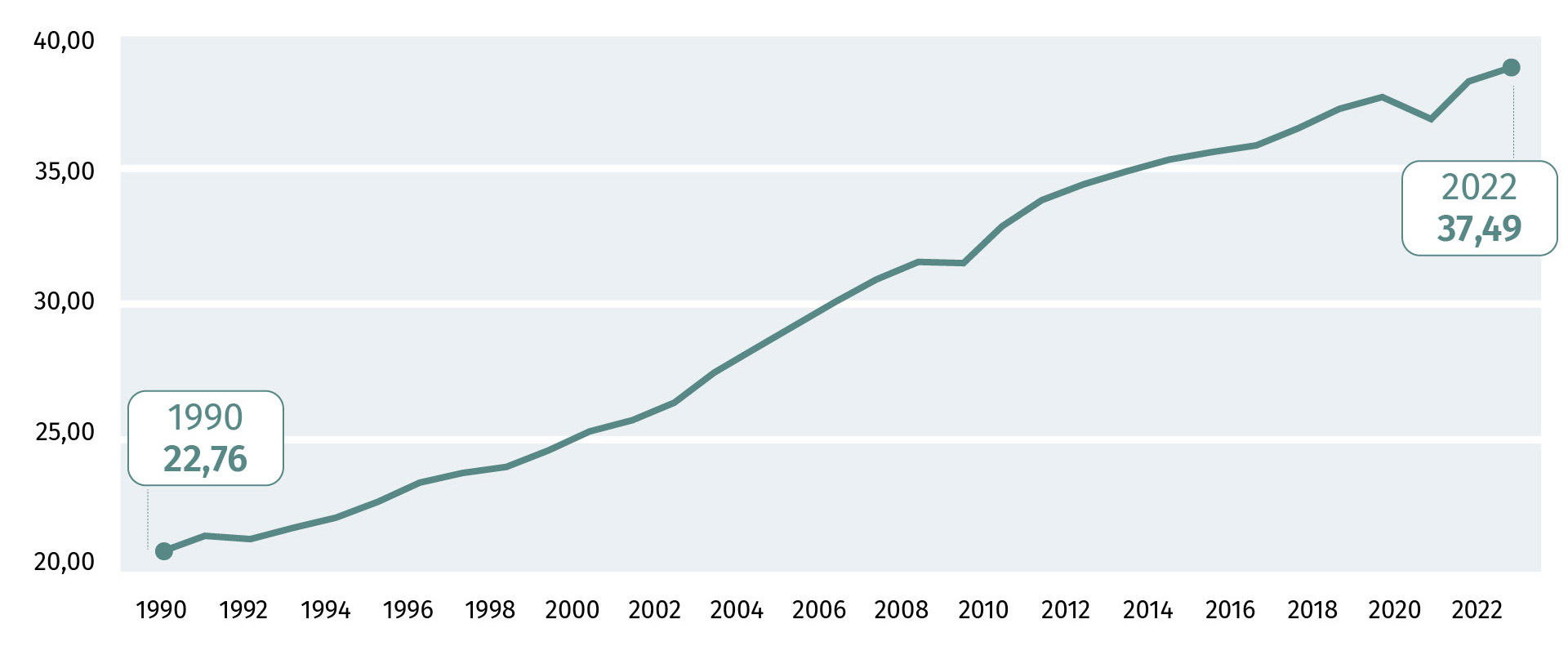
Source:Nations Unies/Statista
COP28 : Bien que leurs efforts aient été contrecarrés au sommet du G20 à New Delhi, les négociateurs pour le climat comptent exploiter les conclusions du dernier rapport des Nations Unies pour insister sur l’urgence de l’action au COP28 de Dubaï en novembre. Ce sera l’une des nombreuses questions litigieuses débattues lors du sommet. Nous pouvons aussi nous attendre à de vives discussions au sujet de la consommation de combustibles fossiles et du financement de la lutte contre les changements climatiques, qui est apparu comme un grief important du « Sud mondial » à l’encontre des économies développées. Dans le même temps, le fonctionnement des marchés des émissions devient problématique.
GRAPHIQUE DE LA SEMAINE
En route vers un futur à zéro émission nette
Le monde dispose de ressources suffisantes pour bâtir une économie sans carbone d’ici 2050. Cependant, un effort d’exploration sera nécessaire pour élargir les réserves de matériaux essentiels à la transition énergétique. C’est la principale conclusion du nouveau rapport de l’Energy Transitions Commission, un groupe de réflexion basé au Royaume-Uni, qui a calculé l’ampleur et le volume des matériaux nécessaires à la fabrication de panneaux solaires, éoliennes, batteries de véhicules électriques et autres. En plus des mines existantes, de nouveaux projets miniers seront indispensables pour répondre à la demande grandissante.
Comment la décarbonation mondiale stimulera la demande de métaux
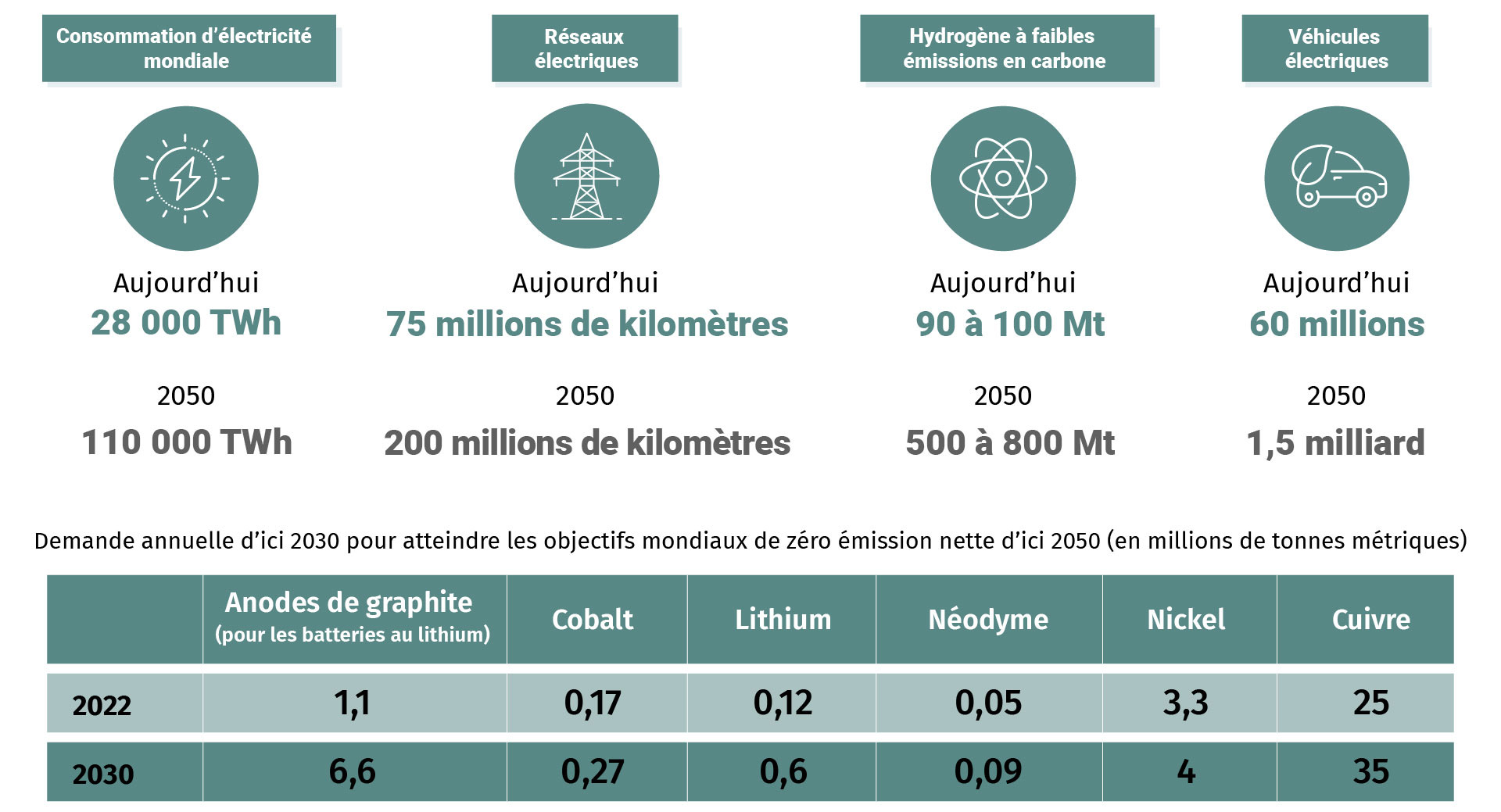
Source: Energy Transitions Commission
POLITIQUE PUBLIQUE
Comment améliorer la politique du Canada en matière de CCUS
La politique du Canada en matière de captage, d’utilisation et de stockage du carbone est axée sur un crédit d’impôt à l’investissement de 50 % pour le captage et de 37,5 % pour le transport et le stockage, et il existe un projet de contrats sur différence visant à renforcer la certitude des revenus futurs.
Cela dit, le gouvernement doit redoubler d’efforts, comme le recommande un mémorandum de l’Institut C.D. Howe (ce contenu est disponible en anglais seulement), d’autant plus que les pays rivaux avancent vite. La politique de crédit d’impôt 45Q des États-Unis, par exemple, est indexée sur l’inflation, couvre jusqu’à 2/3 des coûts des projets et a déjà attiré 132 nouveaux projets dont une partie est en exploitation.
Au Canada, le projet de loi sur les crédits d’impôt est moins généreux : « Notamment, les dépenses réalisées après 2030 n’obtiendront que 50 % de la valeur du crédit, peu importe si la décision d’investissement a été prise avant 2030. Étant donné que les projets CCUS peuvent voir leur construction s’étaler sur six années, ils devront démarrer dès l’année prochaine s’ils souhaitent profiter pleinement de cette politique », a écrit Ben Brunnen, chercheur à l’Institut C.D. Howe. Cela signifie que la valeur du crédit de 42 % se rapprochera probablement de 30 % d’ici 2033.
Principales recommandations : Afin de stimuler les investissements CCUS dans le pays, il faudrait permettre aux dépenses liées aux projets CCUS (engagées avant 2033) d’être admissibles au crédit complet, et adopter une démarche de crédit gouvernemental comparable à la politique 45Q des États-Unis. M. Brunnen recommande également des politiques en faveur des investissements dans le pétrole et le gaz à faibles émissions de carbone, plutôt qu’un plafonnement « punitif » des émissions du secteur pétrolier et gazier.
LE ZÉRO ÉMISSION
Ambition hydrogène à Terre-Neuve
À la fin du mois d’août, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a sélectionné quatre sociétés pour mettre sur pied des parcs éoliens chargés de fournir de l’énergie à de nouvelles usines d’hydrogène. Les sociétés EverWind NL Company, Exploits Valley Renewable Energy Corp, ABO Wind et World Energy GH2 ont ainsi été agréées à cet effet, sous réserve des évaluations environnementales et réglementaires requises. Les projets ont encore beaucoup de chemin à parcourir et ils sont confrontés à une concurrence féroce, mais ils s’inscrivent dans l’ambition générale du Canada d’approvisionner l’Allemagne et les autres pays européens en hydrogène vert.
| 19 | Nombre total de soumissions reçues par le gouvernement de Terre-Neuve pour les projets de parcs éoliens. |
| 66,3 milliards $/strong> | Total des dépenses en immobilisations estimées pour les quatre projets approuvés. |
| 2025 | Date de démarrage du projet Nujio’qoni de World Energy (ce contenu est disponible en anglais seulement), qui prévoit deux parcs éoliens de 1 GW et une usine d’hydrogène et d’ammoniac. |
| 5 fois | Estimation de l’augmentation de la production canadienne d’hydrogène à faibles émissions en carbone d’ici 2050 par rapport au niveau actuel de 4 tonnes métriques, selon la « stratégie hydrogène » (ce contenu est disponible en anglais seulement) d’Ottawa. |
Source: Gouvernement et sociétés de Terre-Neuve-et-Labrador
L’ACTION CLIMATIQUE
Cette semaine, la ville de Québec accueillera le Congrès conservateur. Comment le parti qui remonte dans les sondages (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) voit-il les relations entre les changements climatiques et l’économie ? Les politiques en discussion comprennent la taxe carbone (que le leader Pierre Poilievre (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) souhaite passer à la trappe), l’atténuation des changements climatiques (au moyen de la technologie, et non d’une taxe, selon une proposition) et la sécurité énergétique. Nous surveillerons également la position des conservateurs sur le Règlement sur l’électricité propre des libéraux et le plafonnement des émissions du secteur pétrolier et gazier, un nouveau sujet brûlant.
Sommet du G20 : Xi Jinping, le président chinois, et Vladimir Poutine, son homologue russe, seront absents de la réunion prévue samedi en Inde, ce qui met en lumière le dysfonctionnement du G20. « Une Terre. Une famille. Un avenir », le thème de la présidence indienne du G20, est louable, mais la famille du G20 est divisée sur plusieurs questions, dont le climat. En juillet, la réunion des ministres de l’Environnement du G20 n’a pas abouti à un accord ni à une déclaration commune. Le président américain Joe Biden arrivera les bras chargés de cadeaux pour ce qui est appelé le « Sud mondial », avec par exemple les réformes de la Banque mondiale destinées à libérer des capitaux pour lutter contre les changements climatiques.
Financement de l’Afrique. Dans un continent à l’écart de l’agitation du G20, les gouvernements africains ont signé la « Déclaration de Nairobi » relative aux changements climatiques, qui contient une proposition de taxe carbone mondiale et un élargissement des marchés du carbone, à l’occasion du tout premier Sommet africain du climat (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) tenu à Nairobi au Kenya. Les dirigeants africains souhaitent utiliser cette déclaration comme une feuille de route lors de leur future négociation au sommet COP28 en novembre. Le continent (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) représente environ 20 % de la population mondiale, mais moins de 2 % des investissements mondiaux dans l’énergie propre.
Opération « Ox Removal ». Au cours des quatre dernières années, l’Amazonie a perdu un morceau de forêt tropicale à peu près équivalent à la taille de l’Autriche. À présent, le gouvernement brésilien (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) contre-attaque. Cette semaine, le pays a lancé l’opération Eraha Tapiro (« Ox Removal » ou réduction de l’élevage bovin, dans la langue du peuple indigène Assurini) dans le cadre de la Journée de l’Amazonie. L’initiative vise à juguler les crimes contre l’environnement et à stopper l’expansion des terres agricoles.
Le « bébé Classe G ». Mercedes (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) est en train d’élaborer une version électrique et plus petite de l’emblématique Classe G, son modèle le plus coûteux et le plus populaire. Le nouveau modèle pourrait prendre la route dès 2026. Dans le segment des véhicules à la mode, cela pourrait donner des sueurs froides aux modèles haut de gamme de Tesla.
ÉNERGIE
L’éolien en mer face à la tempête
« Imprévisible » est le terme qu’a choisi le chef de la direction d’Orsted (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), l’une des plus grandes sociétés d’énergie renouvelable au monde, pour décrire le marché mondial de l’éolien extracôtier qui souffre actuellement de coûts plus élevés.
Préoccupations des sociétés : La société danoise doit faire face aux dépréciations d’importants projets extracôtiers américains, en raison de la hausse des taux d’intérêt et de retards inattendus dans ses chaînes logistiques. Orsted n’est pas la seule dans ce cas. En juillet, le développeur suédois Vattenfall (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) a mis fin à un projet de 140 turbines en mer du Nord en invoquant la montée des coûts en capital. Aux États-Unis, le développeur Avangrid a aussi jeté la faute à la hausse des coûts après avoir perdu un contrat d’approvisionnement dans le Massachusetts. Les grands exploitants d’éolien extracôtier de New York demandent également un ajustement des prix de 48 % en moyenne dans leurs contrats afin de couvrir la hausse des coûts, tandis que l’Alliance for Clean Energy NY (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) réclame une augmentation de 64 % des prix dans le cadre de 86 projets solaires et éoliens.
Après un spectaculaire déclin des coûts pendant une décennie, certains segments des énergies renouvelables montrent des signes d’essoufflement. Cela pose un défi, étant donné que de nombreux pays augmentent leur production d’énergie sans émissions afin d’atteindre leurs objectifs de décarbonation et qu’ils auront besoin de 1 000 gigawatts par an – environ trois fois les niveaux actuels – jusqu’en 2030 pour rester sur la voie de l’objectif de 1,5 °C.
À l’exclusion de la Chine : Un nouveau rapport de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (ce contenu est disponible en anglais seulement) montre qu’en 2022, environ 86 % de la capacité d’énergie renouvelable nouvellement mise en service était moins coûteuse que l’énergie produite à partir de combustibles fossiles. Mais le coût modique offert par la Chine, combiné à sa prépondérance sur le marché, a faussé les chiffres. En excluant la Chine, 11 des 20 principaux marchés de l’énergie solaire photovoltaïque ont vu augmenter le coût de leur base installée en 2022 par rapport à l’année précédente, et 8 des 20 principaux marchés de l’énergie éolienne ont constaté une hausse des coûts. L’Europe a enregistré une augmentation de 32 % dans ses projets d’énergies renouvelables nouvellement mis en service.
Le déclin des coûts des énergies renouvelables pendant une décennie montre des signes d’essoufflement
Coût de l’électricité uniformisé ($ US/kWh)
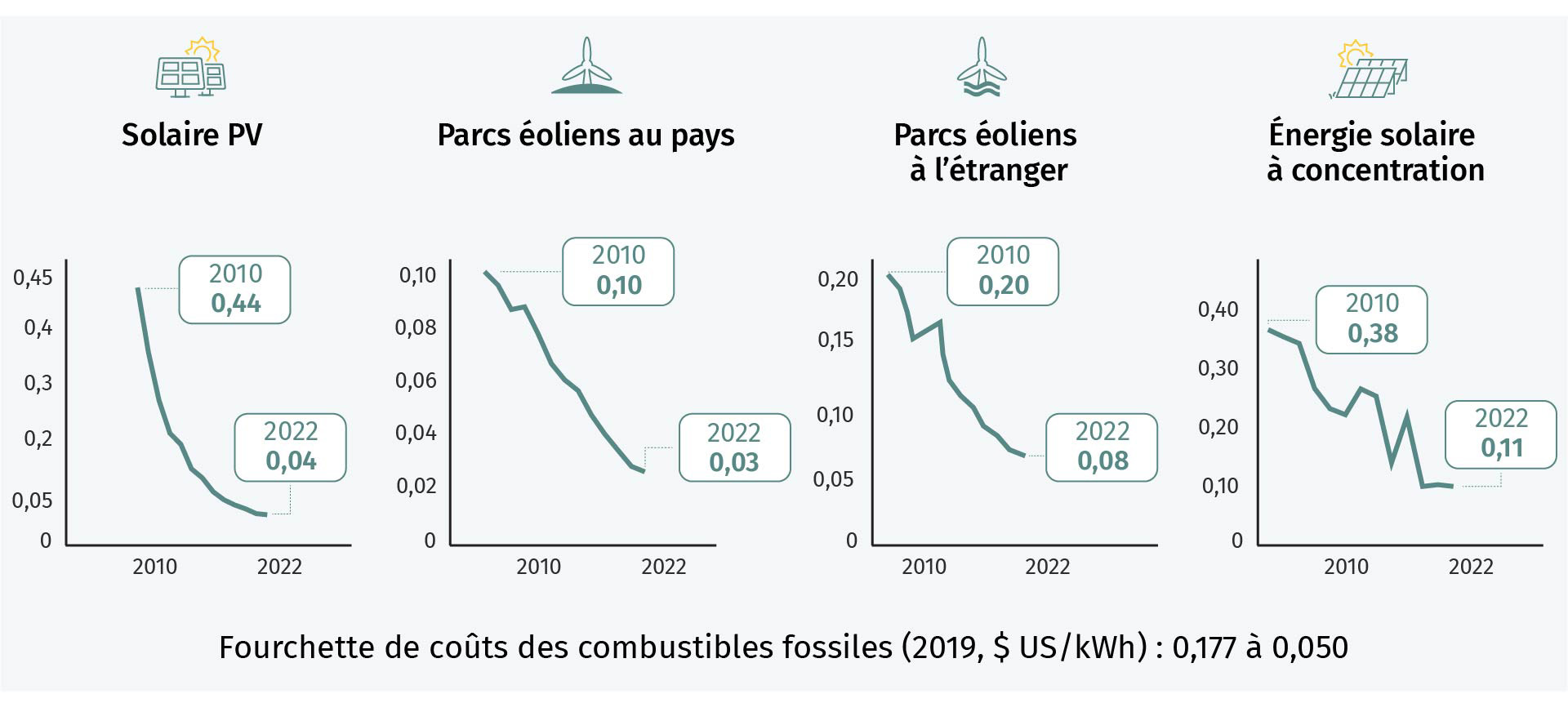
Source: Agence internationale pour les énergies renouvelables
Les combustibles fossiles coûtent cher : L’inflation inhérente à l’énergie éolienne extracôtière doit être relativisée, car les énergies renouvelables, en tant que groupe, continuent de battre les énergies fossiles au chapitre des coûts. L’Agence internationale pour les énergies renouvelables estime que « les prix élevés des combustibles fossiles devraient cimenter le changement structurel qui a vu la production d’énergie renouvelable devenir la source de nouvelle génération la moins coûteuse. »
Mais cela pourrait changer. Les énergies renouvelables devront rapidement réagir à la crise des minerais critiques – essentiels aux panneaux solaires et aux éoliennes, à la hausse des taux d’intérêt et aux tensions dans les chaînes d’approvisionnement, autant d’obstacles qui pèsent sur la viabilité économique des projets.
GRAPHIQUE DE LA SEMAINE
Signaux mitigés dans le secteur pétrolier
Le monde consomme environ 100 millions de barils de pétrole par jour, mais que nous réserve l’avenir ? La hausse de la demande de pétrole constatée par la supermajor ExxonMobil aux États-Unis est en contradiction avec ce que l’Agence internationale de l’énergie (AIE) estime nécessaire pour contrer les changements climatiques. De toute évidence, les prévisions des producteurs pétroliers sont intrinsèquement biaisées, mais elles révèlent aussi la stratégie du secteur : les grandes sociétés pétrolières rachètent leurs rivaux pétroliers et gaziers plus petits (les fusions et acquisitions (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) en amont ont dépassé leur moyenne quinquennale au deuxième trimestre), augmentent les dividendes et les rachats, et montrent des signes de ralentissement des investissements dans les énergies renouvelables (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), du moins pour l’instant.
Quelle orientation prend la demande de pétrole ?
Prévisions de la demande mondiale de pétrole (en millions de barils par jour)
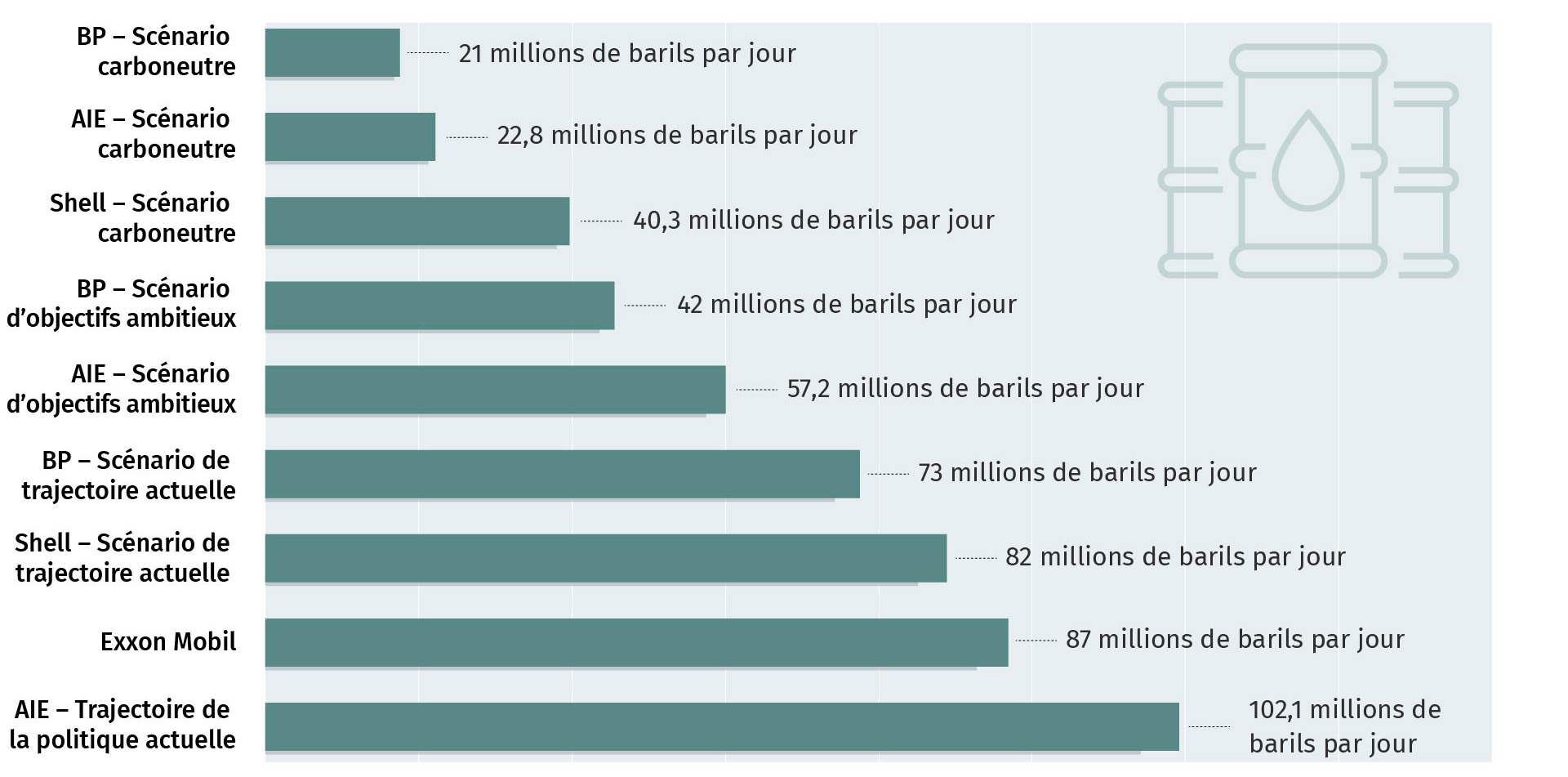
Source: Agence internationale de l’énergie, sociétés
LE ZÉRO ÉMISSION
Tesla perd de son emprise
Tesla perd peu à peu de son emprise sur le marché canadien des véhicules électriques. Les véhicules électriques représentent maintenant 40,6 % des nouvelles ventes de véhicules électriques de la Colombie-Britannique, comparativement à près de 61 % il y a un an, et l’Ontario et le Québec constatent des reculs similaires. Mais la part globale des véhicules électriques est en croissance : sur 10 véhicules immatriculés au Canada au deuxième trimestre, 1 est un véhicule électrique.
| 40,5 % | Part du Québec dans les nouvelles immatriculations de véhicules électriques au Canada au T2. Celle de l’Ontario est de 28 % et celle de la Colombie-Britannique, de 23 %. |
| 60 % | Énergie produite à partir du charbon en Chine. Ce chiffre doit tomber à 5 % d’ici 2050 pour que le secteur de l’électricité en Chine atteigne la carboneutralité d’ici 2055. |
| 6487 | Ventes du Model Y de Tesla au cours du trimestre, soit le chiffre le plus élevé pour tous les modèles. Toutefois, la part de marché du constructeur automobile américain a diminué partout au Canada sur la base du pourcentage. |
| 23 % | Selon la prévision de S&P Global, part de marché des VE parmi les nouvelles voitures immatriculées au Canada d’ici 2025. |
Source : S&P Global Inc. (ce contenu est disponible en anglais seulement)
L’action climatique
Alors que l’ouragan Idalia frappe la Floride de plein fouet, Hollywood canalise, et diffuse en continu, l’anxiété climatique. La fascination des studios de cinéma pour les avenirs dystopiques remonte à plusieurs décennies, mais « Extrapolations », une série en huit épisodes sur le climat diffusée sur Apple TV (mettant en vedette Meryl Streep entre autres), offre un aperçu d’un avenir proche, d’un monde détruit par l’environnement. La vie dans un environnement où la température augmente de plus de 1,5 °C est un véritable enfer : des réfugiés climatiques, des gens qui se trimballent avec des réservoirs d’oxygène et des milliardaires qui manipulent des technologies de transition inefficaces. C’est horrible. Pensez à la série « Black Mirror » de Netflix, mais en version climatique.
Plafonnement des émissions de pétrole et de gaz. Selon Steven Guilbeault (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), ministre de l’Environnement, un projet de loi fédérale visant à plafonner les émissions provenant de la production de pétrole et de gaz devrait voir le jour à l’automne. On possède encore peu de détails, mais le Plan de réduction des émissions (ce contenu est disponible en anglais seulement) de l’année dernière indiquait que le plafonnement visait à « réduire les émissions au rythme et à l’échelle nécessaires pour atteindre l’objectif de la carboneutralité d’ici 2050, avec des objectifs quinquennaux pour rester sur la bonne voie ». Danielle Smith, première ministre (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) de l’Alberta, a répliqué en déclarant qu’en aucun cas la province n’autoriserait la mise en œuvre du plafond pour le pétrole et le gaz (ni celle du projet de loi fédérale sur l’électricité).
Taxe à la frontière : L’Union européenne s’apprête à imposer un impôt spécial aux pays dont les règles environnementales sont moins strictes. Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) sera bientôt appliqué au ciment, au fer et à l’acier, à l’aluminium, aux engrais et à l’électricité en provenance de pays tiers, selon la teneur en carbone de leurs importations. La mise en œuvre de ce mécanisme sera délicate et la vérification des émissions sera un cauchemar. L’Inde (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) et d’autres économies émergentes s’inquiètent, mais l’UE voit cette mesure comme faisant partie de l’initiative du club climat (ce contenu est disponible en anglais seulement) du G7, qui vise à encourager des chaînes logistiques plus vertes sur les marchés émergents.
Obstacles au zéro émission. Chacun est favorable à l’action climatique et à l’assainissement de l’air… jusqu’à ce que les mesures touchent son propre argent. L’État du New Jersey poursuit le gouvernement fédéral en justice pour empêcher la ville de New York de mettre en place un plan historique de tarification de la congestion. De l’autre côté de l’océan, Sadiq Khan (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), maire de Londres, a été obligé d’abandonner cette semaine son projet de zone à zéro émission dans le centre de Londres (qui aurait imposé des frais à tous les véhicules à moteur à combustion) à la suite de fortes critiques, y compris de la part du premier ministre Rishi Sunak.
Le feu aux poudres : L’activisme climatique se manifeste dans des endroits inattendus ces jours-ci. Une militante suédoise (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) de 18 ans poursuit Greenpeace en justice pour ce qu’elle appelle la position antinucléaire « à l’ancienne » de l’organisme environnemental. Un manifestant (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) a jeté de la peinture (lavable) sur un tableau de Tom Thomson au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa. Cette action fait partie d’une attaque mondiale contre les installations à l’échelle mondiale, qui vise à attirer l’attention sur les changements climatiques. Par ailleurs, des militants pour le climat ont bloqué la circulation au festival Burning Man (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) dans le désert du Nevada. Parmi leurs revendications, citons l’interdiction des jets privés, des plastiques à usage unique et de l’utilisation de générateurs lors de ce festival bohème.
POLITIQUE PUBLIQUE
Problème de plastique chez les épiciers
Les plus grands épiciers du Canada sont prévenus. Ottawa demande aux principaux détaillants du pays de réduire l’utilisation de contenants en plastique à usage unique, qui représentent les deux tiers des produits sur les étagères des épiciers. Le gouvernement espère que la limitation de la consommation de plastique permettra de réduire les émissions (les plastiques proviennent de combustibles fossiles) et de diminuer le gaspillage d’énergie et de nourriture. Les produits visés comprennent les bouteilles de condiments, les paquets de nourriture pour bébés, les sacs en plastique de nourriture pour animaux, les sacs à lait et les emballages moulants pour les légumes et la viande qui se conservent souvent peu longtemps et aboutissent rapidement dans les décharges. Le secteur (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) affirme que cette mesure ferait augmenter les factures d’épicerie et ne contribuerait guère à limiter le gaspillage alimentaire.
Pourquoi viser le plastique à usage unique ? : On voit souvent des images poignantes de morceaux de plastique coincés dans la gorge d’animaux marins. Cette matière figure aussi parmi les quatre éléments les plus répandus qui polluent les océans (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) Le problème ne cesse de s’aggraver : les déchets d’emballages d’aliments et de boissons à usage unique trouvés sur les rivages au Canada ont presque doublé en un an, en 2020.
Pollution plastique : un problème croissant
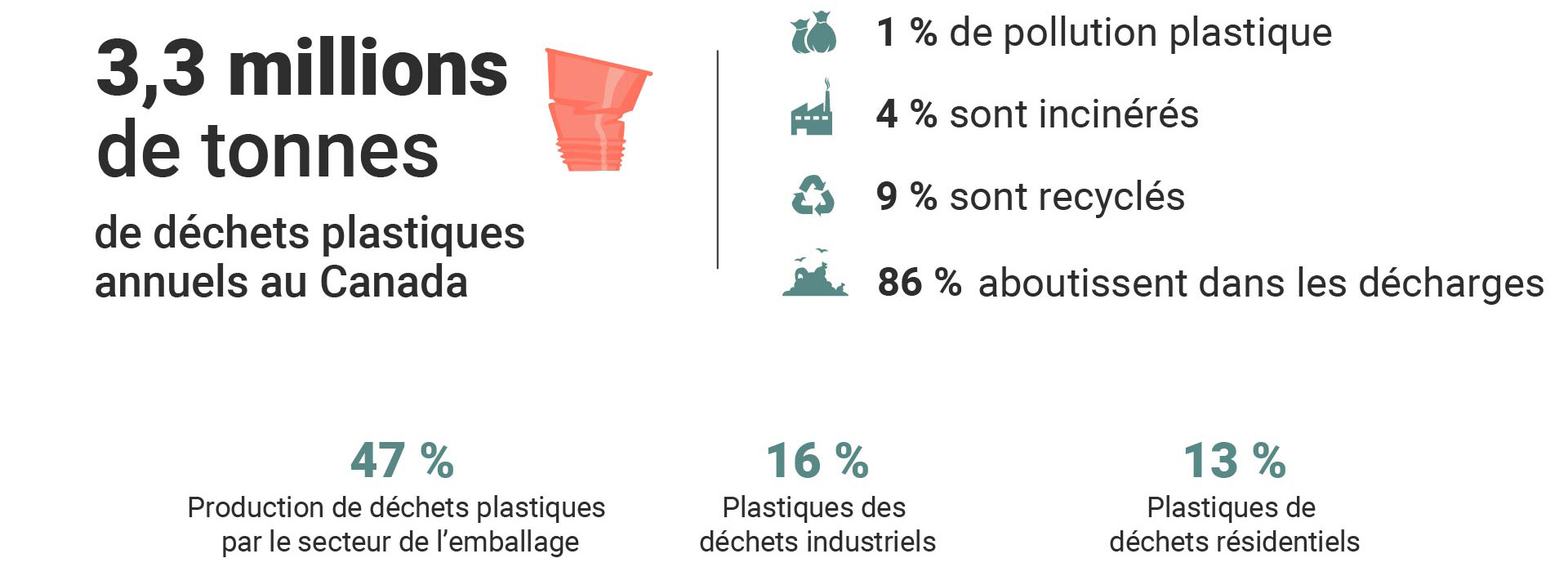
Source:Gouvernement du Canada
Quelle est la cible ? On demande au secteur de concevoir des règlements volontaires pour réduire les emballages en plastique dans les épiceries, mais Ottawa interviendra si les normes proposées sont inadéquates. Un document de consultation du gouvernement (avis P2), publié au début d’août, établit les objectifs ambitieux suivants :
- Au moins 75 % des fruits et légumes frais devront être vendus dans des emballages sans plastique d’ici 2026, et 95 % d’ici 2028.
- 100 % des emballages plastiques des aliments primaires doivent être réutilisables, recyclables ou compostables d’ici 2028.
- Élaborer des stratégies pour que 60 % des produits utilisent des emballages sans plastique dans le cadre d’un système de réutilisation ou de remplissage d’ici 2035.
- Comme les détaillants canadiens contrôlent souvent de grandes parties de la chaîne logistique, il faut concevoir les produits de manière à optimiser la circularité et la recyclabilité.
Prochaine étape : Le gouvernement rédigera un avis pour recueillir les commentaires du public, mais aucune date définitive n’a encore été communiquée.
TABLEAU DE LA SEMAINE
Plages disparues dans un monde qui se réchauffe
Un monde avec moins de plages est en effet un monde plus pauvre. Aujourd’hui, à l’occasion de la journée internationale de la plage, nous mettons l’accent sur une prévision réalisée par la Commission européenne en 2020, qui indique que de nombreuses plages sablonneuses du Canada pourraient disparaître, soit une superficie équivalente à celle du littoral de la Grèce, en raison de l’élévation du niveau de la mer due au réchauffement climatique. Au Canada et ailleurs, on met en place des pratiques de gestion durable des zones côtières et des bassins versants, mais il reste encore beaucoup à faire.
Longueur des plages sablonneuses qui devraient disparaître d’ici 2100
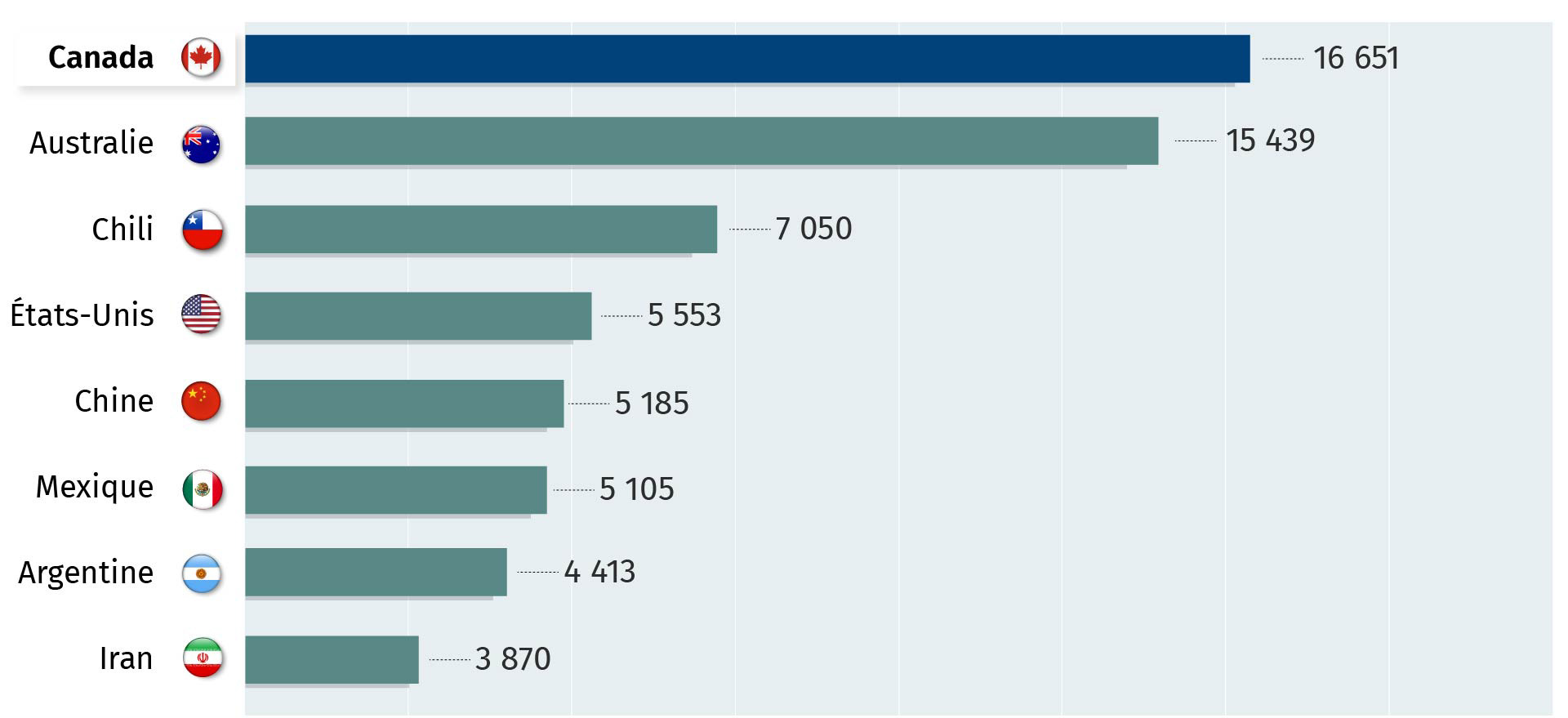
Source:Université de technologie de Delft/Centre commun de recherche de la Commission européenne
CAPITAL
Les critères ESG ne sont plus d’actualité, et les thermopompes sont à la mode
L’hydrogène et les thermopompes sont les nouveaux mots en vogue dans les grandes entreprises d’Amérique du Nord. Les membres de la Haute direction ont en grande partie évité de dire « ESG » (abréviation des critères environnement, société et gouvernance) pendant les conférences téléphoniques sur les résultats de ce trimestre, mais selon un rapport de Sara Mahaffy, analyste, Actions, RBC Capital Markets, LLC, qui a étudié les mots clés utilisés par la Haute direction pendant les téléconférences pour investisseurs, les mots « climat » et « décarbonisation » ont été fréquemment employés.
Quelques points saillants du trimestre :
- Tout en évitant l’abréviation ESG, qui est devenue un mot politisé aux États-Unis, les entreprises ont recouru à des termes plus spécifiques tels que circularité, pénurie d’eau, incendies de forêt et droits des Autochtones (les deux derniers sont en particulier utilisés au Canada).
- Les membres de la Haute direction du secteur de l’énergie à travers l’Amérique du Nord ont généralement évité le mot « climat » dans leurs dernières téléconférences, en se concentrant sur les technologies de transition comme l’hydrogène et les thermopompes.
- Au Canada, l’« énergie nucléaire » gagne du terrain (quoiqu’à partir d’un faible niveau), et les sociétés présentent les occasions à long terme liées à la remise à neuf des centrales par les clients, ainsi que celles concernant les petits réacteurs modulaires.
Intérêts des technologies de transition
Mentions des technologies de transition énergétique par les membres de la Haute direction en Amérique du Nord
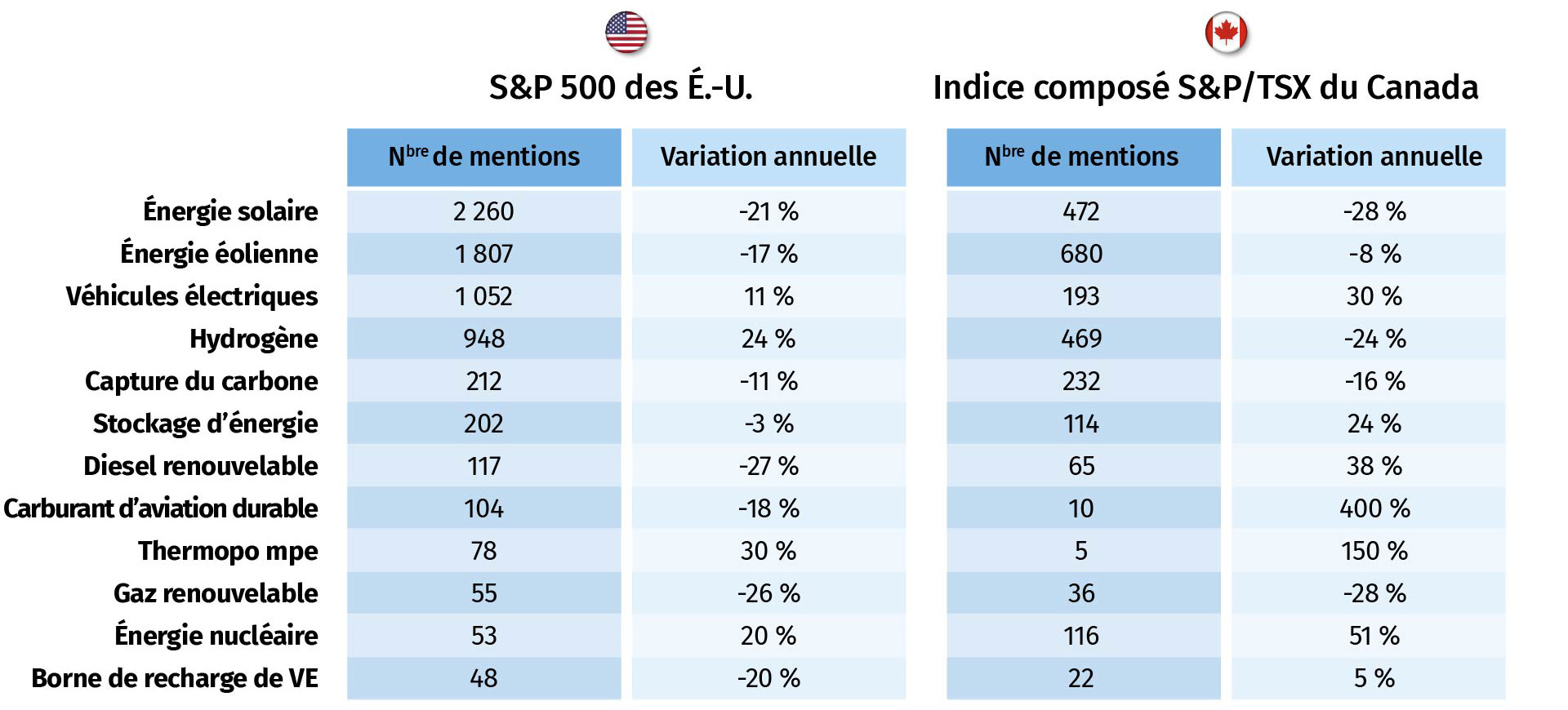
Source:RBC Capital Markets LLC
EN PRIORITÉ
Dépendance au charbon de la Chine
Steven Guilbeault (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), ministre de l’Environnement du gouvernement canadien, s’est rendu en Chine cette semaine pour participer à des rencontres diplomatiques avec un groupe international chargé de conseiller Pékin sur les changements climatiques. Cette visite a suscité l’indignation politique de certains milieux au pays. Le ministre a affirmé qu’il n’y avait « pas de solution » sur le climat sans l’intervention de la Chine.
Quelques statistiques montrent l’ampleur de la dépendance de la Chine à l’égard du charbon :
| 29,18 % | Pourcentage des gaz à effet de serre dans le monde émis par la Chine, ce qui en fait le plus grand pollueur en termes absolus. |
| 60 % | Énergie produite à partir du charbon en Chine. Ce chiffre doit tomber à 5 % d’ici 2050 pour que le secteur de l’électricité en Chine atteigne la carboneutralité d’ici 2055. |
| 68 % | Part de marché de la Chine dans tous les nouveaux projets de charbon en développement à l’échelle mondiale en 2022. |
| 128 GW | Augmentation de la capacité de production d’électricité au charbon prévue en Chine d’ici 2030, soit une hausse de 11 % par rapport aux niveaux actuels. |
Source: Agence internationale de l’énergie, Global Energy Monitor (ce contenu est disponible en anglais seulement)
C’est le moment du retour à l’école. Alors que les jeunes Canadiens retourneront en classe le mois prochain, il est vraisemblable que certains auront vécu de véritables expériences éprouvantes liées au changement climatique (sous forme de feux de forêt, de vagues de chaleur et d’inondations). Le moment est-il venu d’introduire formellement la question du changement climatique dans les curriculums ? Si le New Jersey a récemment posé un tel geste (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), il représente néanmoins un défi de taille. De manière non officielle, sur une année scolaire donnée, environ 40 % (ce contenu est disponible en anglais seulement) des éducateurs canadiens consacrent 10 heures ou moins aux sujets liés au climat tandis qu’un tiers n’en parlent pas du tout et que plusieurs d’entre eux ne se sentent pas suffisamment bien formés pour parler du changement climatique à leurs élèves.
Que dites-vous de l’acronyme BRICSAIEESAU ? Si cet acronyme ne se prononce pas aussi facilement que « BRICS », l’alliance Brésil-Russie-Inde-Chine-Afrique du Sud a invité l’Argentine, l’Iran, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis à leur sommet qui s’est tenu cette semaine en Afrique du Sud (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) Sachant que plusieurs membres sont en désaccord les uns avec les autres (les rivalités opposant la Chine à l’Inde et l’Arabie saoudite à l’Iran étant bien documentées), ce groupe pourrait éprouver de la difficulté à faire front commun sur des enjeux géopolitiques et contrer ce qu’il perçoit comme étant l’argumentaire occidental sur le changement climatique et le financement à faibles émissions de carbone.
Cependant, s’il pouvait parvenir à surmonter ces difficultés, le regroupement de certains des plus grands producteurs et consommateurs de pétrole et de gaz au monde pourrait potentiellement exercer une grande influence sur les politiques mondiales en matière d’énergie et de décarbonation.
Résurrections. Soutenue par le milliardaire Peter Thiel (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), la société américaine Colossal Biosciences s’est fixé pour objectif de redonner vie aux espèces disparues que sont le mammouth laineux, le tigre de Tasmanie et le dronte de Maurice (dodo). Pourrait-on envisager que les choses tournent mal ? La société prétend qu’en redonnant vie au mammouth, elle pourrait contribuer à « réensauvager » la toundra arctique et contribuer à restituer la biodiversité disparue de la région. Si le projet compte sur un financement de 225 millions de dollars américains, il est néanmoins confronté à de formidables défis en matière de bio-ingénierie. Si tout devait se dérouler comme prévu, on pourrait voir des mammouths arpenter l’Arctique dès 2028 (nous soulignons le si).
Climat de colère. Une étude (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) menée auprès de citoyens norvégiens qui éprouvent un sentiment de colère à l’égard du changement climatique est révélatrice : bien que la colère soit le principal vecteur d’activisme et de soutien des politiques, elle ne change pas grand-chose au comportement de la personne qui l’éprouve. Le négationnisme climatique constitue un important déclencheur de la colère alors que près d’un tiers des personnes sondées estiment que les politiciens et l’industrie sont responsables du changement climatique. Une solution fréquemment mise de l’avant par les répondants ? Taxer l’essence pour modifier le comportement de l’industrie et des individus.
Hisser les voiles. Un navire de charge de la société Cargill mû par deux voiles en acier d’une hauteur de 120 pieds (photo ici (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement)) a entrepris cette semaine un voyage entre la Chine et le Brésil afin de mettre la technologie à l’épreuve. Bien qu’elles ne se gonflent pas véritablement, les voiles façonnées de verre et d’acier pourraient permettre de réduire les émissions marines de 30 % et aider l’industrie à respecter les nouvelles règles de l’industrie en matière d’efficacité énergétique.
BÂTIMENTS
Faire face à une crise du logement
La pénurie de logements abordables fut l’un des principaux sujets figurant à l’ordre du jour de la séance de réflexion du gouvernement fédéral qui s’est tenue cette semaine à Charlottetown. La discussion se serait articulée autour d’un nouveau rapport (ce contenu est disponible en anglais seulement) rédigé par des experts en logement tels que Mike Moffatt. Parmi ses 10 recommandations : mettre l’accent sur les locations écoénergétiques.
Il pourrait s’avérer nécessaire d’étendre cette mesure à tous les logements, comme l’a écrit l’Institut d’action climatique RBC dans un récent rapport.
Les émissions résidentielle du Canada comptent parmi les plus élevées du monde
Tonnes de CO2 émises par des résidences, par personne
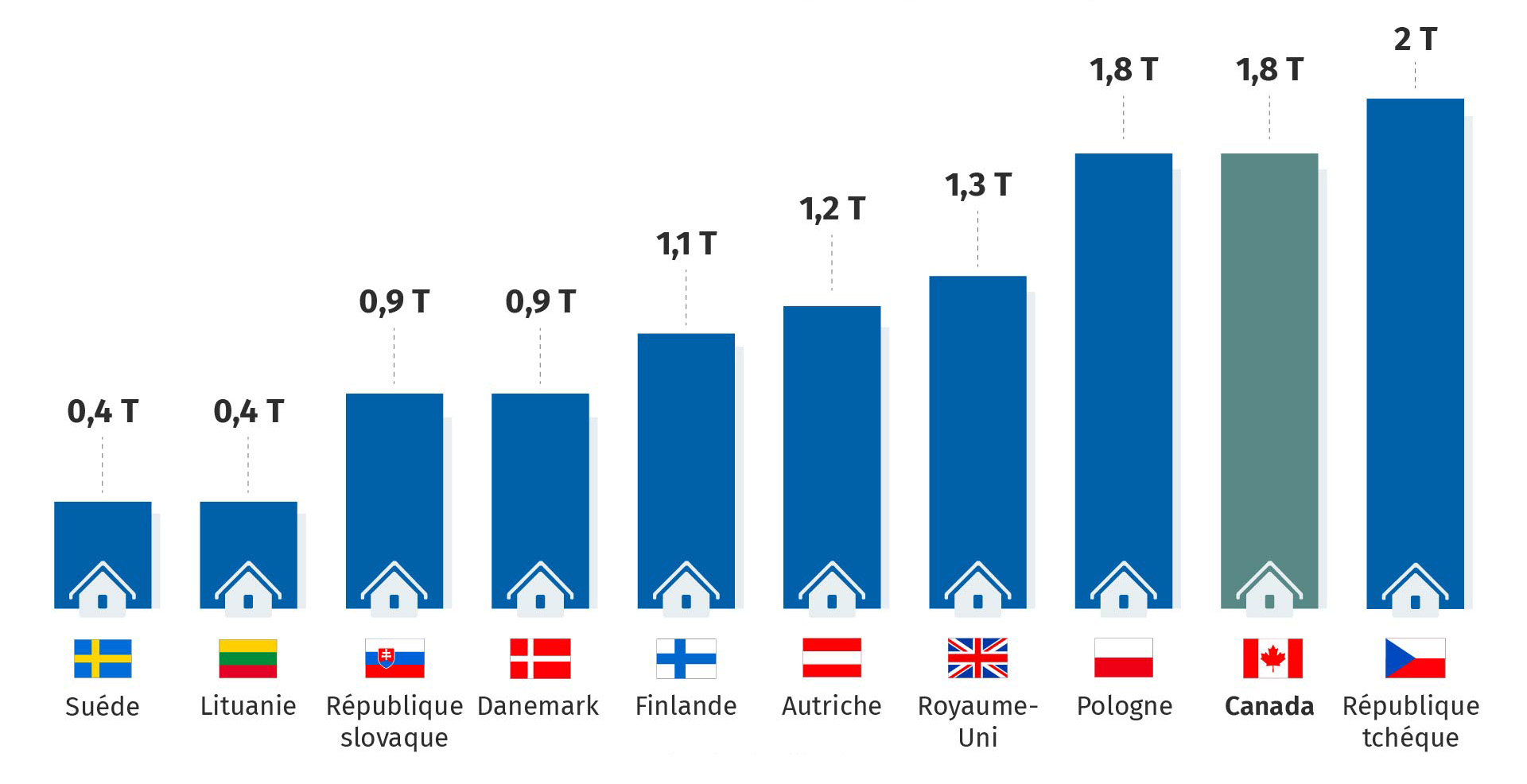
Sources : Institut d’action climatique RBC, OCDE
Voici quelques idées que les décideurs politiques pourraient souhaiter examiner pour sortir de la crise du logement :
- Actualisation des codes : selon nos estimations, construire les 5,8 millions de nouveaux logements dont on estime qu’ils seraient nécessaires d’ici 2030 (ce qui représente une augmentation de 40 % par rapport aux niveaux actuels) en tenant compte des codes de construction actuels ajouterait jusqu’à 18 millions de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre.
- Technologie durable : les thermopompes – qui jouissent déjà d’une certaine popularité dans l’Atlantique et en Colombie-Britannique – devraient devenir largement répandues et remplacer éventuellement les appareils de chauffage au gaz qui génèrent énormément d’émissions.
- Main-d’œuvre : selon nos estimations, le Canada a besoin de 45 % de plus de travailleurs dans le secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation et de 55 % de plus d’électriciens. Le nouveau ministre du Logement, Sean Fraser, a récemment indiqué que la pénurie de compétences (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) constituait un obstacle majeur à la construction de nouvelles maisons.
- Maisons imprimables : des innovations technologiques telles que des bâtiments imprimés en 3D ou préfabriqués pourraient gagner du terrain dans le contexte de codes de construction qui appuient les bâtiments à consommation nette zéro.
- Conceptions à faibles émissions de carbone : des innovations telles que le recours au bois massif pourraient relever le défi du « carbone intrinsèque ». La présence de bois dans les bâtiments de grande hauteur permet d’emprisonner efficacement le carbone pendant plus de 100 ans et de réduire les pertes de chaleur.
Si le thème du logement durable figure en bonne place dans la Stratégie nationale d’adaptation récemment publiée par Ottawa, il s’agit là d’un effort pancanadien alors que des décideurs politiques provinciaux et municipaux, comme la nouvelle mairesse de Toronto, Olivia Chow, s’attaquent également aux défis pressants que représente l’abordabilité du logement. Comme Mike Moffatt l’a indiqué dans un article d’opinion (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), pour s’attaquer à la crise du logement, il convient d’engager un « effort de guerre ». Le moment est venu de faire intervenir les gros canons politiques.
TABLEAU DE LA SEMAINE
L’interruption de la poussée de l’énergie renouvelable dans les Prairies
Les sociétés d’énergie renouvelable auraient elles-mêmes décidé de faire une pause après que le gouvernement de l’Alberta eut suspendu l’approbation de nouveaux projets pendant une période de sept mois pour résoudre les problèmes d’utilisation des terres. Certains analystes (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) s’inquiètent du fait que ce délai pourrait interrompre les efforts engagés par l’Alberta, qui sont les plus importants au pays, pour développer les énergies renouvelables dans le secteur de l’électricité.
Énergie renouvelable en Alberta
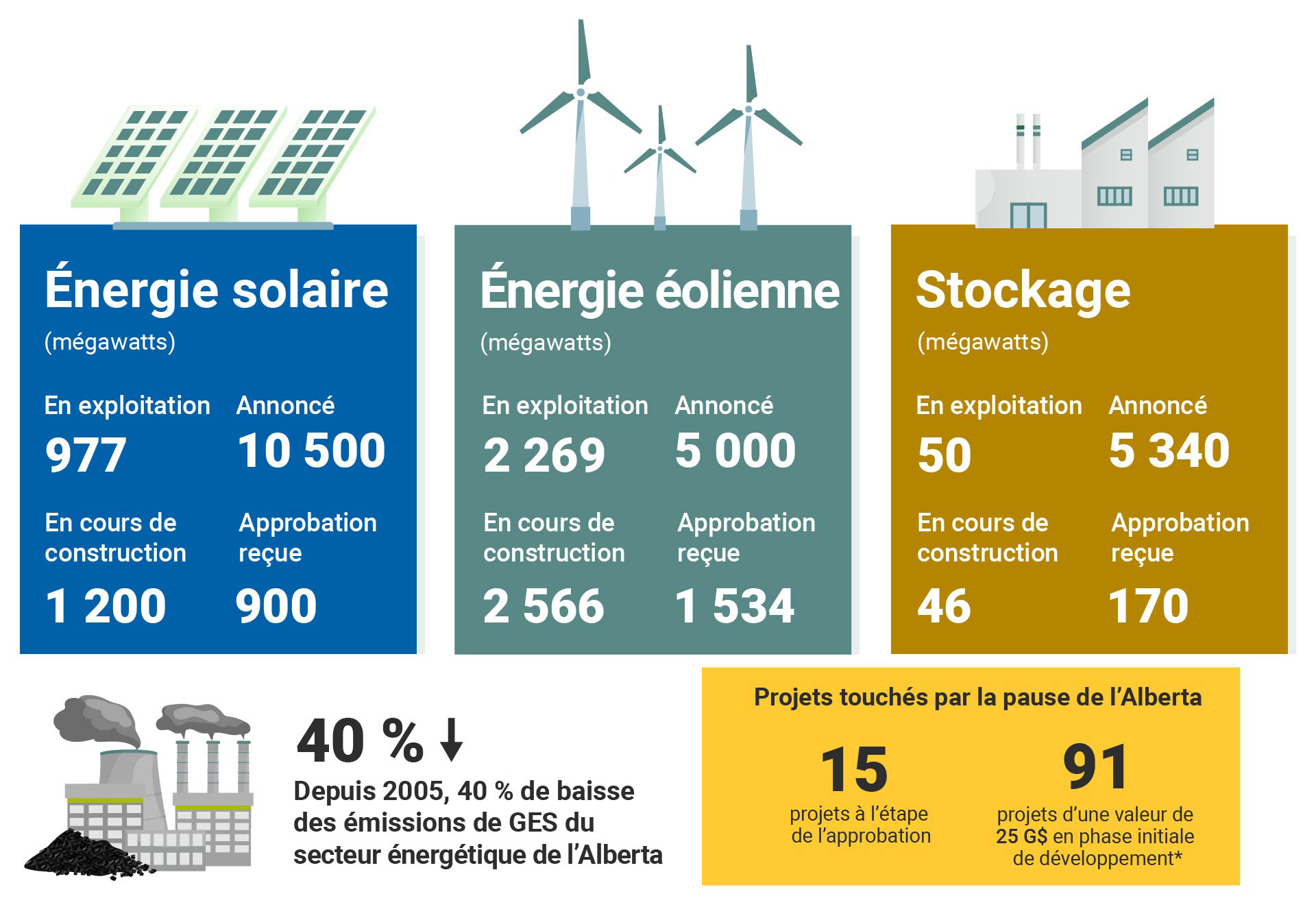
Source : Alberta Electric System Operator, Business Renewables Centre Canada, *prévisions de Pembina Institute
MINÉRAUX CRITIQUES
Une imminente crise des matières premières
La pénurie de nickel et de cobalt pourrait entraver la transition énergétique des États-Unis : tel est l’avertissement que renferme une nouvelle étude (ce contenu est disponible en anglais seulement) menée par la société S&P Global, sous la direction de l’historien de l’énergie, Daniel Yergin. La loi américaine sur la réduction de l’inflation et d’autres mesures visant à réduire les émissions entraîneraient une multiplication de la demande américaine en matière de cobalt, de lithium et de nickel selon un facteur de 20 à 27 par rapport aux niveaux actuels. Cependant, les pénuries pourraient freiner la transition.
Demande De Minéraux Critiques Aux États-unis
Milliers de tonnes métriques
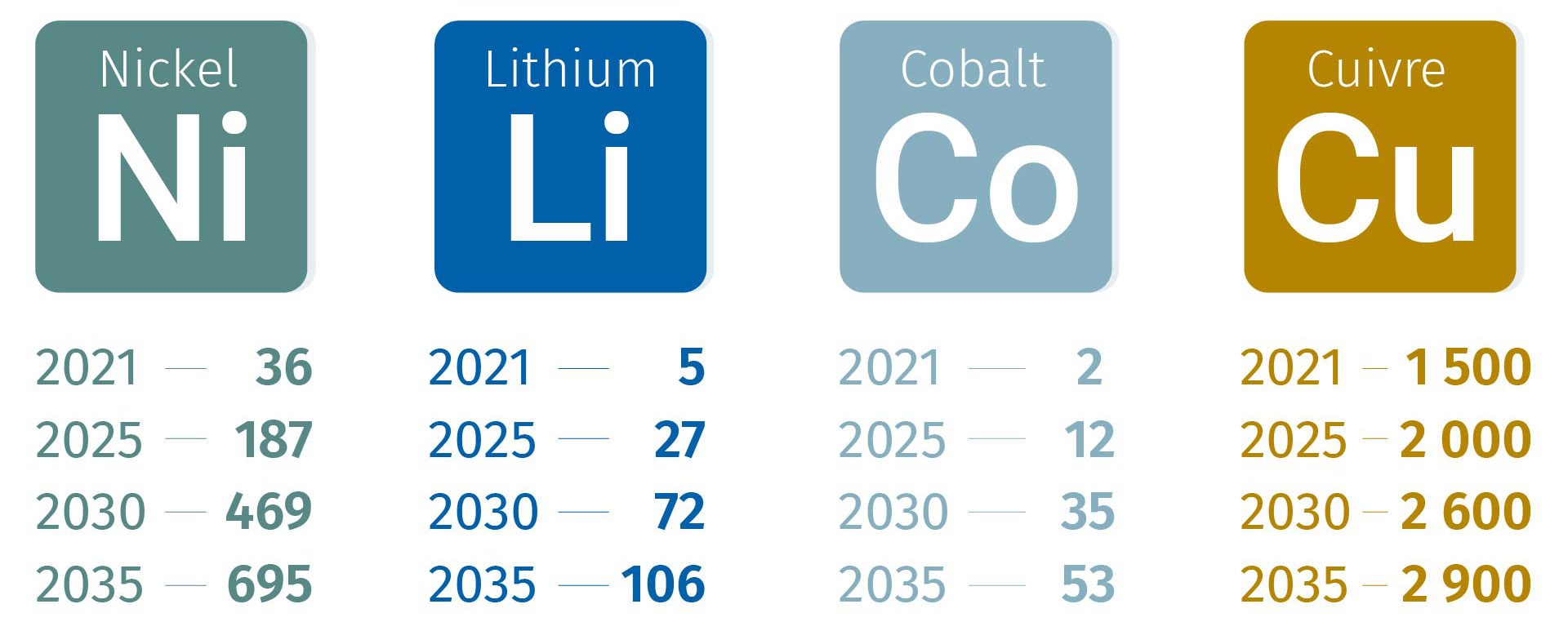
Source : S&P Global
Quelques faits saillants du rapport :
- Des gisements importants de métaux critiques comme le cobalt, le cuivre, le lithium et le nickel sont contrôlés par des « entités étrangères préoccupantes », que les États-Unis considèrent comme hostiles.
- Les alliés que sont le Canada et l’Australie produisent suffisamment de cobalt pour répondre à la demande américaine liée à la transition énergétique, cependant que seulement 12 % et 3 % de leurs exportations, respectivement, sont destinées aux États-Unis.
- La production de nickel est concentrée dans des pays qui n’ont pas d’accord de libre-échange avec les États-Unis.
- Environ 90 % des importations américaines de lithium proviennent d’Argentine et du Chili. La capacité prévue aux États-Unis, au Canada et en Australie doit être en mesure de protéger l’industrie américaine en plein essor des véhicules électriques.
- D’ici 2030, la demande intérieure de nickel aux États-Unis dépassera probablement la production totale des pays avec lesquels les États-Unis ont conclu un accord commercial.
- Le Chili et le Pérou sont les principaux producteurs de cuivre, « le métal de l’électrification ». Cependant, la Chine contrôle près de la moitié de l’approvisionnement dans ces pays. Les difficultés sur le plan de la délivrance des permis aux États-Unis ainsi que les ajouts limités de capacité mettent en péril l’accès américain au cuivre.
Les causes d’inquiétude ne manquent pas. Les superpuissances en matière de minéraux critiques telles que le Chili (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), la République démocratique du Congo, le Zimbabwe et la Namibie mettent en place de nouveaux prélèvements et de nouvelles politiques, des interdictions à l’exportation et même des restrictions d’approvisionnement, comme le fit jadis l’OPEC, pour garantir l’obtention de prix plus élevés pour leurs matières premières. On note également une crainte de militarisation des minéraux critiques, tout comme la Russie a tiré parti de son statut à titre de fournisseur de pétrole et de gaz pour mettre l’Europe à mal.
Si la transition énergétique passe par les mines, l’Occident devra être prêt à s’investir.
DANS LA MIRE
Migration climatique au Canada
Les Canadiens fuient temporairement les villes de Yellowknife et de Kelowna qui ont été durement touchées par des conditions météorologiques extrêmes. Selon un nouveau sondage Angus Reid (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), certains sembleraient envisager de déménager de manière plus définitive, selon ce qui semble être un indicateur précoce d’un phénomène de migration lié au climat chez les Canadiens.
Quelques faits saillants du sondage mené auprès de 1 600 Canadiens :
| 13 % | Pourcentage de Canadiens qui cherchent à déménager de manière définitive pour éviter les feux de forêt et la fumée ; les jeunes adultes sont plus anxieux, alors qu’un quart d’entre eux cherchent à quitter les endroits plus vulnérables au climat. |
| 63 % | Proportion de Canadiens qui estiment que le changement climatique est une crise à laquelle il faut remédier ; 10 % d’entre eux pensent qu’il est déjà trop tard. |
| 55 % | Pourcentage de Canadiens qui croient que les feux de forêt vont s’aggraver à l’avenir. Seulement 8 % s’attendent à des conditions climatiques modérées à l’avenir. |
| 53 % | Pourcentage de Canadiens qui ont été contraints de rester à l’intérieur pour éviter la fumée et la chaleur cet été. Un quart d’entre eux ont réduit leurs activités physiques tandis qu’un cinquième ont vu leur santé affectée par la fumée. |
Source : Angus Reid Institute.
L’ACTION CLIMATIQUE
It’s been an unrelenting summer, but we refuse to doomscroll. The brutal force of climate change (the Northwest Territories and Maui being the latest victims) has galvanized regular folks (see Montana youth and Climate Dads below), while new policies and capital flows are leaning towards climate action.
Le pari de Warren Buffet. Forte du soutien de Warren Buffett, Occidental Petroleum (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) a acquis la jeune pousse britanno-colombienne Carbon Engineering pour 1,1 milliard de dollars US. En jeu : la technologie novatrice mise au point par son fondateur, David Keith (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), pour éliminer le carbone. Les deux parties se connaissent bien : Carbon Engineering participe au projet Stratos que mène Occidental au Texas et qui devrait être le plus ambitieux du genre en 2025, date de mise en service des installations. C’est d’ailleurs l’un des deux projets pour lesquels le ministère américain de l’énergie (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) a prévu, la semaine dernière, une enveloppe totale de 1,2 milliard de dollars US.
L’inaction climatique face aux tribunaux. La sentence a fait du bruit : selon un tribunal du Montana (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), ce gros producteur de charbon a, en privilégiant les combustibles fossiles, bafoué les droits d’un enfant de neuf ans et de 15 autres jeunes coplaignants à un « environnement propre et sain ». Dans le verdict (ce contenu est disponible en anglais seulement), on lit notamment que le Montana n’a pas pris en compte les émissions de GES des projets de production d’énergie avant d’approuver ceux-ci. Le procureur général de l’État en appellera auprès de la Cour suprême du Montana. Les poursuites intentées jusqu’ici pour des motifs similaires avaient échoué. Cette première sentence rendue aux États-Unis pourrait donc préluder à une vague de procès du même genre.
Un superconducteur… de supermarché. Bien que largement mise en doute (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), une expérience menée en Corée du Sud a relancé le débat sur l’un des plus grands défis de la physique. Des chercheurs ont en effet prétendu (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) qu’une certaine combinaison de cuivre, de plomb, de phosphore et d’oxygène pouvait laisser passer un courant continu sans pertes, constituant ainsi un superconducteur qui révolutionnerait la production et le transport d’électricité. Trains en suspension, batteries à charge ultrarapide… : combinée à la fusion nucléaire, l’électricité dépasserait de loin les autres sources d’énergie. L’expérience coréenne n’a pas résisté à l’examen, mais des investisseurs (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) misent désormais sur l’un des buts ultimes de la physique (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement)
Des pères montent au créneau Un regroupement (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) de 800 jeunes papas qu’inquiètent les changements climatiques souhaite susciter l’engouement des jeunes pour les protéines d’origine végétale (dites adieu aux grillades !) et les thermopompes. En fait, ce genre de père se rencontre partout. D’après un sondage (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), certains entendent réduire la taille de leur maison pour diminuer leur empreinte carbone. De nouveaux sujets de plaisanteries en perspective…
L’action climatique
REP : des aménagements en faveur du gaz
Les consultations menées l’an dernier autour du Règlement sur l’électricité propre (REP) ont suscité des tensions entre Ottawa et les provinces qui dépendent des énergies fossiles. Publiée la semaine dernière, la version préliminaire des règles du REP constitue un geste de bonne volonté envers l’Alberta et la Saskatchewan, qui militent pour le maintien de centrales au gaz.
En voici les traits saillants.
- Un plafond plus élevé. Une centrale au gaz non équipée de dispositifs de réduction des émissions en émet annuellement de 400 à 500 tonnes par gigawattheure (GWh). De grandes centrales pourront encore être mises en service après 2035, sous réserve de ne pas dépasser le seuil annuel moyen de 30 tonnes de CO2 par GWh d’électricité produite.
- Des coudées plus franches. Aux fins des exigences de fiabilité, les turbines à gaz d’appoint non modifiées pourront fonctionner 5 % du temps sans respecter la norme sur les émissions.
- Une quasi absolution. Les émissions des turbines au gaz en service avant 2025 seront non plafonnées pendant 20 ans. Les centrales construites après 2025 pourront émettre jusqu’en 2035 mais devront ensuite se conformer au règlement.
- Les systèmes de réduction à la rescousse. Les exploitants de centrales au gaz qui installeront des dispositifs de capture du carbone pourront demander une dérogation : leurs émissions annuelles moyennes pourront atteindre 40 tonnes/GWh pendant les 7 années suivant la mise en service du dispositif.
Certaines provinces auront du mal à atteindre la carboneutralité d’ici 2035
Émissions de GES dues au secteur de l’électricité
| Province ou territoire | Émissions de GES des réseaux électriques (en mégatonnes) | Part des réseaux dans les émissions totales de la région | Part de l’électricité propre ou renouvelable (%) |
|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | 0,4 | 1 | 97,5 |
| Alberta | 32,7 | 13 | 15,1 |
| Saskatchewan | 13,9 | 21 | 14,1 |
| Manitoba | 0 | 0 | 99,8 |
| Ontario | 3,7 | 2 | 92,3 |
| Quebec | 0,3 | 0 | 99,7 |
| Nouveau-Brunswick | 3,5 | 28 | 73,4 |
| Nouvelle-Écosse | 6,3 | 43 | 26,6 |
| Île-du-Prince-Édouard | 0 | 0 | 99,3 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 1 | 10 | 97,8 |
| Yukon | 0,1 | 9 | 72,8 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0,1 | 4 | 68,7 |
| Nunavut | 0,2 | 25 | 0,2 |
| Canada | 62,1 | 9 | 82,6 |
Source: Environnement et Changement climatique Canada, Régie de l’énergie du Canada, Institut d’action climatique RBC
Les règles permettent à l’Alberta et à la Saskatchewan de respirer, mais des incitatifs ont été prévus dans le budget de 2023 pour amener les provinces à se passer graduellement du gaz naturel pour la production d’électricité.
Lisez l’analyse complète ici.
Sur le même sujet : Les producteurs d’énergie renouvelable veulent en savoir plus sur le moratoire albertain (The Globe and Mail, ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement)
TABLEAU DE LA SEMAINE
L’empreinte carbone du Canada atteint des sommets
Les feux de forêt risquent de changer complètement la donne. D’après les premières estimations de Ressources naturelles Canada (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), les incendies ont libéré environ 1,42 milliard de tonnes d’équivalent CO2 depuis la mi-juillet, soit le double des émissions totales du pays recensées en 2021. Les feux ont également ravagé des régions entières en Europe, en Asie centrale et dernièrement à Maui. Quel en sera l’impact sur les émissions mondiales cette année ?
Feux de forêt au Canada: les émissions explosent
Millions de tonnes d’équivalent CO2 émises
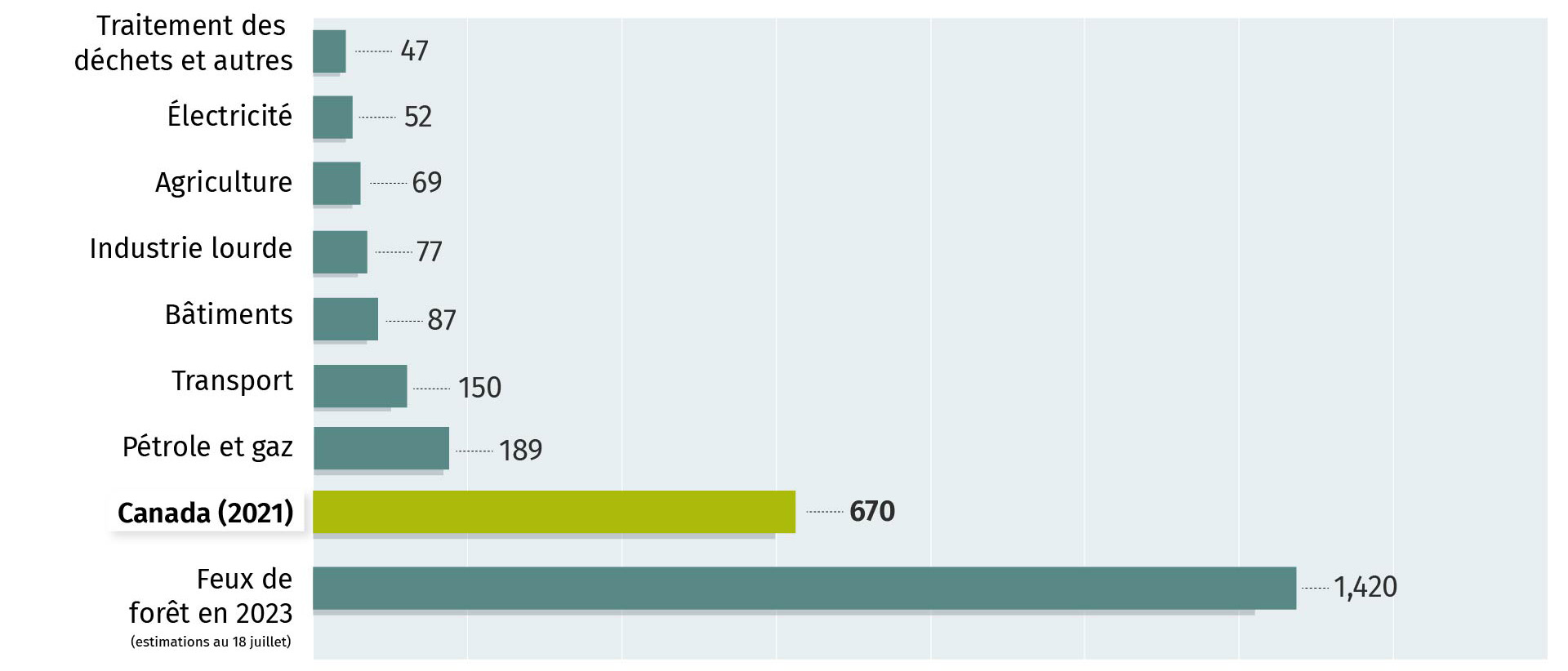
Source: Ressources naturelles Canada et Bloomberg
POLITIQUES PUBLIQUES
L’IRA a un an
Une course aux investissements
Investissements consacrés à l’énergie propre depuis un an (É.-U.)
| Sectors | # of projects | Investments (US$ Bn) | Jobs |
|---|---|---|---|
| 91 | 77,7 | 92,918 | |
| 25 | 133,38 | 18,588 | |
| 65 | 44,1 | 32,428 | |
| 13 | 4,73 | 2,413 | |
| 12 | 11,71 | 7,140 | |
| 56 | 20,85 | 21,572 | |
| 29 | 20,07 | 8,020 |
Source: Climate Power (16 août 2022-25 juillet 2023)
L’IRA a un an Il y a un an presque jour pour jour, Joe Biden signait l’Inflation Reduction Act (IRA). L’impact de cette loi sur l’inflation reste à préciser, mais le marché des énergies renouvelables, lui, a fortement réagi :
- D’après le cabinet d’études Climate Power (ce contenu est disponible en anglais seulement), plus de 280 nouveaux projets d’une valeur totale dépassant 278 milliards de dollars US ont été annoncés dans 44 États, avec 170 000 emplois à la clé.
- De ce nombre, 152 projets totalisant 225 milliards de dollars US ont été annoncés dans 92 districts républicains, où seront ainsi créés 96 000 emplois.
- C’est au Michigan qu’on note le plus de projets (24) découlant de l’IRA. Viennent ensuite la Géorgie (22 projets), la Caroline du Sud (20), la Californie (16) et le Texas (14).
Malgré toutes les promesses contenues dans l’IRA, les États-Unis auront sans doute du mal à atteindre leur objectif inscrit dans l’Accord de Paris – réduire leurs émissions, d’ici 2030, de 50-52 % par rapport à celles de 2005. Rhodium Group (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) prévoit que la réduction ne sera que d’environ 42 %.
EN PRIORITÉ
Le blues de la ceinture verte
La semaine dernière, le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario a déclaré que la décision du gouvernement ontarien de construire massivement dans la ceinture verte de la province n’était ni transparente, ni équitable, ni objective, ni parfaitement éclairée. La crise du logement n’imposait pas une telle mesure, selon la vérificatrice générale, qui ajoute que celle-ci va entraîner la dégradation des espaces verts existants et l’aggravation des changements climatiques.
Qu’il s’agisse de maintenir la biodiversité ou de contribuer à atténuer les effets des changements climatique dans la province, la ceinture verte joue en effet un rôle essentiel :
| 2 millions d’acres | Superficie des terres protégées autour de la Région du Grand Toronto. Créée en 2005, la ceinture absorbe 71 millions de tonnes d’équivalent CO2, soit les émissions annuelles de 56,5 millions d’automobiles. |
| 78 | Nombre d’espèces en péril présentes dans la ceinture verte. Celle-ci contient également 721 000 acres de milieux humides, de prairies et de forêts. |
| 7 412,64 acres | Superficie que le gouvernement ontarien vient de rendre constructible dans la ceinture verte. Aux fins de conformité réglementaire, le gouvernement a prévu 9 400 acres supplémentaires ailleurs. |
| 29 | Nombre d’espèces en péril vivant ou susceptibles de vivre dans les zones retirées de la ceinture et dont 76 % étaient utilisées à des fins agricoles. |
Source: Greenbelt Foundation et Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario
L’action climatique
Ce que nous surveillons
Le site anciennement connu sous le nom de Twitter semble avoir pris un mauvais virage. Les résultats des recherches portant sur le mot « climat » sur la nouvelle plateforme « X » regorgent de conspirations climatiques et de prises de position délibérément provocantes et irrationnelles sur les vagues de chaleur, les utilisateurs sérieux semblant pour leur part avoir largement tourné le dos à la plateforme qui se targuait jusqu’alors d’être la place publique de la planète.
Nouvelle énergie : Jonathan Wilkinson a ajouté le volet « Énergie » à son portefeuille à titre de ministre des Ressources naturelles dans le cadre du dernier remaniement ministériel fédéral. Ce changement souligne peut-être l’ampleur de la tâche nécessaire pour réduire les émissions de pétrole et de gaz et se doter d’un système énergétique à faibles émissions.
Les coupables du climat : la main de l’homme semble omniprésente dans la vague de chaleur que nous connaissons actuellement. C’est à tout le moins ce que prétendent des chercheurs de l’Imperial College London (ce contenu est disponible en anglais seulement) Les auteurs estiment – avec « certitude » – que la période de conditions météorologiques extrêmes que connaît actuellement l’Amérique du Nord aurait été « pratiquement impossible », si ce n’était des changements climatiques induits par l’homme.
Non coupable : un juge britannique a rejeté la poursuite engagée par un groupe d’activistes à l’encontre du conseil d’administration de la société Shell, en faisant valoir que cette poursuite « faisait abstraction » de la taille et de la complexité de l’entreprise. Il est cependant peu probable que l’avalanche de poursuites liées au climat s’atténue puisqu’on dénombre actuellement 151 poursuites engagées à l’encontre de sociétés (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) à travers le monde, ce nombre étant de 35 au Canada.
Frissons estivaux : l’actrice Jamie Lee Curtis a lancé un roman plutôt explicite et noir sur le thème de l’environnement dans le cadre du Comic-Con de San Diego. Son roman porte sur un projet pétrolier (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) « expérimental » qui aurait mal tourné, cette situation menant à une catastrophe écologique. Sont également présentés trois ouvrages plus légers sur le thème du climat (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) qui conviennent parfaitement bien à cette période estivale.
Signaux climatiques prendra une pause de deux semaines. Nous vous invitons à nous retrouver dans votre boîte de réception le 18 août.
TABLEAU DE LA SEMAINE
Puissance mondiale dans le domaine des métaux verts
Un nouveau classement BloombergNEF place le Canada au deuxième rang, après l’Australie, au chapitre du développement de métaux et de minéraux critiques qui sont essentiels pour la transition énergétique. Bien que ces réserves de métaux verts puissent ne pas être vastes, le cadre réglementaire et le bassin de talents dont jouit le Canada pourraient transformer le pays en une puissance sur le plan métallurgique, comme le montre le classement.
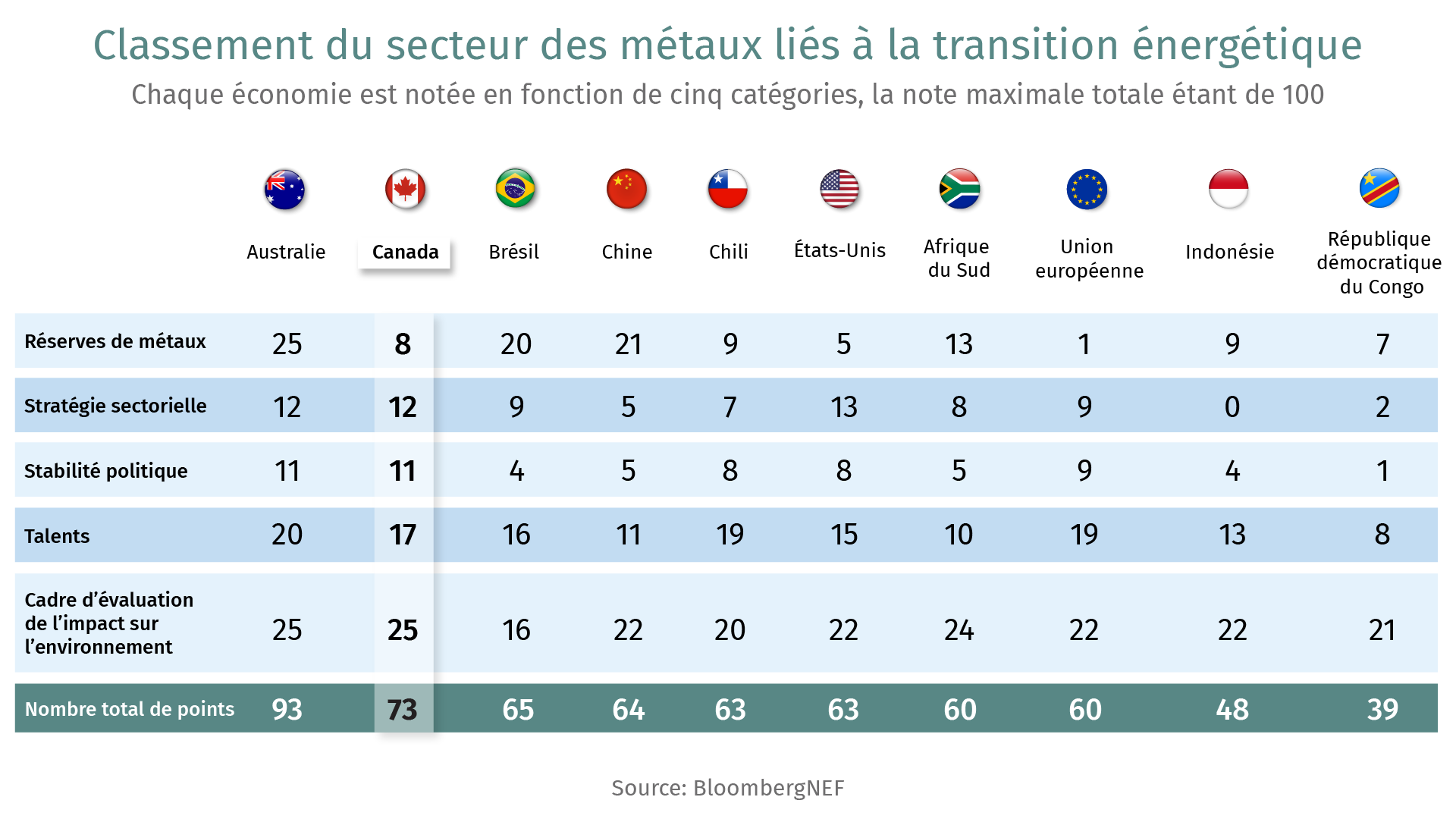
ÉNERGIE
Trois échappatoires dans le domaine des subventions aux combustibles fossiles
Le Canada a publié un cadre qui vise à éliminer les subventions inefficaces aux combustibles fossiles et ce pays est le premier des nations membres du G20 à agir en ce sens. Cependant, la situation n’est pas tout à fait aussi claire qu’elle pourrait le sembler dans la mesure où six avenues pourraient permettre au gouvernement fédéral de faciliter le développement des combustibles fossiles. Trois des exclusions qui ont retenu notre attention visent les projets qui présentent les caractéristiques suivantes :
No 1. Permettre d’importantes réductions nettes de GES au Canada ou à l’étranger grâce à l’article 6 de l’Accord de Paris. Le Canada pourrait vraisemblablement obtenir des crédits de carbone si, par exemple, le Japon devait réduire sa consommation de charbon en conséquence directe des exportations de GNL à destination de ce pays et en provenance de Colombie-Britannique.
No 2. Faire intervenir la participation des groupes autochtones. Pour assurer la réconciliation économique, il est essentiel que les groupes autochtones jouissent d’avenues de développement économique. Et, comme les exportations de gaz naturel liquéfié sont soutenues par des groupes autochtones et que de nombreuses Premières Nations assurent la prestation de services pour des projets de sables bitumineux, il semble peu probable que l’industrie se laisse empêtrer par la nouvelle politique.
No 3. Appuyer le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC), ou disposer d’un plan crédible pour parvenir à des émissions nettes nulles d’ici 2030. Le poste de dépenses le plus important des sables bitumineux ne sera pas touché par la nouvelle règle prévoyant l’absence de subventions.
AGRICULTURE
La pratique de l’agriculture dans des conditions météorologiques extrêmes
Imaginez ce que cela signifie que de se retrouver aux premières lignes du changement climatique : les agriculteurs figurent parmi les premiers à subir le contrecoup économique des vagues de chaleur qui sévissent actuellement à travers le monde.
Alors que la saison des récoltes devrait débuter dans quelques semaines à peine, une vingtaine de municipalités de la Saskatchewan (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) touchées par la sécheresse, cette province étant le grenier à blé du Canada, ont déclaré l’état d’urgence. Un essaim de sauterelles inhabituellement important (et dont la présence s’explique en partie en raison des conditions climatiques inhabituelles) a également entrepris de ravager les cultures de la province. En Alberta, certains producteurs ont dû abandonner des cultures ou vendre du bétail en raison d’un manque de précipitations et d’aliments pour le bétail.
Lutte alimentaire : le faible rendement des cultures est un nouveau phénomène mondial qui pourrait entraîner une hausse du prix des denrées alimentaires. Les vagues de chaleur qui sévissent en Europe et aux États-Unis mettent également à mal le rendement, alors que les prix du maïs, de l’avoine et du soja augmentent. Confrontée à des vagues de chaleur extrêmes et à des inondations, l’Inde interdit la vente de certaines variétés de riz afin de lui permettre de répondre à la demande intérieure, tandis que la Russie s’est retirée d’un accord portant sur l’exportation des céréales qui autorisait le flux pacifique d’exportations alimentaires en provenance d’Ukraine. Cette série de coups durs risque de déclencher des hausses de prix et de créer des problèmes de sécurité alimentaire dans de nombreux pays, estime le FMI, qui a émis un avertissement en ce sens (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement)
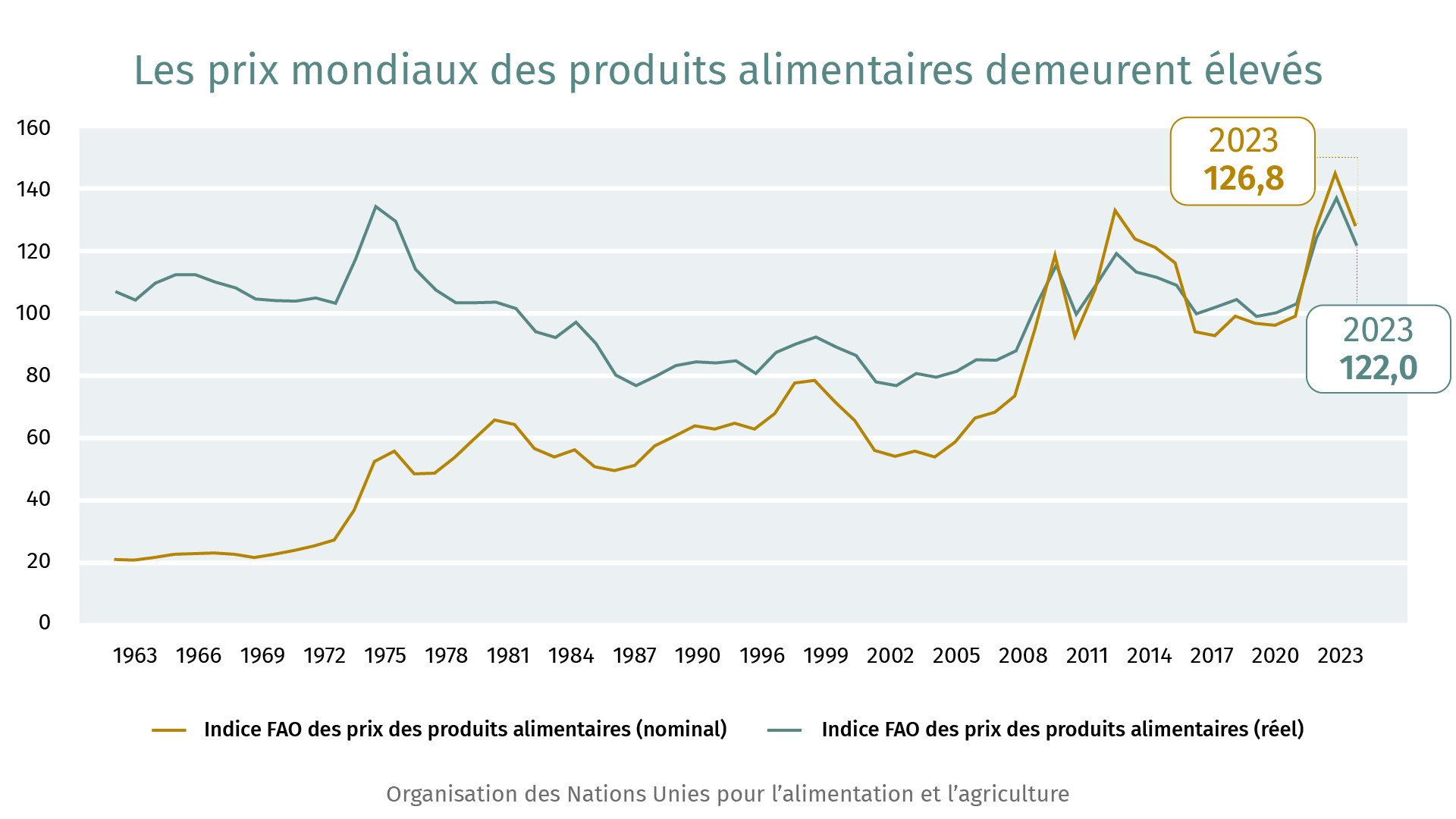
Nouvelle révolution verte : s’il n’existe aucune solution instantanée, pour le Canada, le défi consiste à accroître la production alimentaire et à réduire les émissions pour un monde affamé. Dans une série de récents rapports portant sur le thème de l’agriculture, RBC a identifié les stratégies qui pourraient nous mettre sur la voie d’une hausse de la production alimentaire conjuguée à une réduction des émissions. Vous pourrez en apprendre plus ici.
EN VEDETTE
Dans quelle mesure l’IA est-elle verte ?
Si ChatGPT peut changer le monde, cet outil pourrait également augmenter le niveau de pollution. Le dernier jouet à la mode de l’industrie technologique présente une empreinte carbone plutôt conséquente – et la situation ne fait que commencer, d’autant plus que les joueurs les plus importants dans le domaine de l’IA, soit les sociétés Microsoft et Alphabet, ont entrepris de construire des centres de données encore plus énergivores afin de répondre à la demande croissante de services d’IA propres à l’ère qui est désormais la nôtre.
| 502 tonnes | Émissions de GES produites l’an dernier pour former l’outil GPT 3 de la société Microsoft, volume équivalant à ce qu’auraient produit 123 véhicules de tourisme alimentés à l’essence pendant un an. |
| 0,8-1 kg CO2e | Émissions générées par une seule requête de type IA, soit un niveau 4 à 5 fois supérieur à celui qui est associé à une simple recherche Google. |
| 2,3 TWh | Puissance requise annuellement pour l’IA de Google, soit une puissance équivalente à celle qui permet d’alimenter toutes les maisons d’Atlanta. |
| 2 | Pourcentage des émissions mondiales générées par les centres de données dont est tributaire l’IA, soit l’équivalent de l’empreinte de l’industrie aéronautique. |
Source : Université Stanford, Bloomberg, carboncredits.com (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement)
L’action climatique
Ce que nous surveillons :
« Relève plus de la contrainte que de l’incitation » : tel est le jugement concis qu’a porté la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, sur la série de politiques climatiques d’Ottawa en voie d’être mises en œuvre. Plusieurs premiers ministres ont fait écho à ceSuralimenter les chaînes d’approvisionnement des véhicules électriques sentiment lors de leur sommet annuel, ceux-ci s’inquiétant du fait que les politiques climatiques fédérales nuisent à la croissance. Pour sa part, Ottawa a rétorqué qu’une économie à faibles émissions de carbone stimulera l’innovation.
#Restorenature : tel fut le mot-clic retenu par l’activiste Greta Thunberg pour inciter les membres du Parlement européen à voter en faveur d’une loi renforcée portant sur restauration de la nature. Le parti détenant le plus de sièges au Parlement s’est opposé à l’accord en raison de préoccupations concernant les hausses de prix pour les consommateurs de même que l’impact sur les agriculteurs et le secteur alimentaire. La loi a cependant été adoptée, bien qu’avec une très faible majorité.
Un lac canadien marque le début d’une nouvelle ère géologique. Le changement climatique d’origine humaine et la perte de biodiversité figurent parmi les raisons pour lesquelles certains scientifiques sont d’avis que nous sommes maintenant dans l’ère de l’anthropocène. Cette nouvelle période possède même un épicentre. En effet, du fait de ses caractéristiques particulières, le lac Crawford, qui se situe à 60 km à l’ouest de Toronto, a été choisi par les scientifiques comme constituant l’endroit qui témoigne le mieux du début de l’époque géologique marquée par l’activité humaine.
GRAPHIQUE DE LA SEMAINE
Suralimenter les chaînes d’approvisionnement des véhicules électriques
Alors que les nuages qui planaient sur l’accord entre les sociétés Stellantis et LG sont en voie de se dissiper, le Canada jouit d’une situation enviable dans l’espace émergent des chaînes d’approvisionnement des véhicules électriques. Si Ottawa examine un certain nombre d’autres projets d’envergure similaire, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie du Canada, François-Philippe Champagne, estime, en s’exprimant d’un ton légèrement réservé, que « nous n’irons pas plus loin car c’est tout ce que le Canada peut se permettre » [Traduction]. Qu’en est-il de l’ambition ?
Voici ce que le Canada est parvenu à attirer jusqu’à présent :
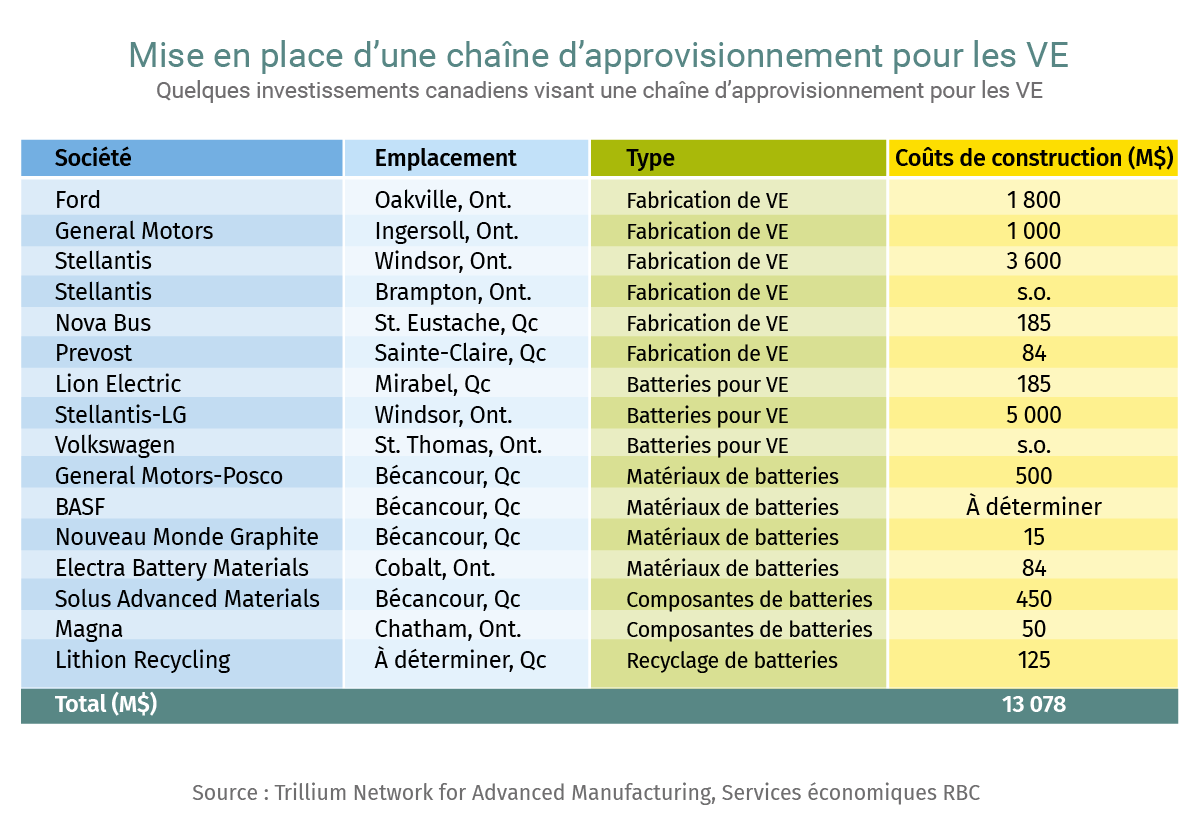
AUTOCHTONES
Un puissant trio en matière de GNL
Le temps est venu d’ajouter l’uranium à la liste des minéraux confrontés à des pénuries critiques.
Un trio de puissantes femmes autochtones présente un argumentaire de vente convaincant au Canada : un secteur du gaz naturel liquéfié (GNL) entre les mains des Premières Nations serait synonyme de discipline rigoureuse en matière environnementale. Crystal Smith, de la Nation Haisla, Eva Clayton, du gouvernement Nisga’a Lisims, et Karen Ogen, de la First Nations LNG Alliance, n’ont pas ménagé leurs efforts cette semaine pour vanter les mérites des projets d’exportation de GNL de la côte Ouest, alors que des représentants du monde entier du secteur du GNL se réunissaient à Vancouver.
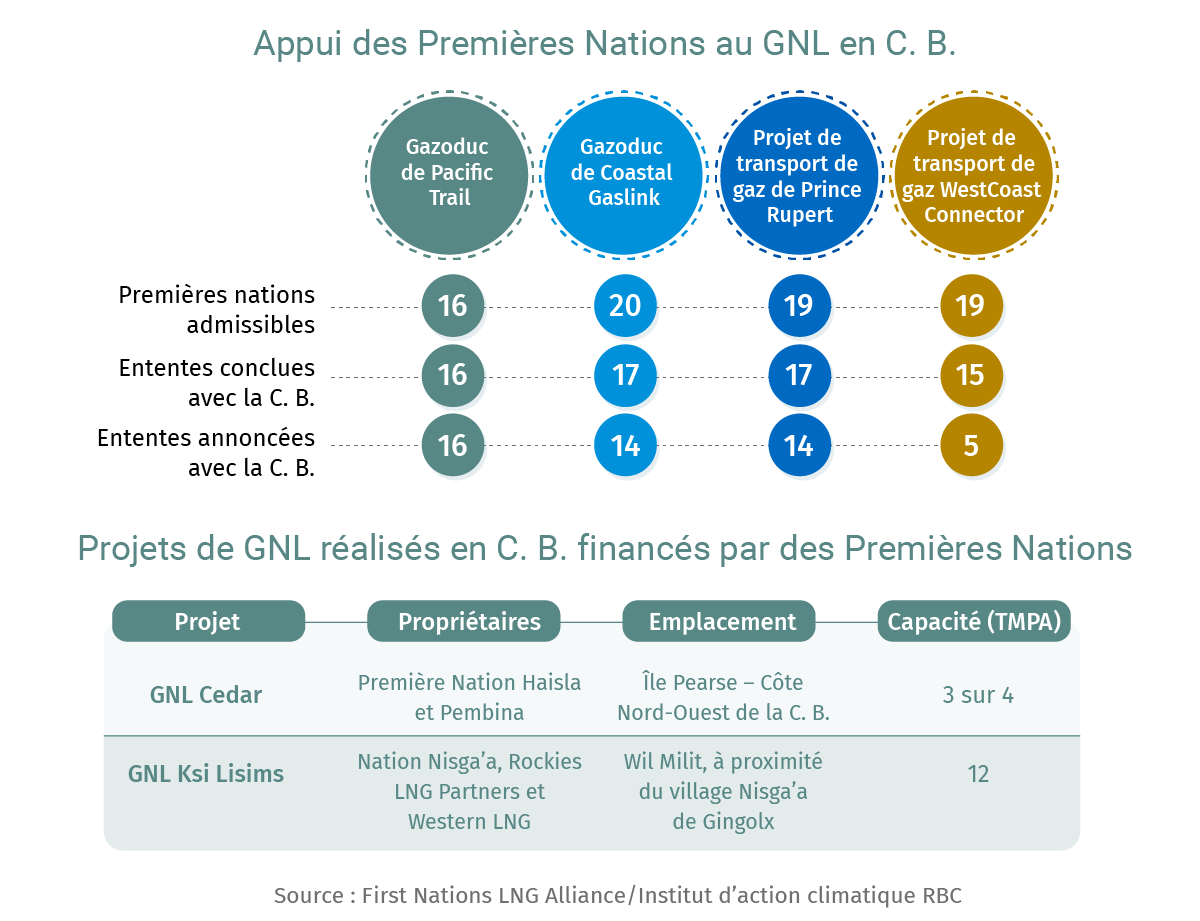
La situation délicate du gaz : dans la foulée du conflit en Ukraine, le gaz est devenu une source d’énergie vitale mais néanmoins controversée. Pour les partisans du gaz, le fait de remplacer le charbon par le gaz naturel pourrait permettre de réduire rapidement les émissions en croissance rapide d’Asie. Pour leur part, les sceptiques font valoir que le fait de demeurer tributaire du gaz naturel ne fait que retarder l’adoption de sources d’énergie à zéro émission.
L’argumentaire autochtone : appuyée par la Nation Haisla et la société du secteur intermédiaire Pembina, Cedar LNG a déjà obtenu des approbations environnementales et elle vise une décision finale en matière d’investissement d’ici le quatrième trimestre de 2023. Les responsables de Woodfibre LNG, un plus petit projet piloté par les sociétés Pacific Energy Corp. et Enbridge, ont signé une entente sur les répercussions et les avantages avec la Nation Squamish, tandis que la Nation Nisga’a et un groupe de producteurs de pétrole et de gaz basé à Calgary appuient l’énorme projet GNL Ksi Lisims.
Permis pour exporter ? Le soutien autochtone confère au GNL une soi-disant acceptabilité sociale (bien que tous les groupes autochtones ne soutiennent pas les projets). Cependant, demeurent sans réponse un certain nombre de questions portant sur l’impact environnemental avant qu’une licence d’exportation puisse être délivrée. La modélisation réalisée par le Pembina Institute montre que le développement de la phase 1 du projet LNG Canada ayant reçu le soutien de Shell et de Woodfibre LNG signifierait que le niveau des émissions du secteur dépasserait largement les objectifs sectoriels de la province fixés pour 2030. Si les projets Cedar et Ksi Lisims devaient également aller de l’avant, le total des émissions pourrait tripler par rapport aux objectifs.
Article 6 : une clause de l’Accord de Paris qui permet aux pays – à tout le moins en théorie – de recevoir le crédit de la réduction d’émissions dans d’autres pays a figuré parmi les sujets de discussion évoqués entre la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, en marge du Stampede de Calgary. Cependant, l’article 6 est loin de sa version définitive, les consommateurs étant réticents à transférer des émissions durement acquises aux producteurs. Un rapport de l’Institut d’action climatique RBC publié en avril et portant sur l’énigme que représente le GNL canadien montrait que le niveau mondial des émissions nettes pourrait reculer de 105 Mt éq. CO2 si le GNL canadien parvenait à remplacer le charbon consommé en Asie, cependant que le niveau canadien des émissions augmenterait de 16,6 Mt éq. CO2.
ÉNERGIE
Un réseau vert
Publiée cette semaine, la stratégie en matière de réseau propre de l’Ontario donne un peu l’impression d’inclure « tout ce qui précède ».
La province renforce ses prouesses en matière d’énergie nucléaire, ne se détourne pas du gaz naturel et envisage de se tourner encore plus vers l’hydroélectricité, alors même qu’elle intègre au réseau d’autres sources d’énergie solaire et éolienne.
Le plan du gouvernement provincial qui vise à répondre aux besoins croissants en électricité à long terme présente de nombreux attraits. Le plan, qui prévoit qu’on investisse davantage dans le nucléaire, rehaussera le niveau de certitude à l’égard du fait que le réseau électrique de l’Ontario contribuera à atteindre les objectifs zéro émission nette d’ici 2050. Cependant, sa dépendance au gaz naturel à court terme pourrait mettre en péril les objectifs climatiques à cette même échéance.
Le rapport du gouvernement de l’Ontario signale le fait que le gouvernement reconnaît que la croissance économique de la province est tributaire d’une électricité plus propre : un réseau plus vert aiderait la province à attirer des milliards de dollars en investissements dans les énergies de transition, comme les chaînes d’approvisionnement de véhicules électriques, la décarbonation des industries, le stockage de l’énergie et les minéraux critiques.
Cependant, le plan laisse quelque peu à désirer dans la mesure où il met considérablement l’accent sur les années 2040. La décision de la province de conserver, dans son bouquet énergétique, les centrales électriques au gaz naturel pourrait mener à une polémique politique avec le gouvernement fédéral, lequel est sur le point de finaliser son règlement sur l’électricité propre.
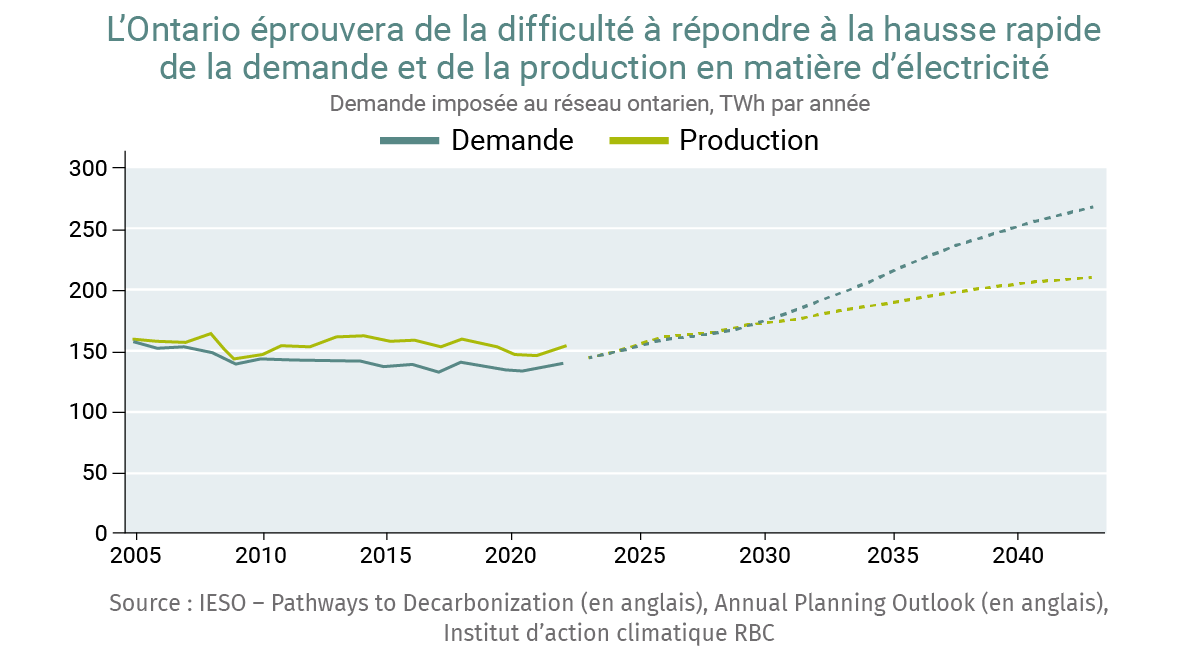
Prenez connaissance de l’analyse du premier économiste de l’Institut d’action climatique RBC, Colin Guldimann, ici.
EN VEDETTE
Volonté de fer
Si la sidérurgie était un pays, celui-ci serait le troisième plus important émetteur de CO2 du monde, après la Chine et les États-Unis, alors que ce secteur représente 7 % à 9 % des émissions mondiales. L’industrie figure également en tête d’affiche des secteurs où la réduction des émissions est difficile, au vu du processus à forte intensité de carbone impliqué. Cependant, le géant luxembourgeois de la sidérurgie, la société Arcelor Mittal, a souhaité tenter le coup en réalisant un investissement stratégique dans la société ontarienne Char Technologies. Voilà qui constitue un début :
| 6,6 M$ | Valeur de l’investissement d’Arcelor Mittal dans Char Technologies, pour une participation de 12,48 % dans l’entreprise. |
| 35 000 tonnes | Réduction des émissions de gaz à effet de serre attendues sur 4 ans grâce au four à arc électrique de la société Char. |
| 58 % | Diminution en pourcentage des émissions associées à la production d’acier brut nécessaire pour atteindre les objectifs à zéro émission nette, selon les estimations de l’Agence internationale de l’énergie. Les émissions d’acier ont augmenté au cours de la dernière décennie. |
| 180 M$ US | Investissement réalisé par Arcelor dans la décarbonation du secteur de la sidérurgie depuis 2022. |
L’action climatique
Ce que nous surveillons
Dures pilules à avaler en Atlantique – Le jour de la fête du Canada, Ottawa appliquait son Règlement sur les combustibles propres à l’ensemble du pays, alors que les provinces de l’Atlantique se remettaient à peine de la taxe fédérale sur le carbone entrée en vigueur la semaine précédente sur leur territoire. Les Néo-Brunswickois ont été les premiers à constater la hausse du prix de l’essence due au règlement en question. En octobre, le remboursement trimestriel de la taxe fédérale sur le carbone devrait calmer les esprits. Pour connaître les modalités du règlement, cliquer ici (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement)
- La guerre des mers – Autre pomme de discorde entre l’Occident et la Chine qui, à la veille de la réunion de l’Organisation maritime internationale prévue ce mois-ci, presse les pays en développement de s’opposer à une nouvelle taxe sur les émissions de GES et aux objectifs de décarbonation imposés aux transporteurs maritimes. La France et d’autres pays riches sont en faveur de règles plus strictes. Pour en savoir plus, cliquer ici (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement)
- Le Canada face à l’IRA – Ottawa et l’Ontario vont accorder à Stellantis-LGES des subventions de 15 milliards de dollars afin de garantir la construction d’une usine de fabrication de batteries pour véhicules électriques. Les entreprises en lice ayant menacé de s’installer ailleurs qu’à Windsor, le Canada se devait de réagir aux mesures incitatives prévues dans l’Inflation Reduction Act des États-Unis.
- Volte-face chez Shell – En désaccord avec les nouvelles priorités du nouveau président et chef de la direction de Shell, son responsable du secteur des énergies renouvelables (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) a pris la porte. Les grandes sociétés pétrolières essaient de trouver un juste milieu entre leurs engagements à long terme envers le climat et la sécurité énergétique à court terme de leurs clients. Les actionnaires (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) penchent actuellement pour la rentabilité de leurs portefeuilles.
- La voiture volante – Aux États-Unis, un véhicule entièrement électrique va bientôt prendre son envol : les organismes de réglementation ont autorisé l’entreprise californienne Alef Aeronautics (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) à procéder aux essais routiers et aériens de son modèle A (coût : 300 000 $) en vue de son lancement prévu en 2025.
LE GRAPHIQUE DE LA SEMAINE
Le Canada, florissante pépinière d’entreprises
À l’échelle mondiale, l’objectif de carboneutralité à atteindre d’ici 2050 exige des investissements annuels de 3,5 billions de dollars américains. Sur le plan technologique, Canada n’est pas en mauvaise posture (voir ci-dessous), mais selon BCG Consulting (ce contenu est disponible en anglais seulement), le pays doit investir entre 6 et 9 fois plus s’il veut atteindre ses propres cibles et conserver son avance.
ÉNERGIE
L’uranium, autre minéral critique
L’uranium vient s’ajouter à la liste des minéraux dont le monde risque de manquer cruellement.
Le nucléaire regagne en effet en popularité, lui qui rejoint peu à peu le club des sources d’énergie jugées propres et capables de nous faire atteindre à la carboneutralité d’ici 2050. Dernier coup de pouce en date : cette semaine, l’Ontario a annoncé avoir l’intention de construire une nouvelle centrale, de 4,8 GW, sur le site de Bruce-A. Il s’agirait du plus gros projet depuis 30 ans. S’il se réalise, l’ensemble des installations produirait 11 GW, soit davantage que la centrale la plus puissante au monde actuellement, celle de Kashiwazaki-Kariwa, au Japon. La province est ailleurs en train de mettre au point le premier petit réacteur modulaire (PRM) canadien pouvant être raccordé au réseau, sur le site de la centrale Darlington d’Ontario Power Generation.
Partout dans le monde, les acteurs du nucléaire vont devoir résoudre plusieurs problèmes et notamment assurer leur approvisionnement en uranium, sans quoi les nouveaux projets resteront lettre morte.
Une véritable renaissance – Plusieurs pays ont décidé de prolonger l’utilisation de leurs centrales nucléaires et au moins 60 nouvelles centrales sont en chantier. Certains analystes prévoient qu’on manquera en moyenne de 18 000 tonnes (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) d’uranium par an au cours des dix prochaines années. L’Agence internationale de l’énergie s’attend à ce que la puissance installée croisse de 43 % d’ici 2050, pour atteindre 590 GW. Une trentaine de pays envisagent de s’équiper à leur tour.
Le cas de la Russie – En Asie centrale, les troubles qui agitent l’État du Kazakhstan, où l’on produit 40 % de l’uranium mondial, sèment l’inquiétude depuis quelques années. Là-dessus, la Russie, autre grand producteur, a déclaré la guerre à l’Ukraine ; ses exportations font l’objet d’un embargo dans un certain nombre de pays. Or, l’industrie nucléaire mondiale dépend fortement de la Russie, qui produit 14 % du total de concentré d’uranium, 27 % de l’uranium issu des procédés de conversion et 39 % de l’uranium obtenu par enrichissement. Près de 80 % de la production primaire est assurée par des entreprises d’État, ce qui pose un sérieux problème de sécurité énergétique.
Le problème des déchets – Les organismes de réglementation japonais ont autorisé le rejet dans l’océan de plus d’un million de tonnes d’eau ayant servi au traitement des déchets issus de la centrale de Fukushima, détruite en 2011. Alors que le nucléaire jouit d’un regain de popularité, les exploitants vont devoir trouver de nouvelles solutions au problème des déchets.
La situation au Canada – Après des années de stagnation, le prix de l’uranium s’envole. Les producteurs demeurent toutefois prudents. Disposant de la troisième réserve mondiale en importance, Canada était le plus gros producteur avant d’être surclassé par le Kazakhstan. Près de 40 sociétés y cherchent de nouveaux clients, mais la Nouvelle-Écosse, le Québec et la Colombie-Britannique ont banni l’exploration et l’exploitation des gisements d’uranium sur leur territoire. L’engouement pour les petits réacteurs modulaires observé en Ontario et ailleurs devrait susciter une demande en uranium accrue. Le gouvernement fédéral y contribue : le nucléaire fait désormais partie des sources d’énergie donnant droit à un crédit d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre. Le moment serait-il venu pour les provinces canadiennes de changer leur fusil d’épaule ?
POLITIQUES PUBLIQUES
La grande boucle
La boucle atlantique aidera-t-elle la Nouvelle-Écosse à atteindre ses objectifs en matière de climat ? Son réseau est censé devenir carboneutre d’ici 2030, or il est alimenté à plus de 50 % par des centrales au charbon – à l’échelle du Canada, c’est celui qui dépend le plus de ce combustible fossile.
Les médias jugent imminent le raccordement des provinces maritimes tributaires des énergies fossiles aux centrales hydroélectriques de Terre-Neuve-et-Labrador et du Québec. Les gouvernements provinciaux et les producteurs d’électricité sont en train de négocier avec Ottawa, qui offre d’investir 4,5 milliards de dollars (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) dans ce projet. C’est insuffisant, selon le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, selon lequel une telle entreprise pourrait entraîner la faillite (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) de la province. Le plan de son gouvernement (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) montre que la Nouvelle-Écosse peut atteindre son objectif de 2030 avec ou sans boucle atlantique.
Ce dossier illustre bien le défi que représentent les grands projets d’infrastructures énergétiques au Canada, mais celui-ci sortirait grand gagnant d’une entente : 1) les provinces mettraient leurs ressources en commun, 2) le projet contribuerait à la renommée du pays, 3) la Nouvelle-Écosse a trop longtemps dépendu du charbon et 4) une fois n’est pas coutume au Canada, les provinces mettraient en commun leurs lignes de transport.
EN VEDETTE
Un train à faible empreinte carbone
N’émettant aucune fumée mais chargé de piles à combustible, le premier train à hydrogène nord-américain accomplit ses premiers voyages dans le centre du Québec. Il s’agit d’en démontrer la viabilité commerciale mais aussi, à terme, de passer du diesel et de l’essence à l’hydrogène pour le transport de marchandises, et ce, sur une grande échelle. On réduirait ainsi les embouteillages routiers et les émissions de GES.
| 120 | Nombre de passagers pouvant voyager à bord du train à hydrogène d’Alstom |
| 140 km/h | Vitesse maximale (comparable à celle d’un train régional fonctionnant au diesel, le bruit en moins) |
| 0,9 % | Pourcentage des émissions du secteur canadien des transports attribuable au chemin de fer (le camionnage, lui, compte pour 35 %) |
| 2020 | Il y a trois ans, le Chemin de fer Canadien Pacifique annonçait la mise au point prochaine d’une locomotive à hydrogène. La compagnie en étudie actuellement une autre à batterie au lithium-ion, destinée au transport de marchandises. |
POLITIQUES PUBLIQUES
Résilience du Canada face au climat
Tandis qu’une grande partie du pays est enveloppé d’une brume causée par des incendies de forêt, le Canada présente sa Stratégie nationale d’adaptation cette semaine. Cette stratégie, qui vise à protéger le pays des ravages des changements climatiques, a une très large portée englobant le littoral, la résilience aux catastrophes, la santé et le bien-être, la biodiversité, les infrastructures, l’économie et les travailleurs.
Elle est également devenue une nécessité. La vague de chaleur qui a frappé la Colombie-Britannique en 2019 a fait 619 morts, tandis que la facture pour lutter contre les incendies de forêt s’élève en moyenne à 1 milliard de dollars chaque année (la saison des incendies de forêt actuellement en cours serait la pire jamais enregistrée, et aurait coûté à l’Ontario près de 1,3 milliard de dollars à elle seule, et ce n’est pas terminé). Le gouvernement estime que, d’ici 2025, le Canada pourrait subir des pertes liées aux changements climatiques de l’ordre de 25 milliards de dollars chaque année, soit 50 % de la croissance du PIB prévue.
La foresterie, l’agriculture, la pêche, l’énergie, l’exploitation minière, le transport et le tourisme sont les secteurs les plus à risque, tandis que les réparations à la suite d’inondations et d’incendies de forêt coûtent déjà chaque année 720 $ par habitant, selon les estimations de l’Institut climatique du Canada. En revanche, chaque dollar investi dans des mesures d’adaptation pourrait rapporter jusqu’à 15 dollars de bénéfice global.
Voici quelques objectifs clés de la Stratégie nationale d’adaptation :
- D’ici 2040, il n’y aura plus de décès dus aux vagues de chaleur extrême.
- D’ici 2030, toutes les communautés du nord du pays et les communautés autochtones disposeront des ressources nécessaires pour développer des outils et recueillir des renseignements pour gérer les risques climatiques, et y accéder.
- D’ici 2028, Ottawa, les provinces et les territoires auront recensé au moins 200 zones à risque d’inondation très élevé afin d’établir de nouvelles cartes de ce risque et de le modéliser dans chaque région.
- D’ici 2030, de nouvelles considérations relatives à la résilience aux changements climatiques seront intégrées au Code national du bâtiment, au Code canadien sur le calcul des ponts routiers et au Code canadien de l’électricité. Au Canada, les codes de construction résiliente aux changements climatiques ont un ratio bénéfice/coût de 12:1, ce qui équivaut à un rendement du capital investi de 1,1 %.
- D’ici 2030, les systèmes de santé auront déterminé les risques, élaboré des plans d’adaptation et mesuré les progrès réalisés en matière de résilience climatique.
- D’ici 2030, 30 % de nos terres et de nos eaux seront conservées et 15 nouveaux parcs urbains nationaux seront créés en vue de préserver la nature.
- D’ici 2027, 70 % des ingénieurs civils, des urbanistes, des architectes paysagistes, des comptables et d’autres membres de professions apparentées pourront utiliser des outils d’adaptation aux changements climatiques et communiquer aux clients le dossier de décision sur les mesures d’adaptation.
Pour en savoir plus :
Virage énergétique : comment l’Ontario peut réduire sa facture d’électricité de 450 milliards de dollars
Tours à faibles émissions de carbone : le défi zéro émission nette de 40 milliards $ du Canada
POLITIQUES PUBLIQUES
Ambitieux projets en Alberta
Les changements climatiques mettent le Canada face à son plus grand défi technologique, mais ils représentent également une occasion de développement économique. L’Alberta se doit de jouer un rôle de premier plan dans la transition énergétique, non pas parce que les risques liés à cette transition sont concentrés dans cette province, mais parce que c’est là que se trouvent les occasions.
Voici cinq occasions que pourrait saisir l’Alberta :
Occasion no 1 : révolution dans la construction
Compte tenu de sa forte croissance démographique, le Canada aura besoin de six millions de nouvelles habitations d’ici 2030. L’Alberta fait figure de province idéale pour lancer une révolution dans le secteur de la construction au Canada, car elle possède les matériaux, les laboratoires scientifiques, une longue histoire dans ce secteur, des réserves de capitaux abondantes, des bâtiments récents et une population jeune et croissante.
Occasion no 2 : capture de carbone dans le sol
De nombreux producteurs de céréales dans l’ouest du Canada génèrent déjà des émissions nettes négatives grâce au déploiement rapide de la gestion des éléments nutritifs, à l’adoption de brise-vent présents naturellement ou plantés et à d’autres techniques respectueuses du climat. Dans une province où il y a des plantations annuelles, une autre occasion serait d’opter stratégiquement pour des cultures qui augmentent la capacité de stockage du carbone dans les sols. D’ici 2050, la capture de carbone dans le sol pourrait générer des revenus potentiels de 1,2 milliard de dollars chaque année pour l’Alberta.
Occasion no 3 : biométhanisation
Partout au Canada, les agriculteurs envisagent l’utilisation des biodigesteurs comme nouvelle source de revenus et comme solution pour réduire les émissions produites par leur bétail. Les digesteurs anaérobies joueront un rôle clé dans la séquestration du carbone et la création de revenus pour les éleveurs de la province.
Occasion no 4 : hydrogène
En tant qu’important producteur d’hydrogène industriel, l’Alberta est bien placée pour prendre une position dominante dans un marché mondial évalué à 2,5 billions de dollars, en particulier grâce à sa feuille de route sur l’hydrogène et à son pôle hydrogène à Edmonton. Tandis que nos alliés s’entretiennent avec nous sur la possibilité que le Canada les approvisionne, nous devons leur garantir que nos politiques ne changeront pas constamment et que nos infrastructures sont robustes, résilientes et fiables.
Occasion n 5 : Capture et stockage du carbone
La capture et le stockage du carbone représentent pour le Canada un projet d’ingénierie de grande envergure qui devrait galvaniser le pays. Le projet de l’Alberta Carbon Trunk Line (ACTL) n’est peut-être pas aussi évocateur qu’Apollo 13, par exemple, mais il peut avoir la même importance en matière de contribution à la construction de la nation et de démonstration de notre maîtrise d’une technologie à grande échelle qui peut aider d’autres secteurs et que nous pouvons vendre au monde.
— Extrait d’un discours de John Stackhouse, premier vice-président, RBC, devant le Business Council of Alberta en juin.
AUTOCHTONES
Bâtir une nation
Dans son budget fédéral de 2023, le gouvernement a proposé plusieurs mesures indispensables pour bâtir une économie propre, durable et prospère au Canada. L’une des mesures les plus concrètes est d’améliorer la qualité et l’uniformité des avantages que tirent les communautés autochtones des grands projets verts menés sur leurs territoires, en particulier au moment où le gouvernement met en application sa stratégie sur les minéraux critiques.
Dans son essai Bâtir une nation : vers une économie carboneutre grâce au potentiel autochtone, Allan Clarke, consultant en affaires autochtones qui a autrefois été directeur général, Recherche économique et élaboration de politiques au sein de l’ancien ministère des Affaires autochtones et du Nord Canada, étudie des façons de dégager davantage de capitaux pour la participation des Premières Nations à l’économie propre, notamment :
- Moderniser les programmes de soutien des prêts Les programmes de garantie de prêts qui favorisent l’accès à des capitaux à coût abordable et réduisent les risques connexes peuvent aider les communautés autochtones à surmonter les obstacles au développement et à l’inclusion économiques.
- Établir une nouvelle relation financière avec les peuples autochtones Des réformes structurelles doivent être apportées aux cadres financiers et fiscaux régissant les peuples autochtones afin de combler le manque d’infrastructures dans les réserves. Il convient aussi d’instaurer un financement prévisible et de longue durée pour donner aux Autochtones la possibilité de participer de façon significative aux grands projets verts.
Lire l’essai d’Allan Clarke pour l’Institut d’action climatique RBC :
https://leadershipavise.rbc.com/batir-une-nation-vers-une-economie-carboneutre-grace-au-potentiel-autochtone/
AU CANADA ET DANS LE MONDE
Crise du cuivre
Les dirigeants de ce secteur mettent en garde contre une « catastrophe » sur le marché du cuivre en raison de la stagnation de l’offre de ce métal essentiel. Le cuivre est un métal très demandé, car il est utilisé dans de nombreux processus industriels et dans les technologies vertes, notamment dans la production d’énergie renouvelable et les véhicules électriques. RBC Marchés des Capitaux s’attend à ce que l’accélération de l’électrification fasse augmenter la demande de cuivre de 2,8 % par an jusqu’en 2035 (contre 2,5 % auparavant). Les contraintes qui pèsent sur l’offre pourraient toutefois déclencher une hausse des prix susceptible de stimuler la demande de substituts au cuivre, tels que l’aluminium et le plastique.
Selon BloombergNEF, le déficit d’approvisionnement en cuivre primaire pourrait atteindre 32 millions de tonnes en 2050. Aussi, de nouvelles mines et davantage de recyclage seront nécessaires pour satisfaire la demande. Le Canada peut-il y contribuer ?
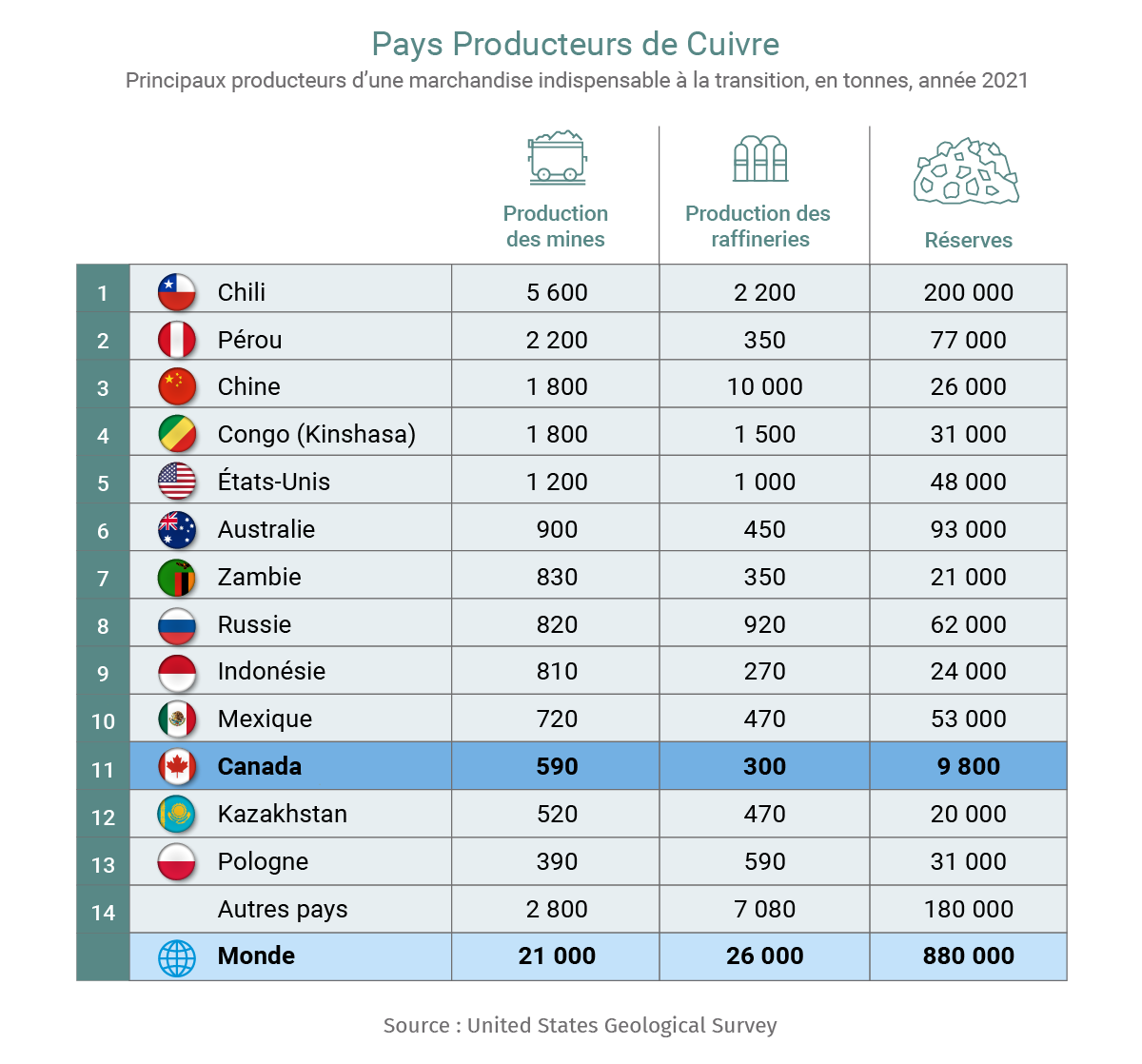
À l’heure actuelle, le Canada est le 11e producteur de cuivre au monde et le 13e sur le plan des réserves. Bien que la production de cuivre du pays ait diminué de 2 % par an au cours des cinq dernières années, on estime qu’elle pourrait augmenter de 3 % par an au cours des trois prochaines années, compte tenu des dix projets de cuivre qui sont prévus ou en cours.
Le Chili, le Pérou, la Russie et la République démocratique du Congo font partie des pays qui devraient générer un peu plus de 50 % de la croissance de la production. Tous ces pays étant confrontés à des difficultés politiques et économiques qui leur sont propres, la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques et le crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques peuvent-ils aider le Canada à accroître sa production de cuivre ?
POLITIQUES PUBLIQUES
Décarbonation du Canada
Voici à quoi pourrait ressembler le Canada en 2050 : baisse de la production de pétrole et de gaz, hausse de la demande d’électricité qui génère des émissions nettes négatives, et prépondérance des véhicules électriques sur les autoroutes. Selon les dernières prévisions bisannuelles de la Régie de l’énergie du Canada (REC), si ce scénario se concrétise, le Canada atteindra la carboneutralité d’ici 2050, même si le reste du monde peine à réduire les émissions.
La REC décrit également deux autres scénarios : une transition mondiale vers zéro émission nette, au cours de laquelle les émissions mondiales chutent de concert avec les émissions de GES canadiennes, et un scénario de mesures actuelles, qui laisse entendre que les politiques appliquées jusqu’à présent ne permettront pas d’atteindre les objectifs de 2050.
Un monde carboneutre qui évite les énergies conventionnelles exigera également une fermeté à toute épreuve face à l’incertitude de la croissance économique, à l’augmentation des prix à la consommation et à un taux de change Canada-É.-U. quelque peu défavorable.
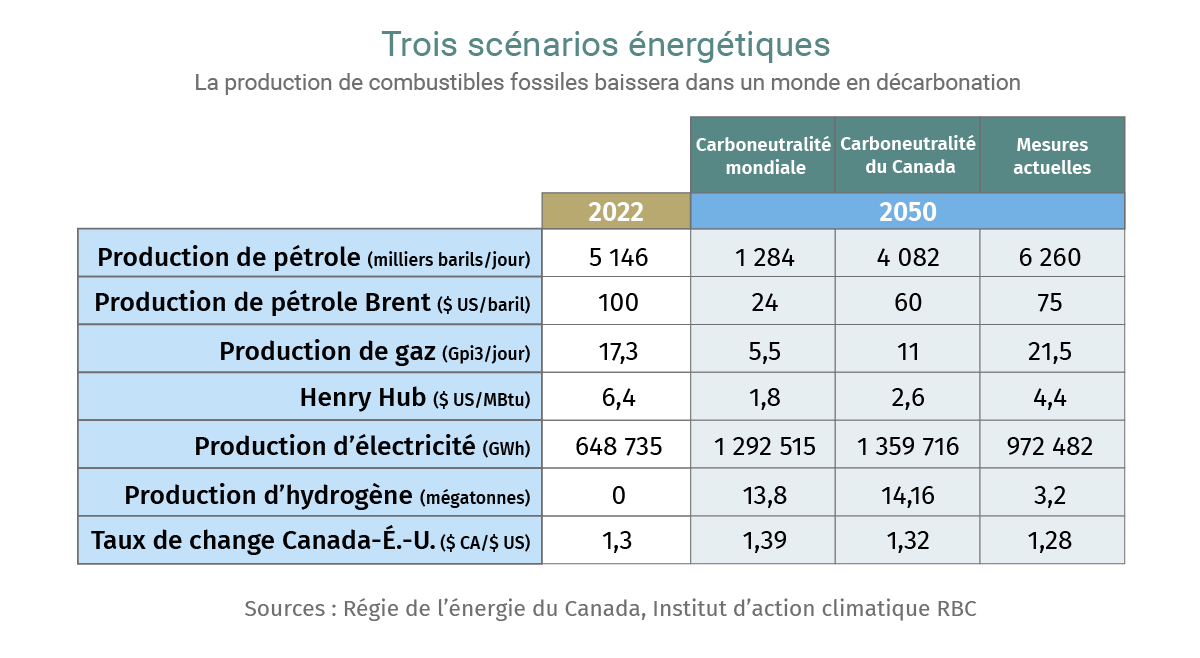
Le rapport ne constitue pas une prévision ou une recommandation, mais il examine l’évolution possible de l’économie canadienne dans le secteur de l’énergie.
Pétrole : mentionné 316 fois dans le rapport. Exportations (2022, $) : 156,6 G$.
La production de pétrole au Canada chute dans deux des trois scénarios (voir le tableau ci-dessus). Le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC) contribuent à cette baisse : la capacité de la technologie dans les sables bitumineux plafonne à 27 Mt en 2033 dans le scénario de la carboneutralité mondiale (et à 49 Mt en 2035 dans le scénario de la carboneutralité du Canada). Cependant, dans un monde en décarbonation, la plupart des installations pétrolières devraient fermer et seuls les projets les plus efficaces continueraient d’être menés en 2050.
Gaz naturel : 345 mentions. Exportations (2022, $) : 24,6 G$.
Une source d’énergie qui recourt au captage, à l’utilisation et au stockage du carbone a un rôle à jouer, même réduit, dans un monde carboneutre. Les projets LNG Canada et Woodfibre LNG mis en oeuvre sur la côte ouest devraient constituer les deux principaux projets d’exportation de gaz naturel liquéfié dans un monde en décarbonation, mais il sera possible d’accroître les exportations (p. ex., phase II de LNG Canada) si le monde peine à réduire les émissions.
Électricité : 342 mentions. Exportations (2022, $) : 5,7 G$.
L’électricité est la nouvelle vedette du secteur de l’énergie au Canada : elle représentera 41 % de la consommation d’énergie d’ici 2050 (contre 17 % aujourd’hui). En raison de sa décarbonation d’ici 2035, l’électricité à faible émission de carbone alimentera les transports, les industries lourdes et les foyers. L’énergie éolienne, l’énergie nucléaire, l’énergie hydraulique, le gaz naturel utilisant les technologies CUSC, la bioénergie associée au captage et stockage du carbone (BECCS) et l’énergie solaire sont les principaux moteurs de la croissance de la nouvelle production pendant la période de projection. Les exportations nettes d’électricité vers les États-Unis diminueront légèrement dans les deux scénarios de la carboneutralité.
Hydrogène : 257 mentions. Exportations (2022, $) : 0,7 G$.
L’hydrogène fait l’objet d’un chapitre particulier dans le rapport. Dans les deux scénarios de la carboneutralité, le Canada pourrait exporter de 4,5 Mt à 5 Mt d’hydrogène à faible émission de carbone, produit à partir du gaz naturel utilisant les technologies CUSC, de l’électrolyse et de la gazéification de la biomasse.
Autres mentions remarquables : énergie éolienne (47 fois), énergie solaire (31 fois), énergie nucléaire (29 fois), hydroélectricité (5 fois).
ÉLECTRICITÉ
Conseils pour réduire la facture d’électricité de 450 milliards de dollars de l’Ontario
L’Ontario doit investir 450 milliards de dollars d’ici à 2050 pour répondre à l’augmentation de la demande et devenir une plaque tournante du réseau vert, attrayante pour les industries qui cherchent à réduire leurs émissions. Cependant, la demande croissante d’électricité pourrait mettre à rude épreuve le réseau de la province dès 2026 et même provoquer des pénuries chroniques d’ici 2030.
Pour répondre aux besoins pressants à court terme, l’Ontario envisage d’augmenter la production d’électricité à partir de gaz. Or, la construction de centrales au gaz naturel pourrait entrer en conflit avec le règlement sur l’électricité propre que le gouvernement fédéral s’apprête à mettre en place.
Virage énergétique : comment l’Ontario peut réduire sa facture d’électricité de 450 milliards de dollars, nouveau rapport de l’Institut d’action climatique RBC, examine la façon dont la province peut éviter de prendre des décisions hâtives et coûteuses au sujet de sa future combinaison énergétique.
Le déploiement de technologies telles que les thermostats intelligents et les systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation) basés sur l’IA, ainsi que l’adoption de mesures opportunes de conservation de l’énergie pourraient permettre d’économiser suffisamment d’électricité pour alimenter trois millions de foyers d’ici le début des années 2040, ce qui représente un peu plus de la moitié de la demande d’électricité résidentielle de la province.
Le report d’engagements financiers importants permettra de maintenir l’électricité à un prix abordable et donnera à l’Ontario le temps de se redéfinir en tant que pôle manufacturier à faible émission de carbone, attirant des entreprises actives dans les chaînes d’approvisionnement des voitures électriques, la production de métaux verts et les technologies propres.
Lire le rapport Virage énergétique :
POLITIQUES PUBLIQUES
Cinq choix stratégiques du Canada
L’infrastructure d’énergie du Canada et du monde peut-elle résister aux bouleversements provoqués par les changements climatiques et la transition énergétique dans les 25 prochaines années ? Voici l’ampleur du défi :
- Multiplication par cinq de la capacité de production d’énergie éolienne et solaire à l’échelle mondiale d’ici 2030 ;
- Réduction de la production mondiale de combustibles fossiles de 6 % chaque année, alors qu’elle augmente en réalité ;
- Baisse de 66 % des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie d’ici 2030 ;
- Besoin d’au moins 50 % d’électricité supplémentaire au Canada d’ici 2030, et de 200 % d’ici 2050.
Le défi sera extrêmement difficile à relever, mais ce n’est pas impossible. Pour saisir l’occasion, le Canada doit faire des choix stratégiques. Voici cinq mesures à considérer :
- Soutien budgétaire. La loi américaine sur la réduction de l’inflation a changé la donne. Dans son dernier budget, Ottawa a franchi une bonne étape pour répondre à cette mesure en offrant un crédit d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre et en le rendant accessible aux entités qui ne paient pas d’impôts, ce qui est essentiel.
- Souplesse réglementaire. Ce point sera probablement abordé cet été dans le cadre du règlement sur l’électricité propre, qui est controversé et dont le soutien politique est en baisse. Le risque de bloquer la production de gaz à long terme est évident, mais nous devons être conscients que les ambitions climatiques à long terme peuvent nuire aux réalités à court terme, ce qui pourrait aussi faire dérailler ces ambitions.
- Incitatifs financiers. La Banque de l’infrastructure du Canada et le nouveau Fonds de croissance du Canada devront jouer un rôle d’avant-garde en proposant des « contrats sur différence » (qui sont essentiellement des garanties de prix du carbone) afin de réduire le risque politique à long terme des projets de transition.
- Inclusion des Autochtones. Nous devons veiller à mettre en place des outils permettant aux collectivités autochtones de participer pleinement à la transition. Une option importante serait une garantie de prêt nationale pour aider les Autochtones à maintenir leur participation dans les projets, selon le modèle des programmes semblables en Alberta, en Saskatchewan et en Ontario.
- Technologie pour consommateurs. Comme nous l’avons écrit dans le récent rapport Virage énergétique, qui portait sur le défi du réseau de l’Ontario, des efforts de conservation axés notamment sur des systèmes CVC basés sur l’IA et des thermostats intelligents pourraient permettre de répondre à près de 20 % de la demande prévue dans la province.
Ces mesures montrent que nous avons le choix, mais pas aussi longtemps que nous le souhaiterions.
–Extraits d’un discours de John Stackhouse, premier vice-président, RBC, lors du symposium sur les politiques d’Électricité Canada à Winnipeg en juin.
EN PRIORITÉ
Vêtements viraux
La « mode éphémère » pourrait avoir besoin de se ralentir. Selon un nouveau rapport, les vêtements bon marché qui suivent une tendance virale éphémère ont de graves conséquences sur le climat. Voici pourquoi le système vestimentaire actuel ne fonctionne pas :
| 1 | Nombre de chargements de camions de vêtements mis en décharge ou incinérés chaque seconde dans le monde. |
| 98 millions de tonnes | Ressources non renouvelables utilisées chaque année par le secteur du textile, notamment le pétrole pour produire des fibres synthétiques, les engrais pour cultiver le coton et les produits chimiques pour produire, teindre et apprêter les fibres et les textiles. |
| 7 à 10 | Nombre de fois qu’un article de mode éphémère est porté avant d’être jeté. Les clients peuvent économiser 460 milliards de dollars US par an s’ils continuent de les porter. |
| 560 G$ US | Économie circulaire pouvant être libérée si l’on élabore des modèles commerciaux permettant de prolonger la durée d’utilisation des vêtements. |
Source : Ellen MacArthur Foundation.
CLIMAT
Signaux de fumée
Le Canada est aux prises avec sa « pire saison des incendies de forêt du 21e siècle ». Les brasiers font rage dans neuf provinces et territoires canadiens, ayant jusqu’à maintenant brûlé 47 000 kilomètres carrés de terres, soit environ sept fois la taille du Grand Toronto.
Les incendies de forêt ont aussi de graves conséquences sur les émissions.
Selon Copernicus, le programme d’observation de la Terre de l’Union européenne, les incendies de forêt de l’Alberta ont rejeté 17 mégatonnes d’émissions de carbone (un cinquième des émissions annuelles des sables bitumineux). C’est le niveau d’émissions le plus élevé de la province depuis les incendies de 2019, qui ont ravagé 8 000 kilomètres carrés. « Les émissions de carbone de la Saskatchewan, de la Colombie-Britannique, de l’Ontario, des Territoires du Nord-Ouest et de la Nouvelle-Écosse ont déjà atteint des niveaux records ou presque records », selon un rapport de Copernicus (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) du début de juin.
Les émissions de CO2 des incendies dans la forêt boréale de l’Amérique du Nord et d’Eurasie ont augmenté depuis 2000, atteignant un nouveau sommet en 2021, selon un groupe de chercheurs rédacteurs pour le magazine Science (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) En général, les incendies dans la forêt boréale produisent 10 % des émissions mondiales de CO2 dues aux incendies de forêt (les forêts tropicales génèrent généralement beaucoup plus d’émissions), mais en 2021 elles en ont produit près du quart.
« Ce taux anormalement élevé est attribuable au manque d’eau à la fois en Amérique du Nord et en Eurasie, ce qui est inhabituel, selon les chercheurs. Le nombre croissant d’incendies de forêt extrêmes qui accompagnent le réchauffement de la planète représente un réel défi pour les efforts mondiaux d’atténuation des changements climatiques. »
En effet, la sécheresse persistante a rendu les territoires du Canada vulnérables aux incendies de forêt, environ 47 % du pays présentant des conditions de temps « anormalement sec » ou une sécheresse modérée à extrême, dont 70 % du paysage agricole du pays en mai, selon Agriculture et Agroalimentaire Canada.
Bien que les opinions des analystes divergent quant au lien direct entre les changements climatiques et les incendies de forêt, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (ce contenu est disponible en anglais seulement) affirme que le dépassement de 1,5 °C entraînera certainement plus d’événements météorologiques violents, y compris davantage d’incendies de forêt.
En plus de perturber l’économie, les incendies de forêt entraînent une exposition plus élevée au monoxyde de carbone, une exposition aux particules, un impact sur la biodiversité et l’habitat (surtout pendant la période de nidification) et des problèmes de santé en cas d’exposition prolongée.
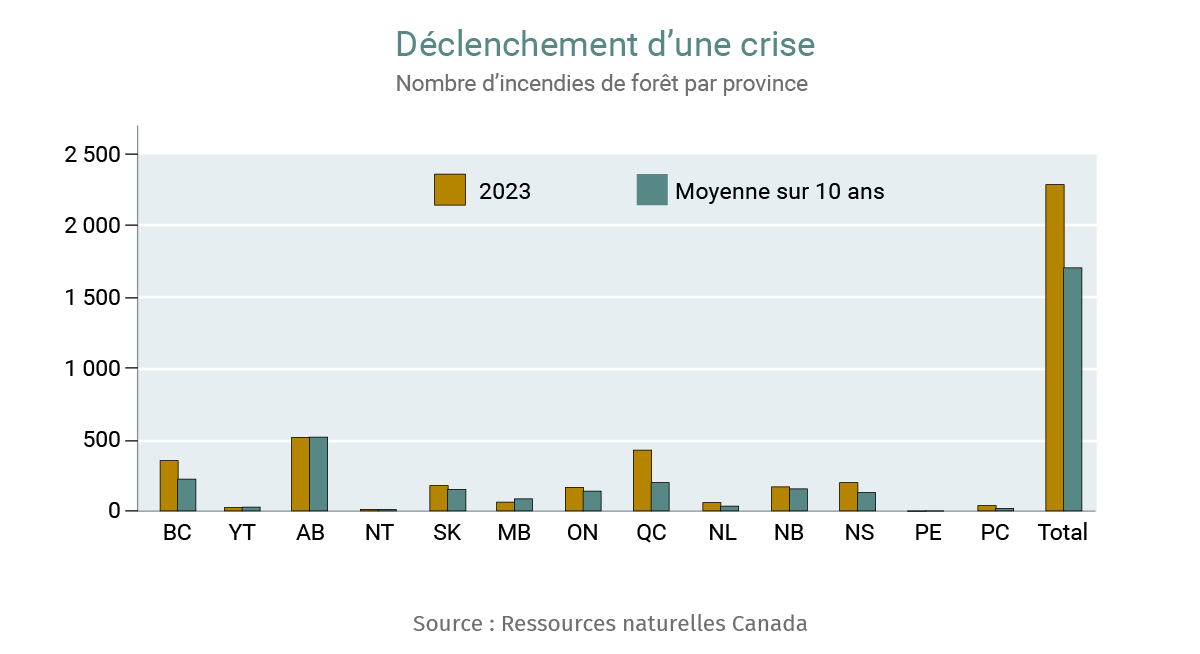
Selon le Bureau d’assurance du Canada, les demandes de règlement d’assurance liées aux conditions météorologiques ont dépassé en moyenne les 2 milliards de dollars par année au pays au cours des dernières années. Parallèlement, deux grands assureurs (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) ont cessé d’offrir l’assurance de dommages aux nouveaux clients en Californie, invoquant la fréquence des catastrophes naturelles dans cet État.
Veiller à la résilience des villes et des infrastructures face aux changements climatiques se pose rapidement comme un enjeu coûteux pour les décideurs de tous les paliers. Le National Research Council a déjà commencé à travailler à la construction de maisons et d’infrastructures résilientes aux changements climatiques.
ÉNERGIE
Lancement d’une nouvelle expédition à la recherche des ressources de l’Arctique
Alors que le réchauffement de la planète fait fondre l’Arctique, paradoxalement, de nombreux États qui revendiquent une partie du pôle Nord lorgnent ses richesses cachées.
L’Arctique joue un rôle crucial dans la régulation des températures mondiales, le pergélisol et la glace de mer constituant des ressources vitales pour le stockage du carbone, tandis que son réchauffement rapide sert aussi de baromètre du rythme des changements climatiques. La fonte de la glace de mer (jusqu’à 12,6 % (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) par décennie) a entraîné une vague d’activités dans l’Arctique, incitant les pays à exploiter les 30 % estimés de gaz non découvert dans le monde et les 13 % de pétrole non découvert enfouis sous le pergélisol.
Le Canada a protégé le Nord en prolongeant l’interdiction du forage pétrolier et gazier en mer dans la région plus tôt cette année.
D’autres alliés cependant, notamment la Norvège (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) et les États-Unis, sont à la recherche de richesses dans les mers où la fonte survient :
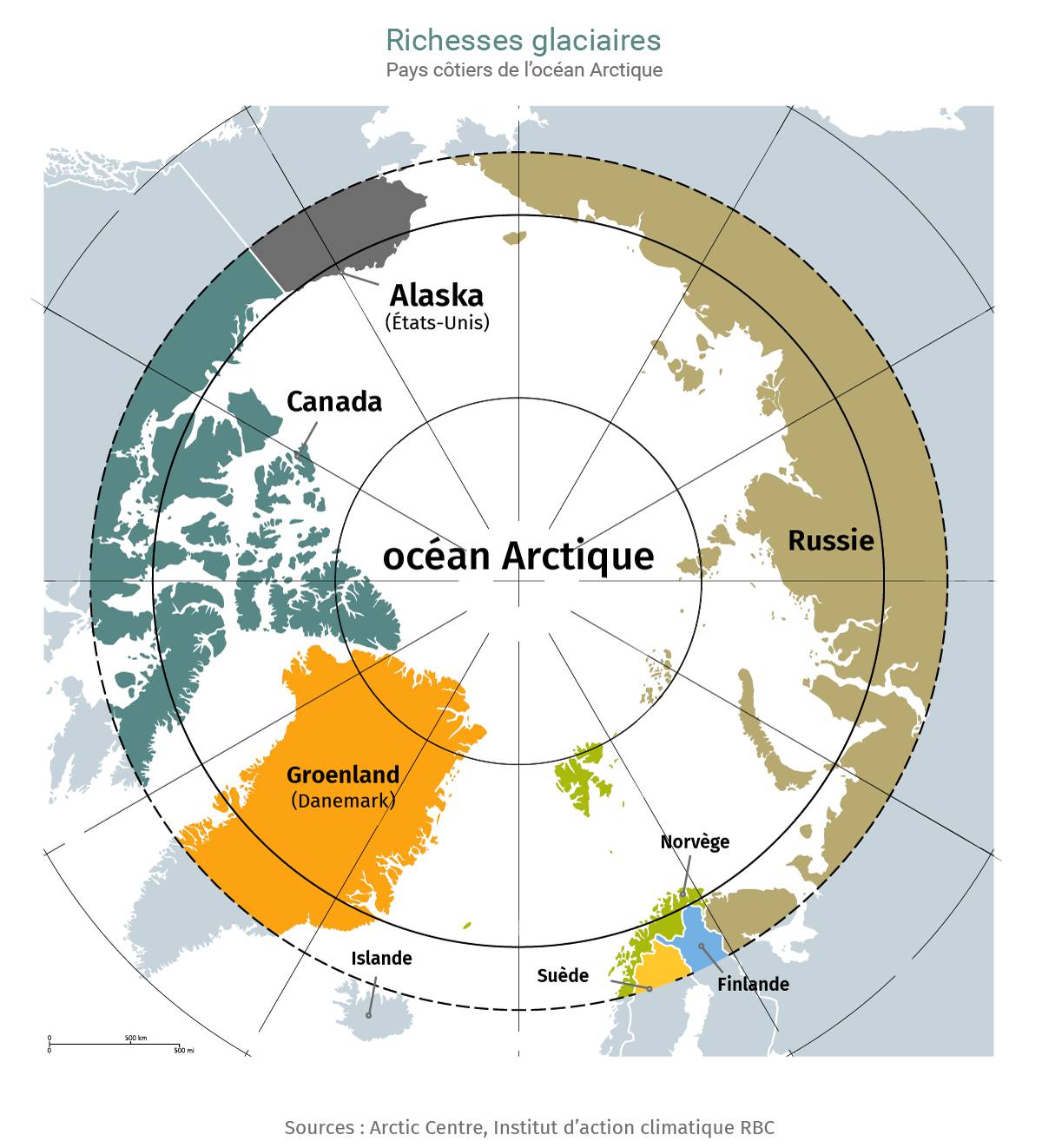
- En mai, le président des États-Unis, Joe Biden, a approuvé un projet de 8 milliards de dollars américains en Alaska qui permettra de produire plus de 600 millions de barils de pétrole brut au cours des 30 prochaines années.
- Un projet de GNL de 39 milliards de dollars américains de la société Alaska Gasline Development Corp. (ce contenu est disponible en anglais seulement) a été approuvé par les États-Unis en invoquant des motifs de libre-échange et de sécurité énergétique. Les répercussions négatives potentielles sur les changements climatiques, les sols, les sédiments et les ressources aquatiques ont été classées de « négligeables » à « moins que significatives » par le département américain de l’Énergie dans son évaluation finale (ce contenu est disponible en anglais seulement)
- Selon un rapport de Bloomberg (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), le premier responsable de l’énergie norvégien a également récemment encouragé les sociétés pétrolières et gazières à ne « négliger aucun effort » dans leur recherche d’hydrocarbures dans la mer de Barents. Au total, la Norvège prévoit offrir 92 blocs d’exploration dans les mers de Barents et de Norvège.
- Les nouveaux projets de GNL de la Russie dans le nord du pays ont été freinés par les sanctions que lui impose l’Occident. Vostock Oil, propriété de l’État, envisage toutefois des projets pétroliers dans le nord du territoire de Krasnoïarsk, qui permettront de produire et d’exporter annuellement jusqu’à 2 millions de barils par jour.
- La Chine, qui se dit un « État voisin » de l’Arctique, n’a guère eu de succès dans la région jusqu’à présent. Ses relations économiques et commerciales de plus en plus étroites avec Moscou soulèvent cependant de nouvelles incertitudes pour la région.
Compte tenu de l’abondance des ressources pétrolières et gazières ailleurs au pays, le Canada a choisi de ne pas poursuivre le forage pétrolier et gazier au cœur de l’Arctique. Toutefois, comme Ottawa demeure préoccupé par les ambitions de la Russie et de la Chine dans l’Arctique, une stratégie plus précise pour le Nord sera essentielle pour les collectivités locales et la sécurité nationale du Canada.
| 56 % | Proportion des projets de minéraux critiques qui touchent les territoires autochtones ; 35 % des terres les plus propices à la production d’énergie solaire sont situées près de terres s’apparentant à des biens-fonds. |
| Plus de 100 G$ | Valeur combinée pour l’exploitation d’énergies renouvelables et de minéraux critiques sur ou près de terres autochtones. |
| 2,6 G$ | Revenus bruts propres aux Premières Nations ; les revenus tirés des ressources naturelles s’élevaient à 322 millions de dollars en 2015-2016 |
| 48 G$ | PIB attribué aux peuples autochtones en 2020. L’Indigenomics Institute souhaite doubler ce montant pour atteindre 100 milliards de dollars |
Sources : Institut d’action climatique RBC, Statistique Canada
POLITIQUE PUBLIQUE
Préoccupations entourant l’électricité
L’adoption imminente du Règlement sur l’électricité propre (REP) par Ottawa préoccupe les provinces des Prairies, les premiers ministres de l’Alberta (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) et de la Saskatchewan (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) remettant en question les mérites de ce règlement et s’interrogeant sur ses répercussions sur les factures d’électricité.
Quel objectif vise le REP et pourquoi ce règlement préoccupe-t-il autant certaines provinces ?
Le REP est une proposition climatique fédérale qui vise à rendre le secteur de l’électricité carboneutre d’ici 2035. En dépit des écarts provinciaux, le Canada dispose déjà d’un réseau à faible émission de carbone, 82 % de l’électricité étant alimenté par l’énergie hydroélectrique, nucléaire, éolienne et solaire. Il s’agit de l’un des réseaux les plus propres au monde. Mais il lui sera désormais difficile de continuer d’offrir un bouquet énergétique moins producteur de carbone en raison de la demande croissante de l’électricité et de l’expansion démographique.
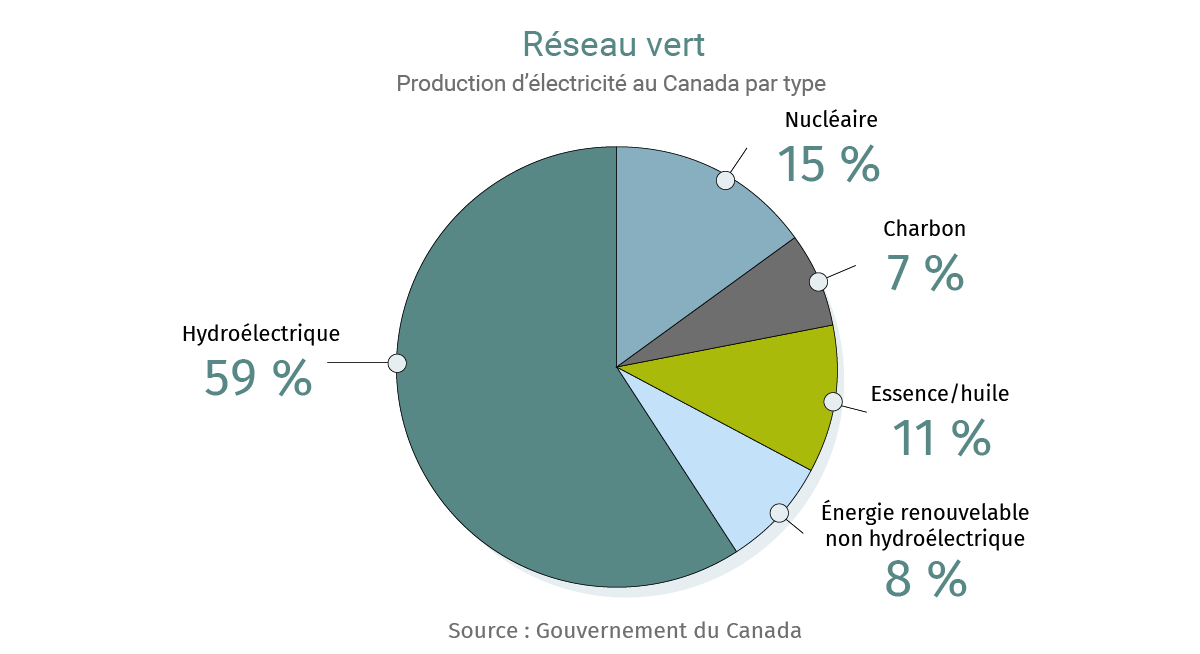
Le REP vise l’équilibre entre la gestion de la réduction des gaz à effet de serre (GES), la fiabilité et l’accessibilité.
Le rôle que jouera le gaz naturel dans le réseau réinventé de l’énergie figure parmi les plus épineux enjeux : d’importants investissements dans des projets de production à long terme de gaz naturel généreraient des émissions et seraient incompatibles avec les ambitions de carboneutralité du Canada. Le caractère fiable et abordable du gaz fait de ce produit une proposition convaincante, surtout dans les provinces des Prairies, où l’élimination progressive du charbon entraîne déjà d’importants déficits dans la production de base qui seront difficiles et coûteux de combler uniquement avec les énergies renouvelables. La société SaskPower, par exemple, dit qu’elle aura besoin de gaz naturel ou d’énergie nucléaire pour assurer la fiabilité du réseau.
Le gouvernement fédéral, pour sa part, propose dans son budget de 2023 de grandes subventions pour l’électricité propre qui permettront à Ottawa de prendre part à la course au réseau carboneutre, ce sont des incitatifs qui devraient être suffisamment motivants.
Le REP pourrait susciter bientôt des débats entre le gouvernement fédéral et les provinces. Voici quelques thèmes clés qui retiennent l’attention :
1. Urgence : En ce qui concerne la planification des infrastructures, 2035 est tout proche, et la mise en œuvre des nombreux projets nucléaires et hydroélectriques nécessite de longs délais. Les décideurs fédéraux et provinciaux doivent se mettre d’accord rapidement et fournir aux investisseurs un cadre réglementaire prévisible avant de pouvoir donner suite aux projets.
2. Questions entourant le gaz. Le REP vise à régler la question du gaz naturel pour permettre à ce produit de conserver sa nature fiable lors des conditions météorologiques extrêmes, des urgences ou d’autres événements cygnes noirs. Le crédit d’impôt à l’investissement d’Ottawa pour l’électricité propre (axé principalement sur l’éolien, le solaire photovoltaïque et l’hydroélectricité, etc.) cible également les centrales au gaz naturel à faible émission (qui seraient assujetties à un seuil d’intensité des émissions compatible avec l’établissement d’un réseau carboneutre d’ici 2035).
3. Nouvelles technologies. Le REP permettra-t-il à l’hydrogène et les petits réacteurs modulaires de progresser ? Au cours des dernières années, Ottawa a mis au point un Plan d’action des petits réacteurs modulaires (PRM) et une Stratégie relative à l’hydrogène, et ces deux technologies prometteuses nécessiteraient une prise de décision audacieuse et rapide.
RBC déclare dans le prix de l’énergie que le Canada doit prendre rapidement des mesures pour faire face à un bond potentiel de moitié de la demande d’électricité au cours de la prochaine décennie. L’Ontario, l’Alberta et la Saskatchewan sont confrontés à des défis particulièrement urgents, mais chaque province doit choisir sa propre voie, et ce, rapidement.
CAPITAL
Comment gérer les émissions d’Aramco & Co.
Saudi Aramco et d’autres sociétés pétrolières d’État devront-elles faire face à une facture climatique de 550 milliards de dollars américains ?
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) cherche à sécuriser une plus grande part de marché de la production mondiale de pétrole (en déclin) au cours des prochaines décennies et accorde de plus en plus d’importance aux sociétés pétrolières nationales de marchés émergents qu’aux sociétés occidentales cotées en bourse relativement à la production mondiale de pétrole.
Ce qui soulève des interrogations quant au respect des critères ESG par les sociétés pétrolières nationales comme Saudi Aramco ou Rosneft en Russie. La plupart des sociétés pétrolières nationales qui font affaire avec les pays de l’OPEP n’ont pas fait l’objet d’une surveillance accrue pour ce qui est de l’intégration des critères ESG, la plupart d’entre elles n’étant inscrites ni sur les marchés boursiers internationaux ni sur les marchés nationaux auprès de leur principal actionnaire – leur gouvernement – toujours en position de force.
Les sociétés pétrolières nationales et leurs gouvernements sont toutefois de grands émetteurs de titres de créance et attirent l’attention des détenteurs d’obligations institutionnelles.
La valeur nominale des obligations étrangères émises par les sociétés pétrolières nationales s’est située à environ 550 milliards de dollars américains en mars 2023 ; 40 % de ces obligations arriveront à échéance en 2030 ou après, selon un récent rapport du Center on Global Energy Policy de l’université Columbia (ce contenu est disponible en anglais seulement)
Cet effet de levier pourrait permettre aux investisseurs en obligations internationales d’exiger des sociétés pétrolières nationales et de leurs gouvernements qu’ils mettent sur pied un cadre ESG probant qui leur permettra de se positionner sur un pied d’égalité avec leurs homologues occidentaux.
« L’incapacité des sociétés pétrolières nationales à tenir compte des risques ESG pourrait amener les investisseurs soucieux des critères ESG à se détourner des titres de créance des sociétés de combustibles fossiles en général. Cela pourrait limiter éventuellement la capacité de ces sociétés à se refinancer ou à contracter de nouvelles obligations à l’avenir, ou faire augmenter leurs coûts de financement », révèle la recherche.
Le rapport positionne Pemex, société pétrolière d’État mexicaine, Oil & Natural Gas Corp., société d’État indienne, PetroChina en Chine, CNOOC Ltd. et d’Aramco au bas du classement en matière des résultats ESG (en fonction d’un ensemble de critères d’agences de notation et d’autres institutions).
Les agences de notation se concentrent actuellement sur les paramètres financiers des sociétés pétrolières nationales (qui demeurent solides, les prix pétroliers se situant à un peu plus de 70 $ US le baril), plutôt que sur le climat et leurs cadres de gouvernance. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a cependant ajouté une nouvelle dimension à la question, mettant en exergue l’aspect de la gouvernance.
AGRICULTURE
Le carbone bleu : une occasion de 3,5 milliards de dollars pour le Canada
Les 243 000 kilomètres de littoral du Canada, le plus long littoral au monde, peuvent jouer un rôle clé dans la lutte contre les changements climatiques. Cette ressource reste largement inexploitée, selon Le carbone bleu, un nouveau rapport de l’Institut d’action climatique RBC.
En effet, le pouvoir de séquestration du carbone des océans n’est égalé par aucun autre secteur. Les océans absorbent 31 % des émissions mondiales de CO2 en capturant et stockant le « carbone bleu » par divers processus faisant intervenir les mangroves, les herbiers de zostères marines et les marais salés.
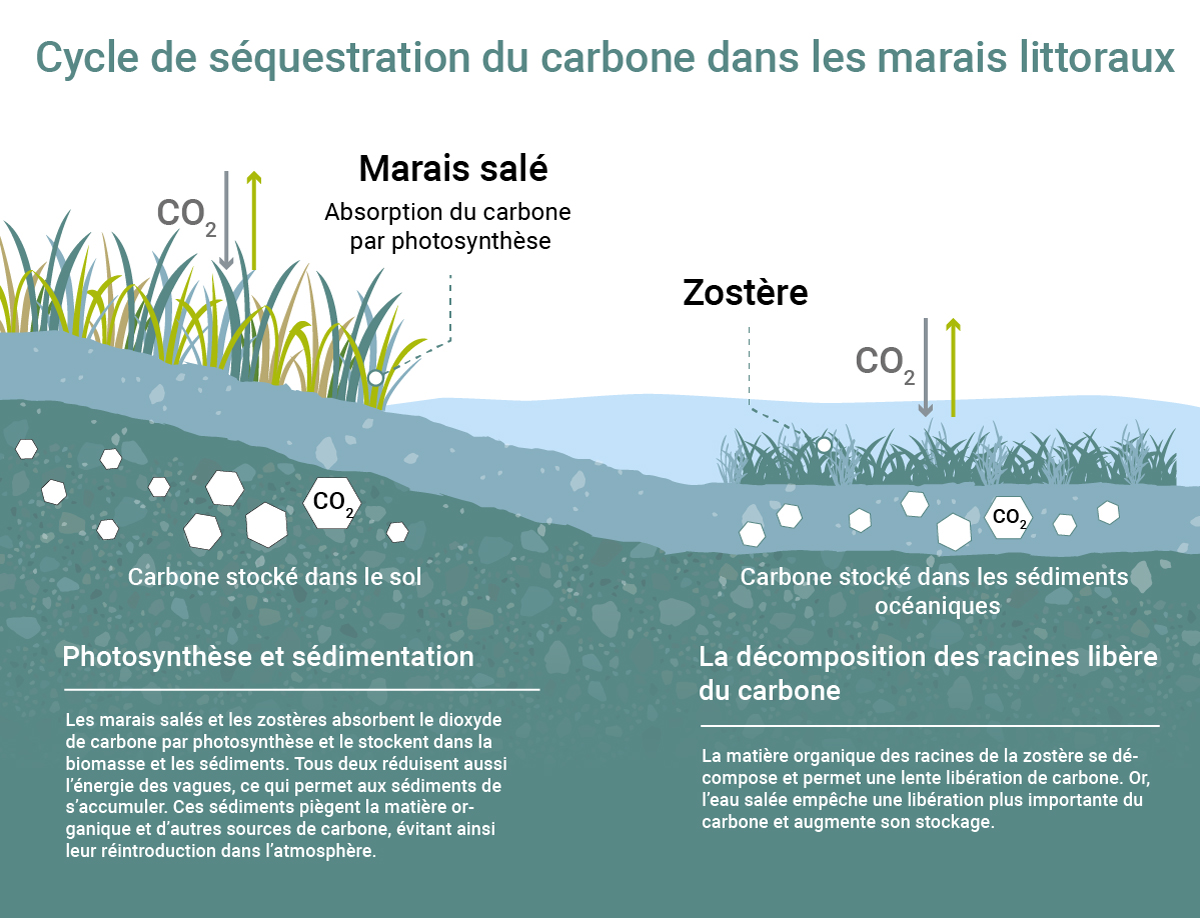
Les conséquences financières de cette ignorance s’alourdissent à mesure que de plus en plus de pays se lancent dans la cartographie de leurs fonds marins et dans le développement du marché du carbone bleu, qui en est à ses balbutiements. Les crédits de carbone bleu valent deux à trois fois les crédits de carbone classiques en raison d’un potentiel de séquestration nettement plus élevé et de services écosystémiques supplémentaires. Selon les premières estimations, le « carbone bleu » du Canada représente un marché de 3,5 milliards de dollars.
Le rapport explore trois mesures clés que le Canada pourrait prendre pour profiter de cette occasion de développement de sites verts. Lisez le rapport ici.
POLITIQUES PUBLIQUES
C’est maintenant l’Alberta de Danielle Smith
Depuis la victoire du Parti conservateur uni en Alberta, la première ministre Danielle Smith a le mandat de faire avancer les politiques de la province en matière de climat et d’énergie. Or, ces politiques ne s’harmoniseront peut-être pas toujours avec les objectifs climatiques du gouvernement fédéral. Dans son discours (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) de victoire, Mme Smith a fait part de son intention de s’opposer au « plafonnement de la production de facto d’Ottawa » et au projet de règlement sur l’électricité propre du fédéral. Les deux paliers de gouvernement pourraient cependant collaborer et faire des compromis, puisqu’ils visent tous les deux la carboneutralité d’ici 2050.
Voici certaines des idées et politiques du Parti conservateur uni qui pourraient avoir une incidence sur les objectifs climatiques du Canada :
Croissance et diversification de l’emploi : L’objectif de cette stratégie présentée dans le cadre du programme du Parti est d’accueillir des entreprises des secteurs de l’agriculture, de l’aviation, de l’énergie et de la fabrication. L’Alberta a déjà réussi à attirer des entreprises d’énergie en démarrage. Mais est-ce que ce nouveau plan stimulera un afflux plus important et accélérera la diversification ? En s’engageant à ne pas augmenter les impôts, la province pourrait attirer les investisseurs qui explorent diverses régions.
Métiers spécialisés : Un crédit d’impôt non remboursable de 1 200 $ pour les travailleurs des secteurs essentiels aux efforts de décarbonisation (dont les métiers spécialisés) pourrait aider à résorber la pénurie chronique de main-d’œuvre.
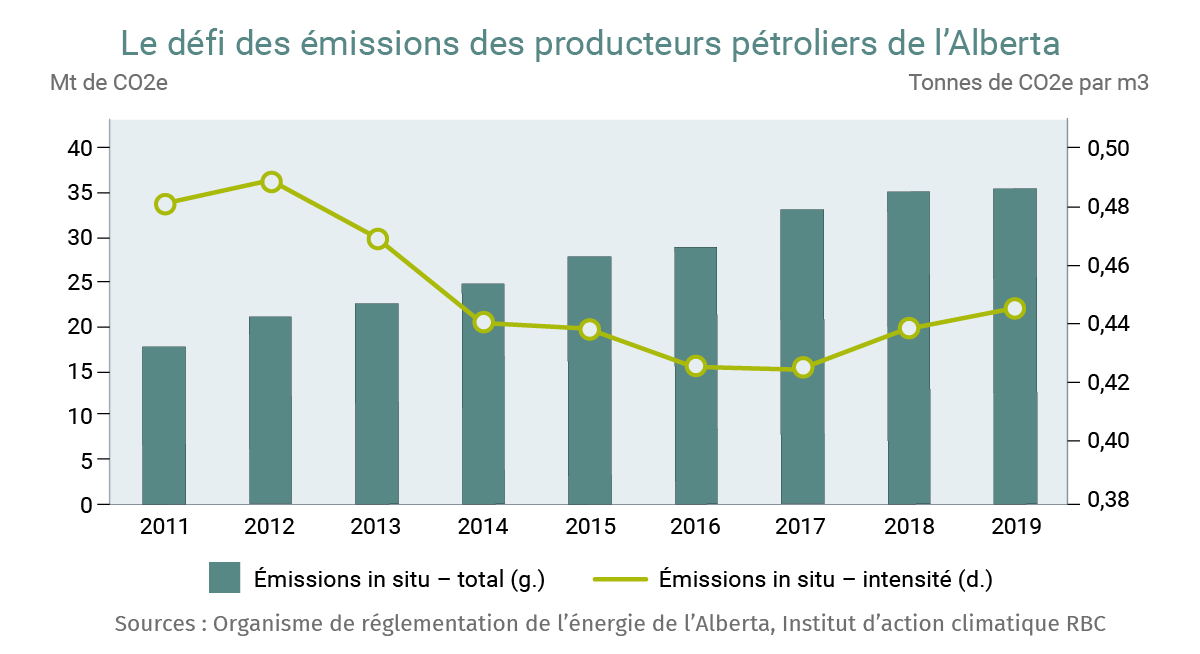
Mesures incitatives pour le captage du carbone : Le gouvernement albertain va-t-il mettre en place les mesures incitatives pour la décarbonisation des six entreprises membres de l’Initiative Alliance nouvelles voies, vu son objectif d’atteindre la carboneutralité dans le secteur des sables bitumineux d’ici 2050 ? Danielle Smith (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) a dit qu’elle envisagerait de le faire.
Plan de réduction des émissions et de développement de l’énergie : Les détails n’ont pas encore été dévoilés, mais l’objectif de ce plan (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) est d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050. L’Institut Pembina a suggéré à la province de démontrer son intention en mettant en place un plan à court terme pour réduire les émissions du secteur des sables bitumineux et les émissions de méthane d’ici 2030.
TRANSPORTS
Un été haut en émissions
Vous prenez l’avion cet été ? N’oublions pas que nos déplacements ont une incidence sur l’environnement.
| Vol aller-retour | T de CO2e | Coût pour compenser (CAD) |
|---|---|---|
| De Vancouver à Cancún | 1,01 | 22,53 |
| De Toronto à Rome | 1,48 | 34,09 |
| De Calgary à Hawaii | 1.83 | 38,34 |
| De Montréal à Bangkok | 4,21 | 92.31 |
Source : Choose
Il est vrai que les émissions augmentent plus rapidement dans le secteur aérien que dans les secteurs ferroviaire, routier et maritime, puisque les carburants d’aviation durables n’ont pas encore (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) véritablement pris leur envol.
Il ne faut pas se sentir coupable d’aller se détendre dans un lieu exotique, mais il peut être bon d’acheter des crédits compensatoires de carbone. Les compagnies aériennes canadiennes offrent à leurs passagers d’acheter de tels crédits pour
compenser le coût environnemental de leur voyage. Cependant, n’oubliez pas ceci :
1. C’est une solution imparfaite. Quand vous achetez des crédits, vous compensez les émissions de votre déplacement en finançant la plantation de quelques arbres en Équateur, par exemple. Mais ce n’est pas tout à fait équivalent. Plusieurs personnes sont d’avis que ces crédits sont inefficaces, mais ils valent mieux que rien. Bien entendu, ils ne sauraient remplacer les politiques qui visent à décarboniser des secteurs.
2. Il faut trouver un fournisseur de confiance. Certains programmes de compensation du carbone ne réduisent pas les émissions de gaz à effet de serre autant qu’ils le prétendent. Le Gold Standard (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), une norme appuyée entre autres par le Fonds mondial pour la nature, propose des projets que l’on peut suivre de A à Z en toute transparence. Mais il existe une foule d’autres options.
3. Justice climatique. Chaque petit geste compte. Quand vous achetez des crédits compensatoires pour appuyer des projets dans des pays à faible revenu, vous contribuez à la justice climatique. En effet, ce sont généralement les pays qui sont les plus touchés par les changements climatiques, alors qu’ils produisent eux-mêmes peu d’émissions.
Votre curiosité a été piquée ? Le sujet a été abordé l’été dernier dans l’un des balados de dix minutes de la série Les Innovateurs : Are Carbon Offsets Actually Effective ? (La compensation carbone est-elle efficace ? – ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement)
EN PRIORITÉ
Le prix du Règlement sur les combustibles propres
Combien le Règlement sur les combustibles (RCP) propres du Canada (qui entrera en vigueur le 1er juillet) coûtera-t-il à la population d’ici 2030 ? Le Bureau du directeur parlementaire du budget (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) (DPB) a qualifié ce règlement de « généralement régressif ». Ottawa a rétorqué que le rapport du DPB était « faussé (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) » Le RCP vise à réduire la limite d’intensité carbone de l’essence et du diesel de 15 % d’ici 2030 (par rapport aux niveaux de 2016). Les premiers ministres (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) des provinces de l’Atlantique veulent que le gouvernement fédéral retarde l’entrée en vigueur jusqu’à ce qu’un plan soit en place pour « remédier à l’incidence disproportionnée du Règlement sur les Canadiens de l’Atlantique ».
Voici les répercussions économiques du RCP prévues par le DPB :
| 17 cents/litre | Augmentation du prix de l’essence d’ici 2030 ; 16 cents pour le diesel. |
| -0,3 % | Diminution du PIB réel canadien, ou 9 milliards de dollars en 2030. |
| 0,62 % | Coût du RCP en pourcentage du revenu disponible d’un ménage à faible revenu en 2030 ; 0,35 % pour un ménage à revenu élevé. |
| 0,87% | Coût du RCP pour un ménage moyen en Saskatchewan (ou 1 117 $). C’est la province où il est le plus élevé, suivie de l’Alberta (0,80 %, ou 1 157 $) et de Terre-Neuve-et-Labrador (0,80 %, ou 850 $), en raison du poids des combustibles fossiles dans leur économie. |
Source : Bureau du directeur parlementaire du budget (ce contenu est disponible en anglais seulement)
AGRICULTURE
L’énergie renouvelable a la cote
Des agriculteurs ont adopté l’énergie renouvelable et de nouvelles technologies pour réduire leurs émissions et augmenter leur production.
En 2021, environ 12 % des agriculteurs canadiens avaient intégré l’énergie renouvelable dans leurs exploitations, soit plus du double des niveaux déclarés en 2015, selon les données de Statistique Canada. Mais l’adoption de l’énergie renouvelable s’accélère-t-elle assez rapidement pour réduire les émissions agricoles, qui représentent actuellement 10 % des émissions de GES totales du Canada ? C’est plus facile à dire qu’à faire. Dans les régions éloignées, se brancher à un réseau plus propre coûte trop cher pour de nombreuses petites entreprises du secteur.
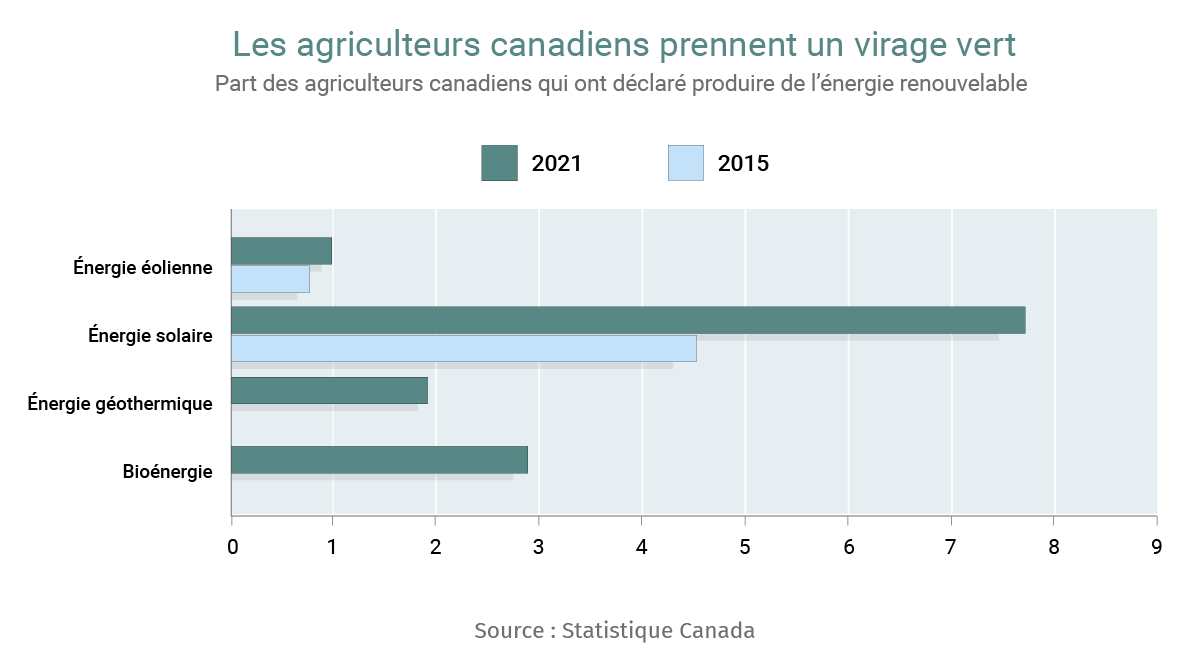
Sous le soleil : L’énergie solaire est la forme d’énergie renouvelable la plus populaire : le tiers des agriculteurs de l’Ontario et le quart des agriculteurs de l’Alberta exploitent les puissants rayons du soleil. L’installation est coûteuse, mais les économies potentielles à long terme peuvent compenser les coûts. L’un des agriculteurs avec qui l’Institut d’action climatique RBC s’est entretenu a installé des panneaux solaires d’une valeur de 300 000 $ et s’attend à rentabiliser cet investissement d’ici sept ans grâce aux économies d’énergie. L’énergie éolienne gagne aussi en popularité sur les terres agricoles canadiennes. Plus de la moitié des installations de ce genre se trouvent en Ontario.
Sous la terre : L’énergie géothermique, une importante source de chauffage des serres, des sols et de l’eau pour la pisciculture, est utilisée par 1,9 % des exploitations agricoles du Canada, en particulier au Manitoba (4,1 %) et en Ontario (3,5 %).
Un morceau du sol : Les agriculteurs de l’Île-du-Prince-Édouard et du Québec sont les plus enclins à faire des analyses d’échantillons de sol, mais cette pratique est en train de gagner du terrain dans les autres provinces. L’échantillonnage des sols permet de mesurer les nutriments qui demeurent dans les champs après une récolte, ce qui aide à faire une évaluation et à obtenir de meilleurs rendements.
Faire plus avec moins : En améliorant leur productivité, les exploitations agricoles aideront le Canada à produire plus en utilisant moins d’énergie. En 2021, plus du quart des exploitations ont déclaré utiliser des systèmes de pilotage automatique qui réduisent le gaspillage de semences et d’engrais (contre le cinquième en 2015), tandis que 20 % ont dit utiliser des trayeuses robotisées (contre près de 9 % en 2015).
ÉNERGIE
Le marché du refroidissement est en effervescence
L’augmentation persistante des températures de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels entraînera une intensification des incendies de forêt, des inondations et des événements météorologiques extrêmes, ainsi qu’une hausse de la demande de climatiseurs, qui pourrait même être imposée par la loi. Alors que la demande d’énergie liée aux climatiseurs triplera d’ici 2050 (ce contenu est disponible en anglais seulement), les émissions de ce segment pourraient doubler en l’absence de réseaux plus propres et de technologies de refroidissement efficaces.
La Commission ontarienne des droits de la personne insiste pour protéger les locataires de la province contre la chaleur (la climatisation ne figure actuellement pas parmi les services essentiels dans la Loi sur la location à usage d’habitation). En 2021, environ 64 % des ménages canadiens disposaient déjà d’un système de climatisation, contre 55 % en 2013. De plus, la croissance de l’immigration et l’augmentation de la chaleur et de l’humidité pourraient stimuler la demande. Ce n’est pas seulement une question d’inconfort : selon le Bureau du coroner de la Colombie-Britannique, un dôme de chaleur a causé la mort de 619 personnes en 2021.
D’autres régions du monde pourraient subir des conditions encore plus intenses. L’Asie du Sud, région très peuplée, devrait être la plus touchée par les changements climatiques. D’après la Banque mondiale (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), un « refroidissement équitable » s’impose, car la hausse de la chaleur et de l’humidité pourrait retrancher pas moins de 4,5 % à 5 % du PIB de l’Inde, du Pakistan et du Bangladesh, dont la population totale s’élève à près de 1,8 milliard de personnes
Alors que les températures et les revenus augmentent en Inde, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) s’attend à ce que les besoins en refroidissement du pays dépassent 1 milliard d’unités d’ici 2050, contre 67 millions aujourd’hui. En Chine, le parc de climatiseurs doublera presque pour atteindre 1,4 milliard d’unités.
Les systèmes de climatisation représentent déjà près de 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. De nombreux pays asiatiques brûlent encore du charbon pour produire de l’électricité. Il faudra donc accélérer le passage au gaz naturel, au nucléaire et aux énergies renouvelables pour lutter contre la chaleur et freiner le réchauffement planétaire.
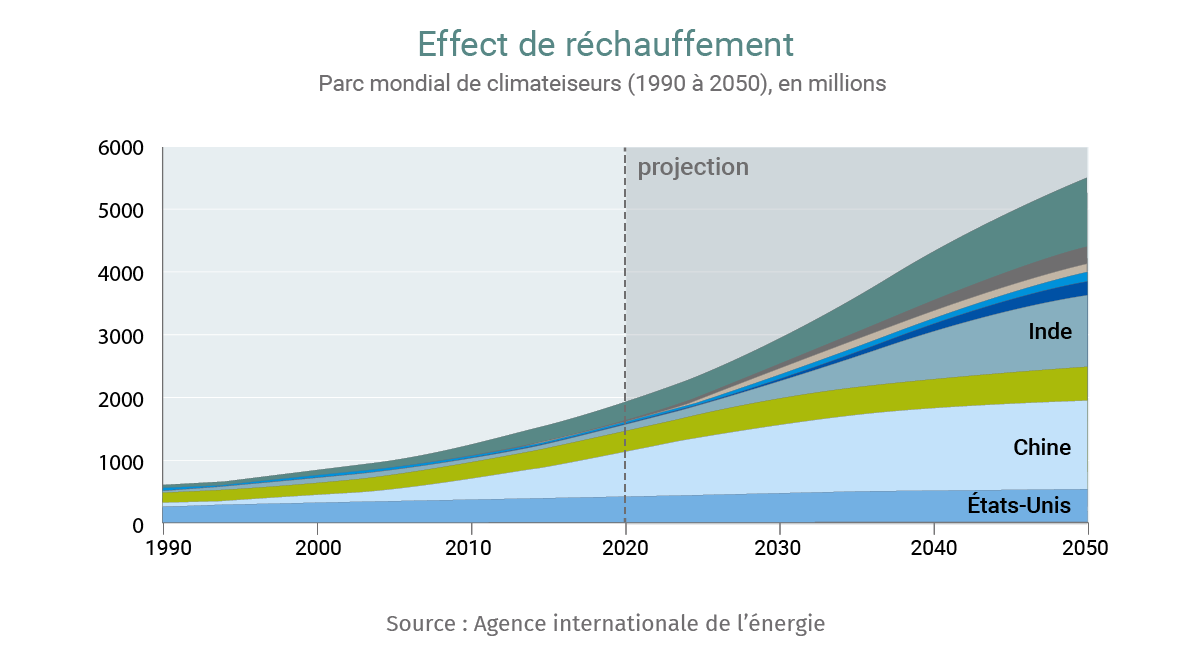
POLITIQUE PUBLIQUE
Cinq idées de Washington, D.C. sur le climat
John Stackhouse, premier vice-président de RBC, affirme après une visite à Washington au début du mois que les minéraux critiques constituent le nouveau pétrole, qu’ils transforment rapidement la vision du monde des États-Unis, et que le Canada ferait mieux de se préparer à ce changement. En provenance de la capitale des États-Unis, voici ses cinq principales observations sur le climat qui ont des répercussions sur le Canada :
- Le grand pivot. Il est de plus en plus évident que Joe Biden souhaite définir sa présidence par la capacité des États-Unis à se dissocier de la Chine. Cette volonté repose en partie sur ses politiques climatiques et sur les investissements considérables dans l’hydrogène, la capture du carbone et les véhicules électriques prévus par la loi sur la réduction de l’inflation. Toutefois, les inquiétudes des États-Unis en matière de sécurité, à savoir qu’ils dépendent trop de la Chine dans tous les domaines, constituent un facteur plus important.
- Plus de tensions dans l’Arctique. Les États-Unis repèrent des ressources minérales essentielles en Alaska, alors que la Russie fait de même de l’autre côté de l’océan Arctique. Le Canada devra agir rapidement pour exploiter sa part et l’exporter s’il veut participer à la nouvelle chaîne d’approvisionnement durable des États-Unis.
- De nouvelles tensions commerciales. Il ne faut pas croire que les États-Unis renouvelleront l’Accord Canada-États-Unis-Mexique sans livrer bataille. Les subventions destinées à encourager la croissance verte pourraient évidemment être la cible des critiques. Washington fait la même chose, mais les contradictions n’ont jamais entravé les politiques commerciales des États-Unis.
- La sécurité énergétique est une question de sécurité nationale. Qui aurait pu s’attendre à ce que Joe Biden accorde beaucoup d’importance au forage ? Or, peu de choses comptent plus que le pétrole et le gaz et leur contribution à l’inflation nationale à Washington en ce moment. Toute mesure manifeste prise par le Canada pour réduire l’approvisionnement en énergie pourrait aggraver la situation mentionnée au numéro 3.
- Accroissement de la demande d’infrastructures. Les efforts de Joe Biden visant à rapatrier les activités de fabrication nécessitent des investissements massifs dans les ports, les routes et les corridors numériques. Le Canada a beaucoup à offrir dans ce domaine, qu’il s’agisse des entreprises de construction et d’ingénierie ou des investisseurs institutionnels. C’est peut-être le moment d’aider notre allié, mais aussi de nous aider nous-mêmes.
ÉNERGIE
L’économie du recyclage : réduction de la pollution plastique
Il est souvent difficile de comprendre l’ampleur du défi posé par les changements climatiques, lequel peut s’exprimer en tonnes d’équivalent pétrole, en parties par million et en kilojoules. Prenons l’exemple du secteur du plastique, qui produit 430 millions de tonnes métriques par an. Ce chiffre semble incompréhensible si on ne le rapporte pas aux humains. Il équivaut à environ 50 kilogrammes pour chacun des 8 milliards d’habitants de la planète, ou au poids de deux valises pleines que les compagnies aériennes autoriseraient à transporter (sans payer de frais supplémentaires).
Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (ce contenu est disponible en anglais seulement) (PNUE) présente trois idées pour contribuer à résoudre le problème apparemment insurmontable que pose l’accumulation de plastique et pour aider à nettoyer les océans.
- Conception plastique 2.0 : Les voitures, les logements, les friteuses, les ordinateurs portables et les produits de base modernes contiennent des composants en plastique pour lesquels il n’existe que peu de solutions de rechange moins coûteuses. Les responsables du PNUE soutiennent que de meilleures décisions de conception (concernant par exemple les colorants, les combinaisons de matières et la taille) pourraient contribuer au recyclage de la majeure partie des produits du plastique.Des solutions ? Établir des règles de conception qui favorisent la réutilisation ou le recyclage et normaliser les formats à employer dans toutes les sociétés.
Le résultat : Selon les prévisions du PNUE, la rentabilité du recyclage pourrait doubler et faire baisser de 48 % les émissions de gaz à effet de serre. - Construction d’infrastructures de collecte. Plus de deux milliards de personnes dans le monde ne sont pas reliées aux systèmes de collecte des déchets.Des solutions ? L’harmonisation des processus de collecte et de tri avec les systèmes de recyclage peut assurer la conformité du plastique recyclé aux exigences de qualité, d’uniformité et de classement du nouveau plastique. Les gouvernements peuvent réduire les risques liés aux infrastructures de recyclage au moyen de conventions de vente et d’achat à long terme.
Le résultat : Grâce au « recyclage mécanique » (qui repose sur des technologies éprouvées) et à la technologie de conversion chimique (dont l’empreinte écologique élevée suscite la controverse), il est possible de recréer des matières plastiques à partir de matériaux existants. - Déchets d’un pays… : Le PNUE recommande de redoubler d’efforts pour réglementer le commerce du recyclage.Des solutions ? Des cadres juridiques pour le commerce des déchets plastiques instaureront la transparence, limiteront les déversements illégaux et éviteront aux pays de tomber dans l’embarras (voir le conflit relatif aux déchets (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) entre le Canada et les Philippines).
Le résultat : Le secteur privé, les gouvernements et les autres parties prenantes seront fortement encouragés à faciliter les technologies de recyclage et à les perfectionner.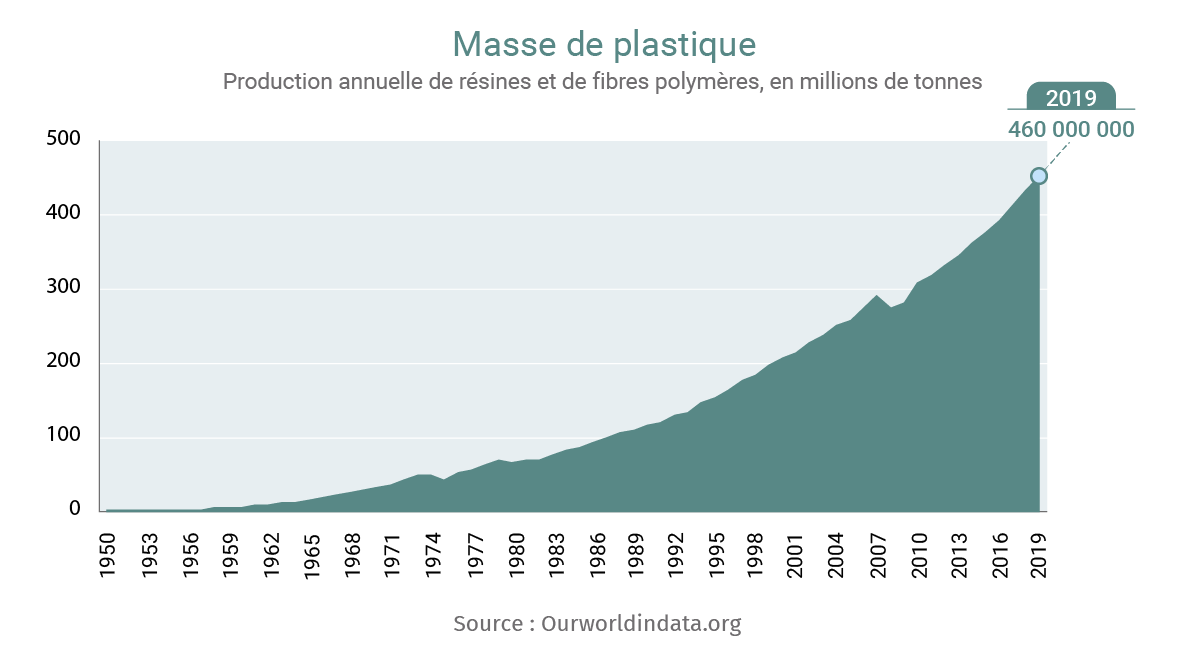 Pour en savoir plus :
Pour en savoir plus :
PNUE : Mettre fin à la pollution plastique
POLITIQUE PUBLIQUE
Le gaz à l’ordre du jour du G7
L’Allemagne (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) fait pression pour accroître les investissements dans le gaz naturel, tandis que la Chine (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) (ainsi que l’Inde) recherche des « voies multiples » pour l’utilisation des combustibles fossiles, ce qui pourrait heurter les participants au sommet du G7 qui débute aujourd’hui à Hiroshima, au Japon.
L’Allemagne considère le gaz naturel comme une « source d’énergie transitoire », arguant que ses terminaux d’importation de gaz naturel liquéfié, construits à la hâte, pourront être réaffectés à l’hydrogène lorsque cette technologie aura atteint une certaine ampleur, tandis que la Chine et l’Inde affirment qu’une voie énergétique unique ne répond pas à leurs besoins.
Le G7 cherchant à saper la future production énergétique russe (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) lors du sommet, l’accord sur les voies (au pluriel) permettant de réaliser la transition énergétique est devenu plus pressant.
Plusieurs questions de sécurité énergétique, d’environnement et de géopolitique figurent à l’ordre du jour du G7. Également à surveiller : l’évolution du « club climat », idée qui a été étoffée lors du sommet du G7 en Allemagne (ce contenu est disponible en anglais seulement) l’année dernière.
Qui peut adhérer au club et à quoi ressemblera son cadre ? L’Asian Development Bank Institute (ADBI) a quelques idées à ce sujet :
- Supprimer progressivement les subventions et améliorer la tarification du carbone. L’ADBI recommande d’en faire une condition préalable à l’adhésion au club.
- Accroître le soutien à la recherche et au développement écologiques. Les travaux de recherche et développement liés à l’environnement représentent environ 1,8 % du total de la recherche et du développement au Royaume-Uni et en France, et 0,3 % aux États-Unis.
- Imposer une taxe sur les importations de carbone aux régions qui n’ont pas de système de tarification du carbone. Un ajustement carbone aux frontières sera nécessaire pour protéger la compétitivité des participants au club climat.
Pour en savoir plus :
Communiqué des ministres des Finances du G7 (ce contenu est disponible en anglais seulement)
Rapport de l’Asian Development Bank Institute (ce contenu est disponible en anglais seulement)
BÂTIMENTS
Le défi de 40 milliards $ du Canada
Les bâtiments sont depuis longtemps au cœur du problème des émissions au Canada, puisqu’ils génèrent un huitième de nos émissions, soit quelque 90 millions de tonnes (Mt) de dioxyde de carbone chaque année. Et ces émissions augmentent, car on construit plus de maisons et de locaux commerciaux chauffés au gaz naturel.
Un nouveau rapport de l’Institut d’action climatique RBC explore l’ampleur du défi des bâtiments au Canada :
- 5,8 millions : Nombre de nouvelles habitations dont le Canada aura besoin d’ici 2030, soit 40 % de plus, car la crise d’accessibilité à la propriété et le pic d’immigration actuels font augmenter la demande.
- 18 Mt : Émissions de gaz à effet de serre ajoutées à notre empreinte carbone chaque année conformément aux codes et pratiques en vigueur. Les émissions provenant de la production du ciment et de l’acier utilisés pour les construire s’ajouteront à ce total.
- 90 Mt : Émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments existants. Pour atteindre nos objectifs de carboneutralité, nous devrons changer notre façon de construire et ce que nous construisons. Nous devrons également moderniser nos bâtiments actuels en rénovant quelque 16 millions d’habitations et 750 millions de mètres carrés de locaux commerciaux.
- 40 milliards $ : Investissements requis chaque année, dont 60 % pour les rénovations et le reste pour les nouvelles constructions.
Lisez le rapport complet ici.
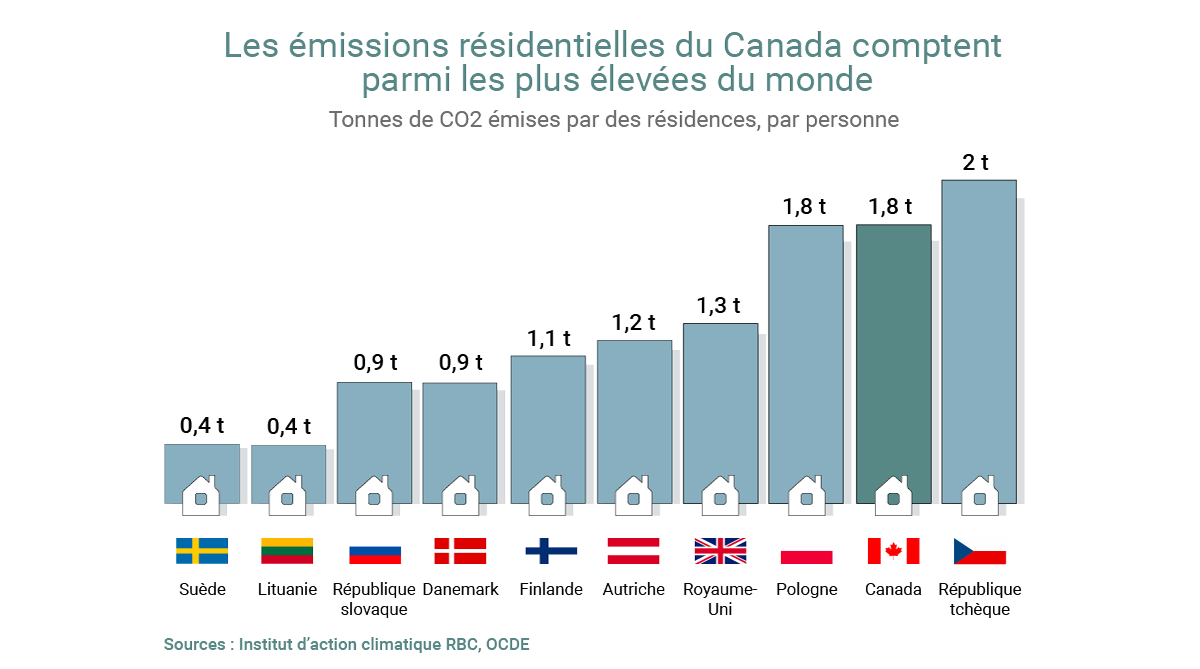
CERNER LE PROBLÈME
Projet de loi des États-Unis sur la capture de carbone
La capture et le stockage du carbone aux États-Unis constituent une immense opportunité d’investissement, alors que sont déployés les crédits d’impôt prévus par la loi sur la réduction de l’inflation. Un nouveau rapport du département de l’Énergie des États-Unis sur les possibilités de capture, d’utilisation et de stockage du carbone (CUSC) met en évidence l’ampleur et le défi de la transition énergétique du pays :
| 20 Mt par an | capacité de CUSC actuelle aux États-Unis – la plus importante au monde |
| 400 à 1 800 Mt | quantité de CO2 à capter annuellement d’ici 2050 pour atteindre les objectifs de transition énergétique des États-Unis |
| 600 milliards $ US | investissements nécessaires aux États-Unis pour tirer parti des possibilités de CUSC |
| 48 000 à 155 000 | kilomètres de tuyaux nécessaires pour acheminer le CO2 vers les sites de capture et de stockage américains d’ici à 2050. Infrastructure actuelle : 8 000 km |
Source : Département de l’Énergie des États-Unis (ce contenu est disponible en anglais seulement)
ÉMISSIONS
Charles l’écologique ?
Le roi recycle. Bien qu’il soit difficile d’imaginer le roi Charles III trier lui-même le plastique des matières organiques, la maison royale a l’habitude de recycler les déchets alimentaires, le verre, le plastique et le papier dans l’ensemble de ses palais. Le château de Windsor est alimenté par l’hydroélectricité, Balmoral par la géothermie, et les ampoules LED et les compteurs intelligents parsèment le vaste domaine. La biodiversité est également un élément clé dans l’ensemble des propriétés, avec une politique d’herbe longue, une utilisation limitée des pesticides et l’introduction récente de ruches à Buckingham Palace.
Néanmoins, les dernières données montrent que les émissions de gaz à effet de serre de la famille royale ont augmenté en 2022 en raison du chauffage, des véhicules possédés ou loués et d’une hausse de 46 % des voyages d’affaires par rapport aux niveaux prépandémiques.
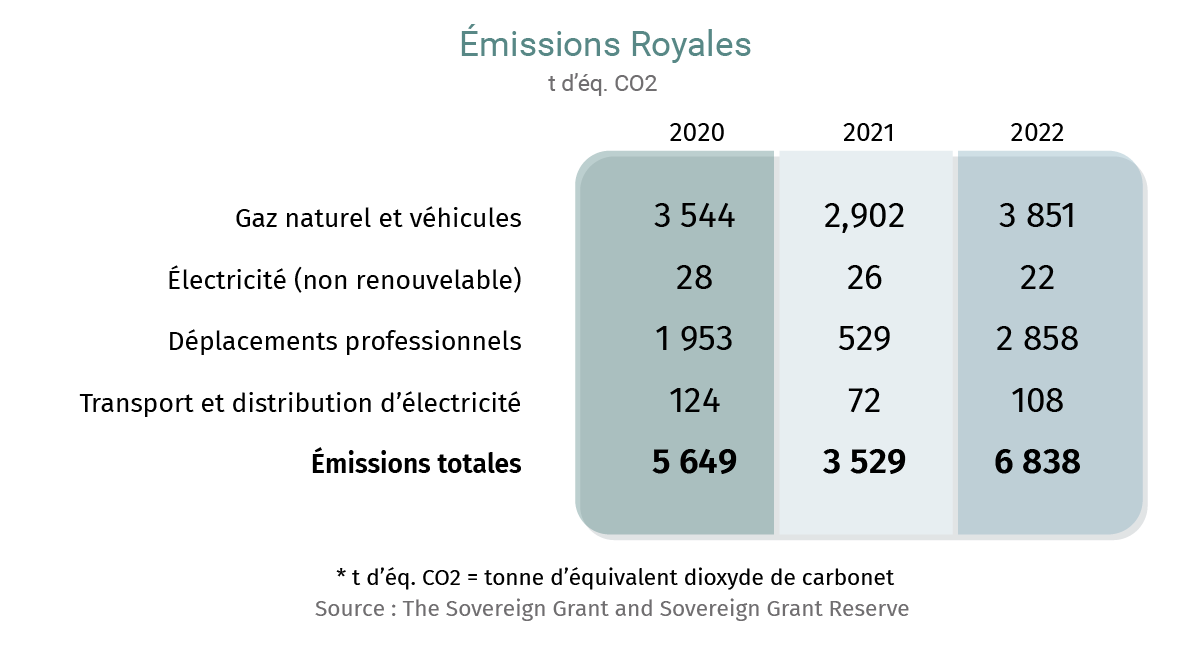
Un avertissement princier : Au fil des décennies, le nouveau roi s’est forgé une réputation d’héritier respectueux de l’environnement. Lors du sommet du G20 à Rome, en 2021, celui qui était alors prince de Galles a averti (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) les décideurs politiques représentant les économies les plus puissantes du monde qu’il s’agissait littéralement du salon de la dernière chance pour forger des partenariats public-privé et obtenir les billions de dollars nécessaires pour atténuer l’impact des changements climatiques.
Prix Earthshot : La Fondation royale et le prince William (l’actuel prince de Galles) ont créé l’année dernière le prix Earthshot (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) d’une valeur de un million de livres sterling pour récompenser les entreprises qui luttent contre les changements climatiques. Parmi les lauréats figuraient une entreprise omanaise qui minéralise le CO2 dans la roche et un groupe de femmes autochtones d’Australie qui protège la Grande barrière de corail.
Émissions royales : Le soutien à la monarchie ayant atteint un creux historique au Royaume-Uni (et au Canada (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement)), polir l’image du nouveau roi en matière de climat pourrait contribuer à jeter un éclairage (LED) sur les changements climatiques. Un bon point de départ : les émissions de la famille royale.
À LIRE :
- Nuclear Fusion By 2028? Microsoft Is Betting On It. (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) (The Washington Post)
- LG, Stellantis Project Hangs In Balance As Canada Politicians Fight Over Money (en anglais seulement) (Bloomberg)
- Oceans Have Been Absorbing The World’s Extra Heat. But There’s A Huge Payback (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) (The Guardian)
- Squaring The Circle: Reconciling LNG Expansion With B.C.’S Climate Goals (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) (Pembina Institute)
- European Energy Security: An Uncertain Road Ahead Amid A Triple Crisis (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) (Macdonald-Laurier Institute)
TRANSPORTS
Stimuler les ventes de VE au Canada
Le Canada est-il en bonne voie d’atteindre son objectif de 100 % de ventes de véhicules à zéro émission (VZE) d’ici 2035 ? Selon les projections de BloombergNEF (BNEF) et de l’Institut d’action climatique RBC, au rythme actuel, nous risquons de rater cet objectif. Les véhicules électriques (VE) ne représenteraient en outre que 38 % de l’ensemble du parc automobile canadien, soit moins que les 50 % nécessaires pour atteindre l’objectif global, selon les prévisions de BNEF. Il est essentiel d’augmenter le parc de VE pour faire une différence dans les émissions.
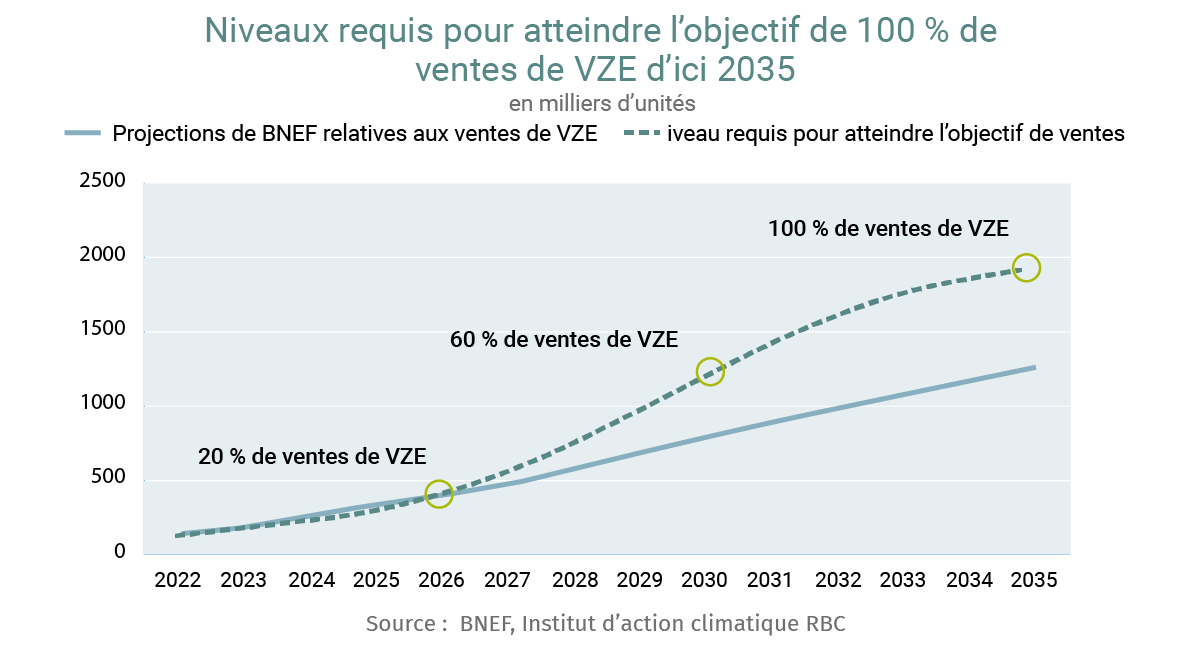
Une vague d’investissements, y compris de généreux incitatifs (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), afflue pour renforcer la chaîne d’approvisionnement en VE du Canada et préserver l’avenir de l’industrie automobile. Mais pour atteindre l’objectif de 100 % de ventes en un peu plus d’une décennie, il faudrait que les consommateurs adhèrent massivement au projet. L’industrie devra abattre les obstacles à l’accessibilité et améliorer l’infrastructure de recharge pour susciter une adoption élargie.
Angoisse liée à la recharge : Un tiers des Canadiens interrogés par KPMG (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) hésiteraient à acheter un VE en raison, entre autres, de la peur de ne pas pouvoir recharger la voiture à temps. Un autre tiers des personnes interrogées préférerait une voiture hybride (par crainte de manquer de batterie).
Les propriétaires de VE sont convaincus : Une grande majorité des propriétaires canadiens de VE interrogés dans le cadre d’un autre sondage réalisé en mars comptent bien remplacer leur VE actuel par un autre VE, quand le moment sera venu, en raison du coût d’utilisation moins élevé, du plaisir de conduite et de l’absence de bruit par rapport aux voitures dotées d’un moteur à combustion. Pourtant, selon un sondage de PlugShare (ce contenu est disponible en anglais seulement), près de la moitié des propriétaires de VE hésitent à prendre leur voiture pour de longs trajets, et deux tiers d’entre eux possèdent un véhicule à essence pour les trajets plus longs.
Perception et réalité : Avant d’acheter un VE, environ deux tiers des personnes interrogées pensaient que l’autonomie de leur VE serait leur plus gros problème – cette proportion diminue après l’achat du véhicule, pour passer à un tiers seulement. L’accès aux bornes de recharge publiques est sans doute le problème le plus important à résoudre : avant de posséder un VE, 66 % des personnes interrogées s’inquiétaient de cette question. Après l’achat, ce pourcentage demeure considérable, s’élevant à 44 %.
EN PRIORITÉ
Vers une agriculture durable
On doit s’engager sur la voie d’une agriculture plus durable, et ce rapidement. Ce secteur vital utilise une grande quantité de ressources, demeure un grand émetteur de carbone et érode la biodiversité. Un nouveau rapport examine le capital naturel consommé par le secteur :
| 23 % | Part de l’agriculture dans les émissions de gaz à effet de serre dans le monde. |
| 80 % | Part de l’agriculture dans la perte de biodiversité. Le secteur est également responsable de 80 % des modifications du régime foncier (utilisation du territoire et déforestation) et de 5 % de l’appauvrissement de la couche d’ozone. |
| 50 % | Pourcentage de toutes les zones libres de glace utilisées pour l’agriculture ; 55 % des océans font l’objet d’une pêche commerciale. |
| 70 % à 84 % | Pourcentage de l’eau douce utilisée pour l’agriculture. |
Source : Bloomberg NEF BNEF (bbhub.io) (ce contenu est disponible en anglais seulement)
MINÉRAUX CRITIQUES
Remédier à l’insuffisance de lithium
La décision du Chili de nationaliser (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) ses mines de lithium met en évidence la précarité des ressources essentielles à la décarbonation. Bien que cette mesure vise à stimuler la production chilienne, les analystes s’interrogent sur la capacité de ce grand producteur à augmenter sa production par ses propres moyens. Cette initiative suit de près celle qu’a prise le Mexique (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) au début de l’année, soit de nationaliser l’exploitation et l’extraction du lithium, et s’inscrit dans le cadre d’un problème d’expansion plus large auquel sont confrontés les « métaux verts » à un moment où ils sont censés jouer un rôle clé dans la décarbonation.
Bousculade mondiale : Le monde est exposé à une insuffisance de lithium au moment même où les grands constructeurs automobiles augmentent leur production de véhicules électriques. L’Allemagne a rouvert une mine abandonnée de spath fluor (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) – un métal connu comme étant le petit frère du lithium – après 27 ans dans le cadre d’une mesure désespérée visant à atteindre une certaine autosuffisance en matière de batteries de VE pour son secteur automobile, qui est d’une importance capitale. Les dépenses d’investissement pour l’extraction du lithium dans le monde ont atteint le chiffre record de 467 millions de dollars américains en 2022, le plus élevé depuis que S&P Global Ratings (ce contenu est disponible en anglais seulement) a commencé à suivre l’évolution de cette matière première en 2010, alors que l’industrie s’intéresse à des juridictions plus stables sur le plan politique.
Situation du lithium au Canada : L’année dernière, Ottawa a signé des accords avec deux grands constructeurs automobiles allemands afin d’exploiter les minéraux du Canada entrant dans la composition des batteries, notamment le lithium, le cobalt, le nickel et le graphite. Tesla, qui est en train de construire une raffinerie de lithium au Texas, a signé un accord au début de l’année pour s’approvisionner en minerai de lithium de grande pureté auprès d’une mine du Québec (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement). Le Canada renferme le 6e des plus grands gisements de lithium au monde, mais sa production est négligeable, quelques entreprises ayant fait faillite au cours des dernières années. Néanmoins, des projets prometteurs concernant le lithium ont progressé au Manitoba, en Ontario et au Québec, en Alberta et en Saskatchewan. L’an dernier, le Canada a également contraint des entreprises chinoises (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) à se désengager de sociétés de lithium cotées au Canada afin de sécuriser ses approvisionnements.
Crédits d’impôt – saumures : Pour contribuer à alimenter le secteur nord-américain des VE, le budget 2023 du gouvernement fédéral canadien a élargi l’admissibilité au crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques aux activités d’extraction de lithium à partir de saumures et propose de permettre aux producteurs de lithium à partir de saumures d’émettre des actions accréditives (déduction fiscale, en réalité). Cette mesure profiterait à plusieurs projets de saumure de lithium à forte intensité technologique en Alberta et en Saskatchewan, qui visent à extraire le lithium des gisements de pétrole et de gaz et des eaux usées industrielles.
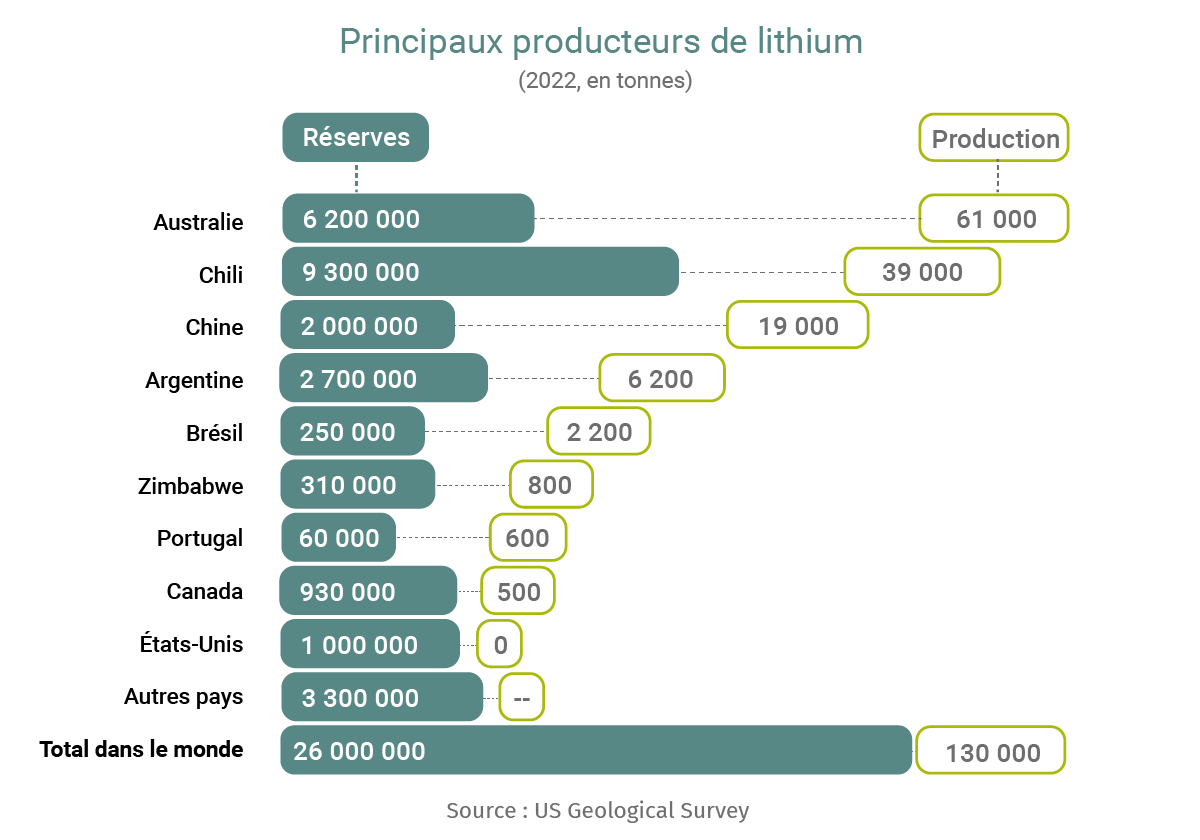
ÉNERGIE
Coût de l’abandon progressif des sables bitumineux : 100 milliards de dollars
Faut-il éliminer progressivement les sables bitumineux pour atteindre la carboneutralité ? C’est une solution, mais le Canada s’en trouvera appauvri et les gains environnementaux seront limités. Une accélération de l’élimination progressive de l’industrie pétrolière entraînerait une perte de 100 milliards de dollars du PIB, une profonde récession, une baisse des revenus et une diminution des exportations d’ici 2050. C’est ce que prévoit un nouveau rapport du Forum des politiques publiques (ce contenu est disponible en anglais seulement) Le Forum sur l’avenir énergétique, dont RBC est membre, explore les moyens pratiques qui permettront au Canada d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.
- C’est le moteur économique qu’est l’Alberta qui serait le plus touché par cet abandon. Et le cabinet de recherche Navius Research, qui a analysé les chiffres, affirme que l’impact sur l’économie de l’Alberta est peut-être même sous-estimé.
- Il sera légèrement moins coûteux pour le reste de l’économie d’atteindre ses objectifs en matière d’émissions, mais le Canada deviendrait un importateur net et perdrait des emplois.
- L’abandon des sables bitumineux priverait les producteurs existants de la possibilité d’innover pour parvenir à un avenir carboneutre. Pensons au potentiel de la capture du carbone et de la technologie – émergente – d’extraction directe dans l’air.
Confondre les émissions et les combustibles fossiles est contre-productif. Que les choses soient claires : le Canada doit mettre en œuvre de nouvelles politiques, car les leviers actuels sont encore bien insuffisants pour nous permettre d’atteindre la carboneutralité. Mais la fiabilité et l’accessibilité de l’énergie, ainsi que la prospérité économique ne doivent pas jouer un rôle secondaire dans la réduction des émissions. Nous pouvons trouver de meilleurs moyens d’y arriver.
TECHNOLOGIE
Les aspects positifs, négatifs et nocifs de l’IA
Lorsque le « parrain de l’intelligence artificielle (IA) » déclare qu’il regrette l’œuvre de sa vie et que cette technologie va peut-être trop loin, il est temps d’en prendre acte. Geoffrey Hinton est un pionnier des systèmes d’intelligence artificielle, sur lesquels reposent les nouvelles versions de l’IA telles que ChatGPT. Il nous met en garde en affirmant que la technologie non réglementée pourrait bientôt nous submerger de photos et de vidéos fictives et bouleverser les marchés de l’emploi. Les conséquences sont également importantes pour l’ensemble des secteurs de l’énergie et du climat.
Les aspects positifs : L’IA est considérée comme un outil prometteur pour lutter contre les changements climatiques. Selon Jim Bellingham, administrateur dirigeant du Johns Hopkins Institute for Assured Autonomy, sa capacité à traiter des données et des modèles climatiques détaillés et à détecter rapidement les changements dans des endroits complexes (comme les océans, l’espace proche et l’Arctique) pourrait s’avérer essentielle pour gérer les crises de façon proactive. L’IA permettrait également de construire des matériaux à faibles émissions pour les voitures électriques, les panneaux solaires et les éoliennes, qui sont plus légers, plus résistants et moins chers.
L’Université de Toronto a été récemment le principal bénéficiaire d’une subvention de 200 millions de dollars du Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada pour un projet qui combine l’intelligence artificielle, la robotique et l’informatique de pointe, dans le but de découvrir de nouveaux matériaux et de nouvelles molécules en une fraction du temps et du coût habituels. « Les applications vont des médicaments qui sauvent des vies aux plastiques biodégradables, en passant par le ciment à faible teneur en carbone et à l’énergie renouvelable », a précisé l’Université de Toronto.
Les aspects négatifs : Geoffrey Hinton et plusieurs autres leaders avisés dans ce domaine sont stupéfaits devant la formidable capacité de l’IA à diffuser des informations erronées. Ces informations pourraient s’immiscer dans le discours politique et miner les discussions et les décisions relatives aux changements climatiques et à la biodiversité. M. Hinton a aussi prévenu qu’il serait difficile d’empêcher « de mauvais acteurs d’utiliser l’IA à des fins malveillantes ». À cet égard, les possibilités sont infinies.
Les aspects nocifs : Comme l’a souligné l’historien Yuval Hariri dans le New York Times, bien que l’IA puisse inventer de nouvelles solutions aux crises climatiques et énergétiques, « les nombreux avantages qu’elle apporte ne servent à rien si les fondations sur lesquelles elle a été construite s’effondrent ».
ÉNERGIE
Essor du gaz naturel renouvelable
Le nombre de projets de gaz naturel renouvelable (GNR) devrait plus que doubler au Canada au cours des prochaines années, à mesure que les changements de politique et les mandats provinciaux entrent en vigueur. Selon la Régie de l’énergie du Canada, 18 nouveaux projets sont en cours, faisant passer la capacité totale de GNR du Canada à 17,1 pétajoules, contre 7,2 pétajoules en 2021.
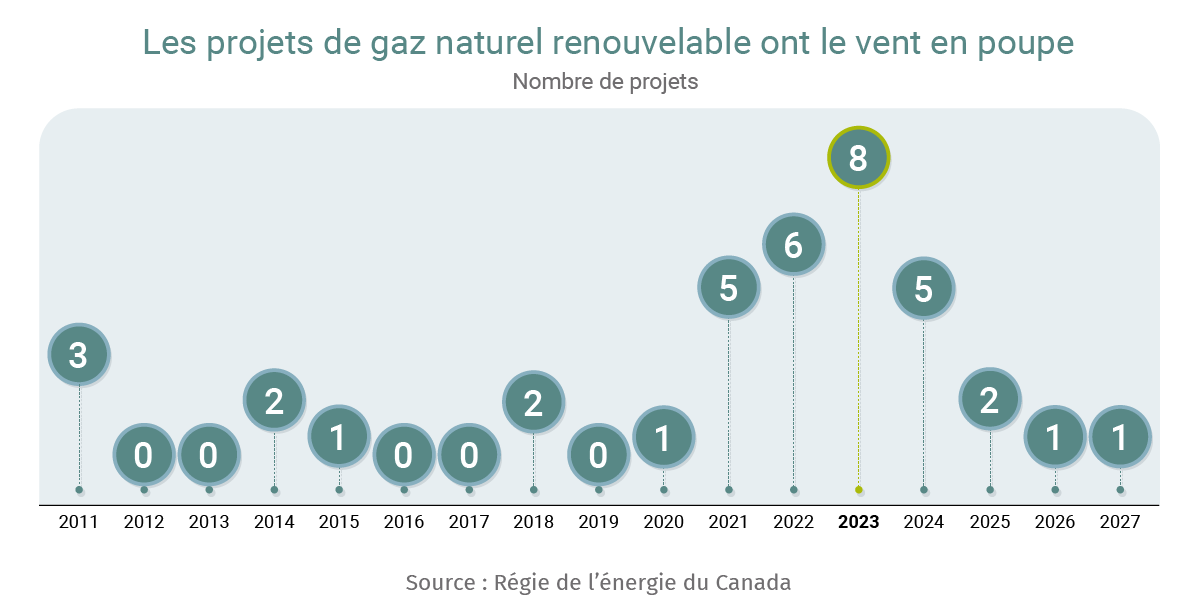
Comment produit-on du GNR ? : Le biogaz utilisé pour produire du GNR provient, entre autres, de décharges de déchets solides, de fermes d’élevage et d’opérations de gestion des déchets organiques, au moyen d’un processus biochimique, tel que la biométhanisation. Le principal atout du GNR est sa capacité à capter et à récupérer le méthane, un puissant gaz à effet de serre. Une fois traité, le GNR ne se distingue pas du gaz classique et peut être injecté dans les gazoducs existants pour alimenter les transports, les industries et les habitations.
Le Québec mène le bal : La province a été la première au Canada à rendre obligatoire l’ajout de GNR dans le gaz naturel. L’objectif est que le gaz naturel contienne au moins 5 % de GNR d’ici 2025. La Colombie-Britannique s’est engagée à atteindre une teneur de 15 % de contenu renouvelable d’ici 2030. Les services publics s’associent aux agriculteurs pour exploiter leurs
déchets organiques, construire des installations de biogaz et réduire les émissions agricoles, qui représentent environ 10 % des émissions de gaz à effet de serre au Canada.
Émissions : Selon l’Association canadienne du gaz, l’objectif fixé par les services publics canadiens, à savoir l’ajout de 10 % de GNR dans le mélange d’ici 2030, permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 24 millions de tonnes, ce qui équivaut à retirer 5,2 millions de voitures de la circulation.
Des défis ? : On en compte quelques-uns, comme la longueur des délais réglementaires pour les installations de biométhanisation et la difficulté à adapter les petites installations. Le gouvernement fédéral cherche à recueillir des commentaires sur une proposition de cadre réglementaire visant à réduire les émissions de méthane des décharges au Canada. Le GNR pourrait ainsi bénéficier d’un coup de pouce.
ÉNERGIE
Le défi des émissions en Inde
L’Inde, pays le plus peuplé du monde après avoir récemment dépassé la Chine, est confrontée à un défi climatique majeur. Le pays d’Asie du Sud, qui compte maintenant 1,4 milliard d’habitants, propulse son économie vers de nouveaux sommets. Son PIB devrait dépasser celui du Japon et de l’Allemagne d’ici 2030, et l’Inde deviendrait ainsi la troisième plus grande économie après les États-Unis et la Chine. Elle se classe déjà au troisième rang dans le monde pour l’empreinte de ses émissions, et la question est de savoir si elle peut les gérer sans sacrifier son essor économique.
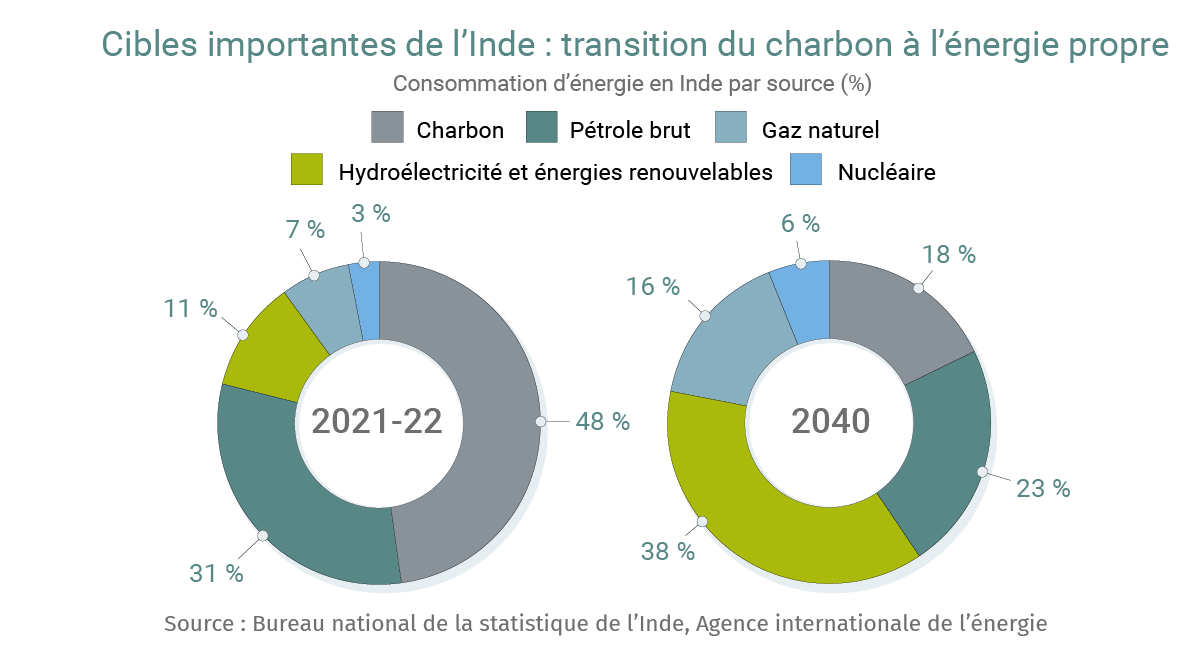
Voici un aperçu des tendances de l’énergie en Inde durant la dernière décennie :
- L’Inde est l’un des principaux producteurs et consommateurs de charbon, dont la consommation a augmenté de plus de 4 % par an ces dix dernières années.
- Au cours de cette même période, la consommation de produits pétroliers a augmenté d’environ 3 % par an et celle de gaz naturel de 1,2 %, tandis que la demande d’électricité a crû de plus de 5 %.
Ambition climatique : La croissance exponentielle que connaît l’Inde a aussi eu pour conséquence que le pays compte cinq des dix villes les plus polluées au monde. Les plans visant à porter à 50 % la capacité de production d’énergie à partir de combustibles non fossiles d’ici 2030 font partie d’un plan général dont l’objectif est zéro émission nette d’ici 2070. Toutefois, Climate Action Tracker juge « insuffisantes » les politiques et les mesures prises par l’Inde en matière de climat.
Qu’est-ce que les entreprises canadiennes peuvent apporter à l’Inde ? L’Inde attire de nombreuses sociétés. Les producteurs d’énergie traditionnelle et propre du Moyen-Orient, d’Europe et de Russie sont bien ancrés dans la chaîne logistique indienne, alors que les producteurs américains de GNL ont accéléré leurs exportations vers le pays d’Asie du Sud. La Stratégie du Canada pour l’Indo-Pacifique est axée sur les technologies propres, mais les entreprises canadiennes ont à peine exploité le potentiel de l’énergie en Inde, notamment les efforts engagés par le pays pour développer des projets écologiques dans les domaines de l’hydrogène, du solaire et de l’éolien.
POLITIQUES PUBLIQUES
Bilan des émissions du Canada
Selon une nouvelle analyse de l’Institut d’action climatique RBC, il faudrait diminuer les émissions canadiennes environ quatre fois plus vite que pendant la pandémie pour tomber à 440 millions de tonnes d’ici 2030, contre 670 millions de tonnes aujourd’hui.
Même si les politiques actuelles permettent de faire avancer les choses, l’objectif d’Ottawa de réduire les émissions de 40 % d’ici 2030 exigera beaucoup plus d’efforts de la part des industries et des décideurs fédéraux et provinciaux.
Le secteur pétrolier et gazier fait face aux défis les plus importants. La croissance démographique et l’expansion économique obligent également les secteurs de l’agriculture, de la construction et des transports à trouver des moyens de se développer sans augmenter leur empreinte carbone.
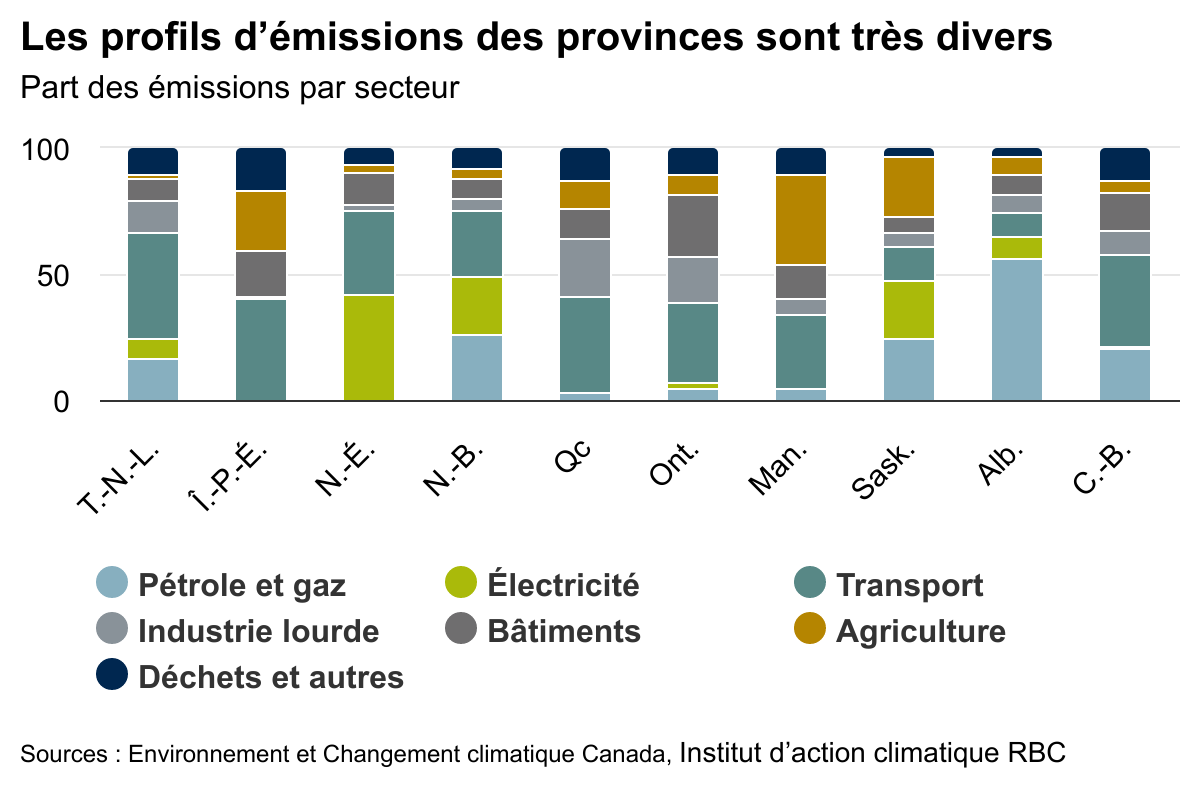
POLITIQUE PUBLIQUE
Cinq façons pour l’Alberta d’améliorer son plan climatique
Le Canada peinera à atteindre ses objectifs de zéro émission nette si l’Alberta maintient son orientation. La province a publié son Emissions Reduction and Energy Development Plan (plan de réduction des émissions et d’exploitation énergétique) après la communication du dernier rapport du Canada sur les émissions, qui montre que les émissions de la province ont augmenté de 8 %, même si celles du pays ont baissé de 8 % entre 2005 et 2021. En voici la raison : la production tirée des sables bitumineux en Alberta s’est accrue de 775 % et les émissions ont bondi de 460 % pour atteindre 70 tonnes métriques depuis les années 1990. Par contre, le monde a eu besoin du pétrole canadien, et la hausse de la production a généré des recettes fiscales, des activités économiques et de la richesse pour les actionnaires.
Les sceptiques affirment que le plan de l’Alberta ne définit pas clairement la trajectoire à suivre (Pembina Institute a déclaré que le plan ne comportait pas les éléments clés d’une stratégie crédible.)
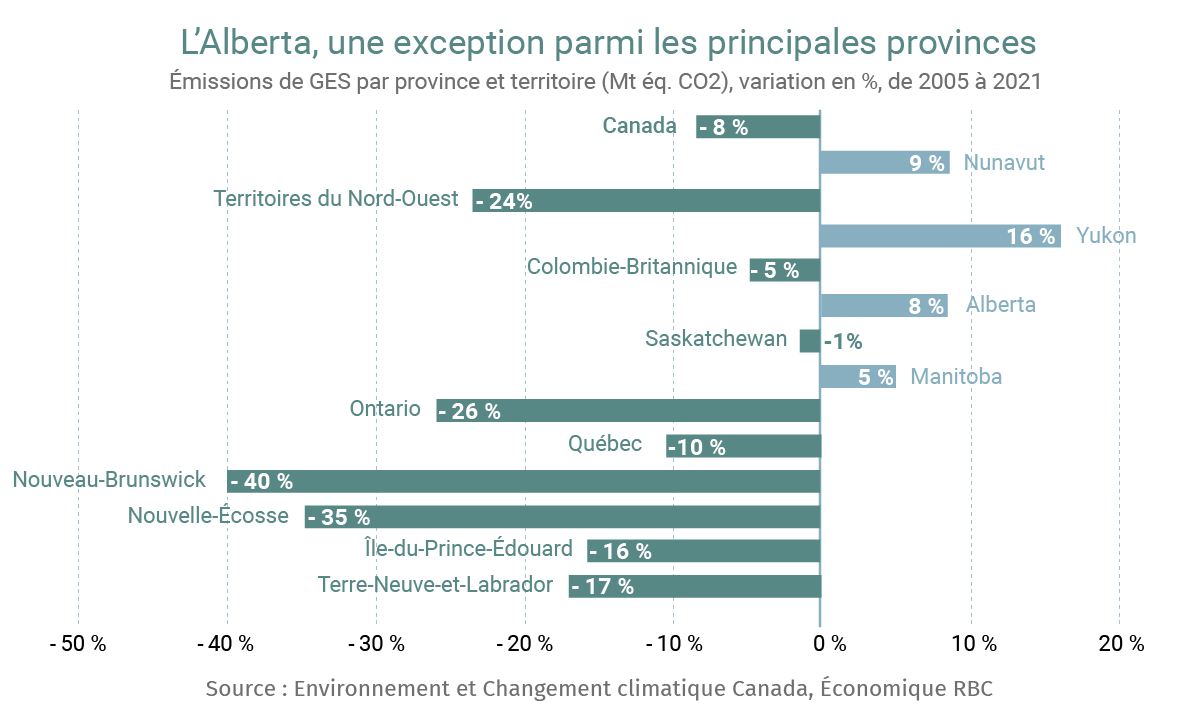
Voici ce que la province pourrait faire pour améliorer son plan :
- Objectif 2030 : Il est difficile d’établir un plan d’émissions pour 2030 à seulement sept ans de l’échéance, mais l’Alberta devrait fixer des balises pour le climat et des objectifs d’émissions. L’engagement à atteindre l’objectif fédéral de réduction des émissions de 40 % à 45 % d’ici 2030 enverrait un signal fort. La collaboration avec les groupes autochtones pour accélérer les projets de capture du carbone de l’Alliance nouvelles voies, composée de six entreprises, apporterait une crédibilité climatique immédiate.
- Réglementation stricte : Les fuites, les déversements et les accidents dans le secteur du pétrole et du gaz sont encore trop nombreux et éclipsent le travail important accompli à propos des émissions dans ce secteur. Le nettoyage des puits de pétrole et de gaz orphelins représente un autre défi auquel il faut s’attaquer résolument.
- Appel de l’Alberta : Les publicités humoristiques de la province visant à attirer les Canadiens des marchés résidentiels onéreux de Toronto et de Vancouver ont entraîné 33 000 migrations nettes au troisième trimestre de 2022 (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) Voilà un succès remarquable. L’Alberta peut-elle convaincre les (nouveaux) immigrants du secteur des technologies propres de s’installer dans la province ? Le gouvernement fédéral a également réservé des milliards de dollars aux crédits d’impôt pour les investissements dans les technologies propres et l’exploitation minière. L’Alberta peut tirer parti de ses logements abordables pour attirer une partie de ces fonds dans la province.
- Signes précurseurs : Les émissions du secteur agricole de l’Alberta ont légèrement diminué par rapport aux niveaux de 2005. Est-il possible de les réduire davantage ? Le rapport de RBC intitulé « La prochaine révolution verte» présente quelques idées.
- Électrification totale : La dernière centrale au charbon de l’Alberta devrait fermer cette année, soit sept ans plus tôt que prévu. L’abandon du charbon a fait baisser de 25 % les émissions dues à la production d’électricité depuis 2005. Ce résultat est remarquable. Malgré les nombreux parcs éoliens et solaires dans les Prairies, l’abandon du charbon a favorisé le gaz naturel, dont la nouvelle capacité de production est de 3 886 mégawatts (ce contenu est disponible en anglais seulement) L’engagement d’établir un réseau carboneutre d’ici 2035 stimulerait les investissements dans des sources d’énergie propres, y compris les petits réacteurs nucléaires modulaires (PRM) et l’hydrogène.
Pour en savoir plus :
Emissions Reduction and Energy Development Plan (plan de réduction des émissions et d’exploitation énergétique) | Alberta.ca (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement)
POLITIQUE PUBLIQUE
Pourquoi le communiqué écologique du G7 est-il un aperçu de la COP28 ?
Les désaccords en coulisses des ministres de l’environnement du G7 au Japon pourraient laisser entrevoir ce qui se passera cette année lors de la COP28 à Dubaï, dans les Émirats arabes unis.
Il est essentiel de noter que, dans leur communiqué de 36 pages, les ministres ont convenu d’éliminer progressivement la « consommation de combustibles fossiles inaltérés » afin d’atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050. Cet engagement (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) n’a pu été retenu lors de la COP27, car l’Arabie saoudite, la Chine et d’autres pays ont eu gain de cause. La demande du Japon de favoriser davantage le gaz naturel (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) (et l’hydrogène) a également été atténuée dans le projet final. Les participants sont parvenus à un compromis selon lequel aucun délai n’a été fixé pour la fermeture progressive des centrales au charbon. (Soit dit en passant, le qualificatif « inaltéré » signifie que les producteurs de pétrole et de gaz doivent redoubler d’efforts pour capturer le carbone et mettre en œuvre d’autres technologies de réduction des émissions).
Nouveau compromis climatique : Il faut s’attendre à de nouveaux compromis climatiques, car les Émirats arabes unis, pays hôte de la COP28 et grand producteur d’hydrocarbures, et leurs alliés s’opposeront à l’appel du G7. Le défi consistera à respecter l’objectif de zéro émission nette. Le compromis semble déjà se profiler : Sultan Al Jaber, président de la COP28 (et chef de la direction de l’entreprise d’État Abu Dhabi National Oil Co.), préconise une transition énergétique pragmatique. Alors que certains contestent la pertinence de la présence à la tête de la plateforme climatique la plus influente du monde d’un chef de la direction du secteur pétrolier, les centres d’hydrocarbures tels que les Émirats arabes unis sont également les lieux où se déroulent les plus grandes luttes contre les changements climatiques, et les enjeux sont encore plus importants pour les économies des pays en voie de développement.
Pour en savoir plus :
A Kingdom Built On Oil Now Controls the World’s Climate Progress (un royaume fondé sur le pétrole dicte maintenant l’évolution climatique de la planète) (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement)
TRANSPORT
Problématique des trottinettes électriques
Les trottinettes électriques semblent être une solution écologique intéressante pour parcourir les derniers kilomètres et effectuer des trajets rapides, mais leur utilisation est controversée. Les Parisiens ont récemment interdit les services de 15 000 trottinettes par un vote étonnant : 89 % des votants se sont prononcés contre (même Anne Hidalgo, maire de Paris, socialiste et adepte du vélo (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), a soutenu l’interdiction). La National Federation of the Blind (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) du Royaume-Uni estime que les trottinettes électriques ne ressemblent pas à des vélos et sont dangereuses pour les aveugles et les personnes ayant une déficience visuelle. Pour sa part, Accessibility for Ontarians with Disabilities Act Alliance (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) les considère comme une menace silencieuse.
Quels sont les arguments contre les trottinettes électriques ? Elles encombrent les rues et la limite d’âge est souvent inférieure à celle des autres modes de transport. Les trottinettes électriques seraient la cause de décès (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) et d’accidents graves dans de nombreuses villes. (Le recyclage suscite également des inquiétudes, mais ce problème n’est pas propre aux trottinettes électriques.)
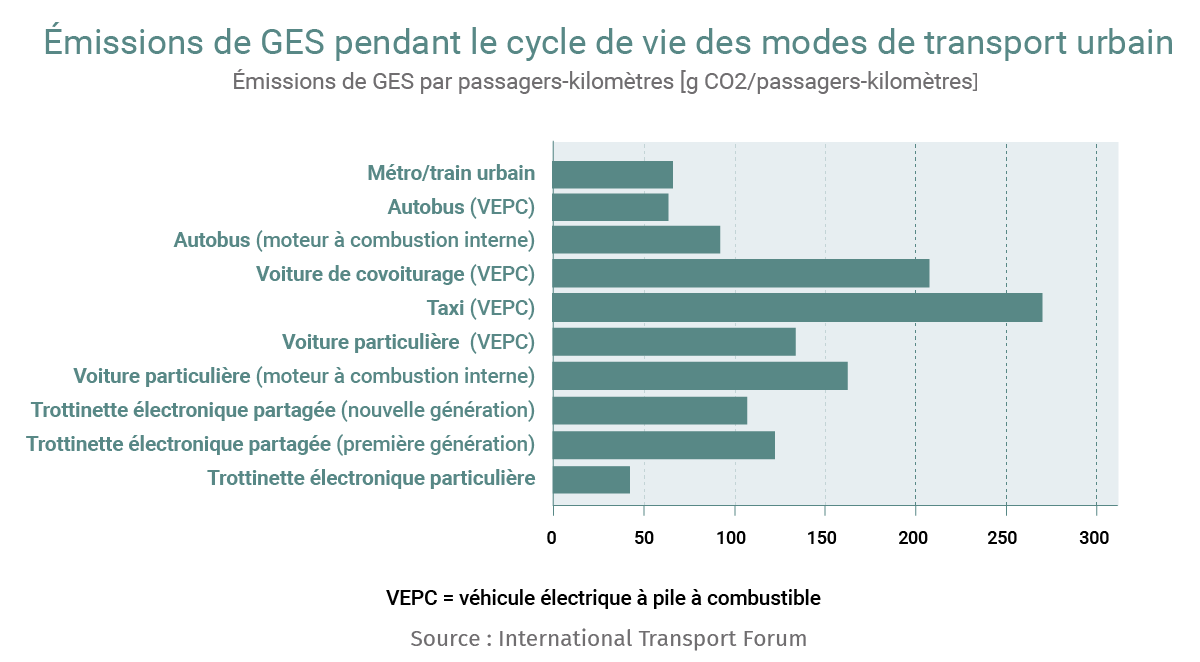
Quelles sont leurs qualités écologiques ? Selon les études menées par International Transport Forum (ce contenu est disponible en anglais seulement), les trottinettes électriques ont une incidence environnementale inférieure à celle des taxis, des services de covoiturage et des voitures particulières, mais les services de mobilité partagée entraînent les plus grands effets sur l’énergie et les émissions de GES par kilomètre parmi toutes les options de mobilité urbaine. Les trottinettes électriques de nouvelle génération sont dotées de batteries interchangeables, ce qui augmente les émissions de gaz à effet de serre par kilomètre, mais pourrait aussi prolonger leur durée de vie.
Une autre étude (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) indique que dans 65 % des cas, les émissions de gaz à effet de serre pendant le cycle de vie liées à l’utilisation des trottinettes électriques sont plus élevées que celles liées à l’ensemble des modes de transport qui ont été remplacés.
En outre, les trottinettes électriques et d’autres microservices de transport partagé pourraient supplanter le mode de mobilité le plus écologique : la marche à pied. Il sera difficile pour les trottinettes électriques de concurrencer les transports publics de plus en plus électrifiés dans les grandes villes canadiennes. Toutefois, compte tenu de la hausse du prix de l’essence, cette solution reste attrayante pour bien des gens.
Quelle est la situation des trottinettes électriques dans les villes canadiennes ? Plusieurs grandes villes du Canada, notamment Toronto, ont interdit les services de trottinettes électriques, mais certaines villes comme Vancouver ont approuvé un programme pilote de trottinettes électriques de trois ans à partir de 2021, mais des restrictions s’appliquent. Les trottinettes électriques devraient réapparaître à Ottawa en mai, sous réserve de règles strictes.
ÉNERGIE
L’énigme du gaz au Canada
Le gaz naturel représente actuellement l’un des plus grands choix climatiques du Canada. L’expansion de l’exploitation de cette ressource abondante pourrait stimuler l’activité économique et contribuer à réduire les émissions de GES. Par contre, sans d’importants investissements dans les technologies de réduction, nous risquons de rater nos cibles de carboneutralité.
L’énigme du Canada : trois moyens de faire face aux crises mondiales climatiques et gazières, nouveau rapport de l’Institut d’action climatique RBC, porte sur les trois rôles que peut jouer le Canada à l’échelle mondiale pour améliorer la sécurité énergétique et environnementale :
- Fournisseur de la côte du golfe du Mexique – Approvisionnement à grande échelle des producteurs de gaz naturel liquéfié (GNL) de cette région, où les terminaux se multiplient. Cette stratégie pourrait élever les émissions en amont du Canada dues au secteur gazier d’au plus 7 %.
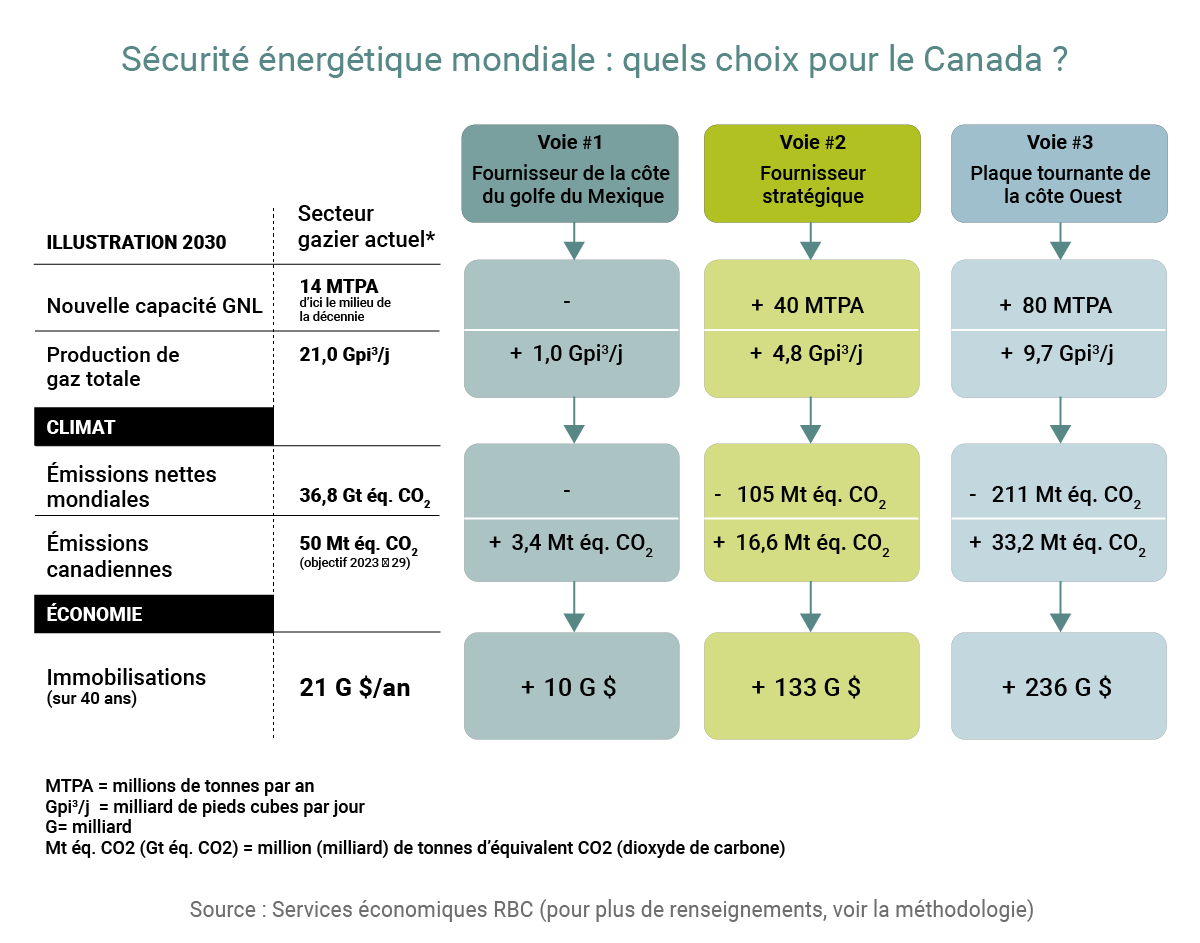
- Fournisseur stratégique – Constitution d’une niche dans le marché mondial du GNL par la fourniture stratégique de gaz stable et à faibles émissions. Quelques projets pourraient contribuer à réduire les émissions mondiales de 105 Mt éq. CO2 (soit à peu près l’équivalent des émissions totales du Qatar), mais entraîneraient aussi, en l’état actuel de la technologie, une augmentation d’un tiers des émissions du secteur gazier canadien.
- Plaque tournante gazière de la côte Ouest – Exploitation du plein potentiel du GNL pour jouer un rôle plus décisif sur le marché mondial du gaz naturel. Cette stratégie pourrait entraîner une réduction des émissions mondiales nettes de 211 Mt éq. CO2, mais entraînerait aussi une augmentation de 66 % des émissions du secteur gazier canadien. Elle susciterait plus de 200 milliards de dollars d’investissements.
Lisez le rapport complet ici.
OBJECTIF CLÉ
À la tête de la brigade des VE
Selon un nouveau rapport de l’Agence internationale de l’énergie (ce contenu est disponible en anglais seulement), la part de marché des véhicules électriques s’accroît régulièrement, et ce, non seulement sur les marchés clés que sont la Chine, les États-Unis et l’Europe, mais aussi sur plusieurs marchés émergents prometteurs. Voici quelques points saillants :
| 10 millions | Nombre record de voitures électriques vendues à l’échelle mondiale en 2022. Selon les prévisions, 14 millions de VE seront vendus en 2023. |
| 5 millions | Nombre de barils de pétrole qui devraient être économisés d’ici 2030, grâce à l’électrification rapide du secteur du transport. |
| 60 % | Part de marché de la Chine dans les ventes de VE. |
| 9,6 % | Part de marché des véhicules zéro émission vendus au Canada au quatrième trimestre de 2022, contre 8,7 % au troisième trimestre. |
Sources : Agence internationale de l’énergie (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement), Statistique Canada
TRANSPORTS
Les ventes de véhicules électriques dynamisent le secteur minier du Canada
Le secteur des véhicules électriques en Amérique du Nord est passé à la vitesse supérieure. Une nouvelle proposition des États-Unis (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) visant à imposer des règles strictes en matière d’émissions sur les voitures conventionnelles devrait doper les ventes de véhicules électriques au pays, réduire les importations pétrolières américaines de 20 milliards de barils (avis aux producteurs pétroliers canadiens) et éviter l’émission de 10 milliards de tonnes de CO2, soit plus du double du total des émissions de CO2 américaines en 2022. Toutefois, il faudra beaucoup plus de minéraux essentiels pour atteindre l’objectif déclaré des États-Unis, soit 66 % de toutes les ventes de voitures d’ici 2032.
La recherche de matières premières : certes, le manque d’infrastructures de charge pourrait ralentir les ventes de véhicules électriques, mais le risque de pénurie de matières premières susceptible de freiner l’offre est un motif d’inquiétude encore plus important. Les pays occidentaux et les constructeurs automobiles (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) se démènent pour obtenir des matières de plus en plus coûteuses comme le lithium, le cuivre, le nickel et les terres rares, et cela ne fait que renchérir les coûts. Le dernier communiqué des ministres de l’environnement du G7, après la réunion tenue la semaine dernière à Sapporo, au Japon, a souligné l’importance de renforcer les chaînes logistiques essentielles de minéraux et de matériaux afin d’atteindre l’objectif d’une économie carboneutre.
Une occasion pour le Canada : la transition des véhicules thermiques vers les véhicules propres ne sera pas facile ni rapide, mais la nouvelle politique américaine est une aubaine pour l’industrie minière canadienne.
Le secteur a reçu une excellente nouvelle d’Ottawa, qui propose un crédit d’impôt à l’investissement pour les sociétés minières dans le budget fédéral de 2023. Une stratégie sur les minéraux critiques, dotée d’une enveloppe de 3,8 milliards de dollars, a été annoncée dans le budget de 2022 afin de tirer parti de la loi américaine sur la réduction de l’inflation et des nouvelles mesures du gouvernement américain visant à favoriser les achats auprès de fournisseurs nord-américains. La Réserve fédérale a également mis en place un fonds de l’infrastructure des minéraux essentiels (de 1,5 milliard de dollars) destiné aux projets énergétiques et de transport nécessaires à l’exploitation de gisements riches en minéraux. Le Canada a déjà signé un plan d’action conjoint avec les États-Unis, l’Union européenne et le Japon, car il se positionne comme fournisseur de minéraux essentiels.
Ce qui manque ? La mobilisation des groupes autochtones, sans laquelle le développement de projets d’infrastructure d’énergie propre, talon d’Achille du Canada, n’est pas possible. De nombreux gisements riches en minéraux, comme le Cercle de feu en Ontario, empiètent en partie sur un territoire autochtone, et le capital naturel, financier, intellectuel et humain des populations qui y vivent est nécessaire pour faire avancer ces projets, comme expliqué dans notre récent rapport 92 à Zéro.
BÂTIMENTS
Les pompes à chaleur : un atout pour l’avenir
Les systèmes de ventilation du monde connaissent une révolution climatique silencieuse. Les achats de pompes à chaleur aux États-Unis ont dépassé ceux des chaudières à gaz naturel en 2022 et s’inscrivent dans une hausse mondiale des ventes de systèmes de chauffage et de refroidissement.
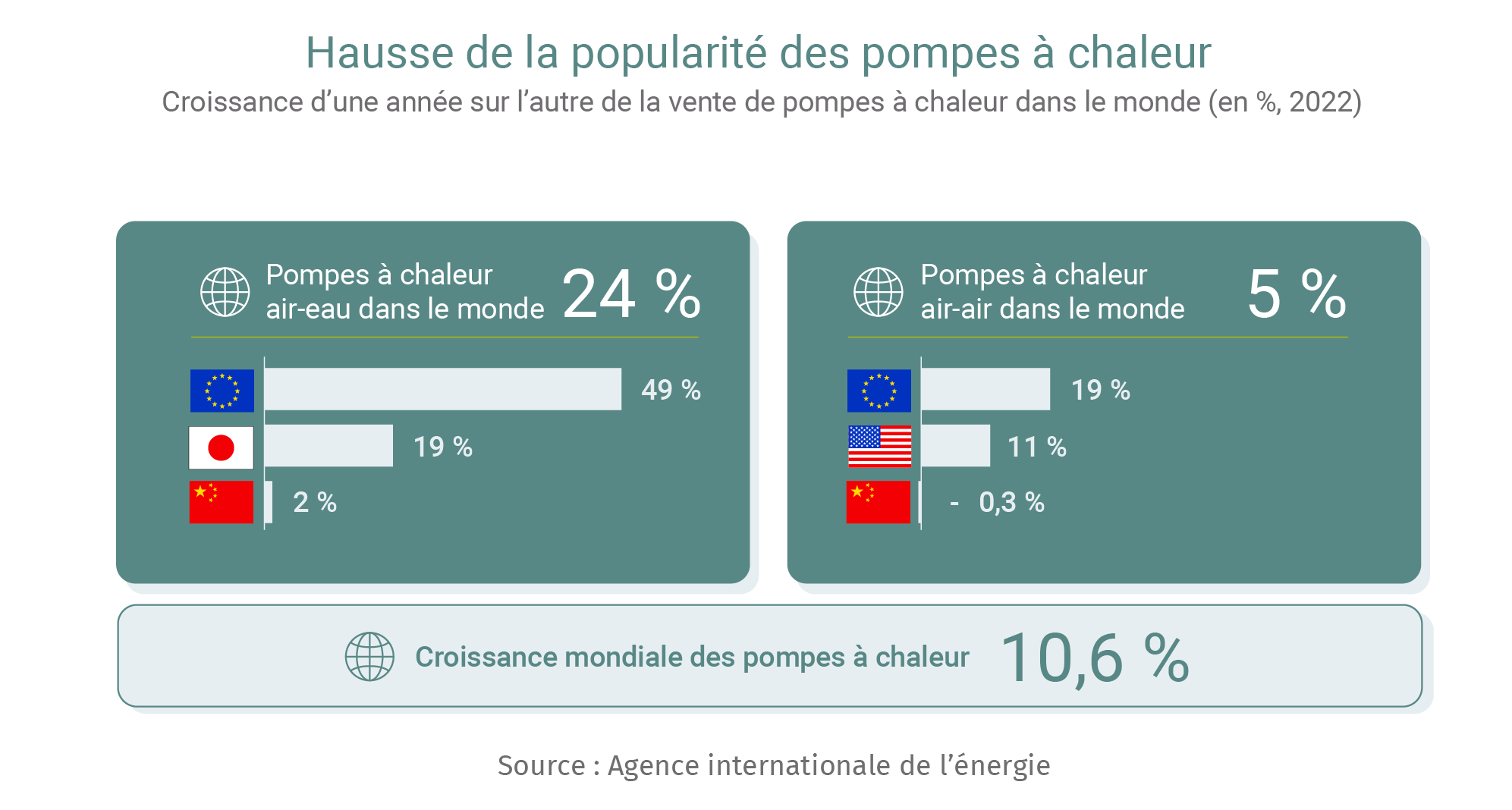
Les pompes à chaleur, c’est quoi déjà ? Ressemblant aux chaudière pompes às, les chaleur peuvent être deux à trois fois plus efficaces que les autres sources électriques de chauffage domestique, ce qui leur attire les faveurs des économistes spécialistes de l’environnement. Les pompes à chaleur ont connu une faible adoption au Canada, car elles sont moins optimales à des températures glaciales, mais la situation évolue à mesure que la technologie s’améliore.
Les ventes mondiales de pompes à chaleur ont donc bondi de près de 11 % en 2022, ce qui constitue la deuxième année de croissance à deux chiffres, selon les données de l’Agence internationale de l’énergie (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) L’Europe a enregistré une hausse des ventes de 40 %, car le continent a travaillé d’arrache-pied pour réduire sa dépendance au gaz naturel russe. À l’échelle mondiale, les pompes à chaleur (lorsqu’elles sont utilisées comme principal appareil de chauffage) assurent 10 % des besoins en chaleur des bâtiments et devraient atteindre 20 % d’ici 2030 si l’on veut respecter les engagements mondiaux en matière de lutte contre les changements climatiques.
L’installation de pompes à chaleur présente des coûts initiaux élevés, mais les incitations financières sont fortes dans 30 pays et les subventions sont en hausse dans le monde. La loi américaine sur la réduction de l’inflation, par exemple, prévoit des crédits d’impôt fédéral sur le revenu pour l’installation de pompes à chaleur (ce lien mène à un site web dont le contenu est en anglais seulement) Les chaînes d’approvisionnement mondiales dans ce domaine sont actuellement sous tension, en particulier pour les puces, mais les mesures d’incitation à la fabrication aux États-Unis et dans l’Union européenne devraient stimuler l’offre.
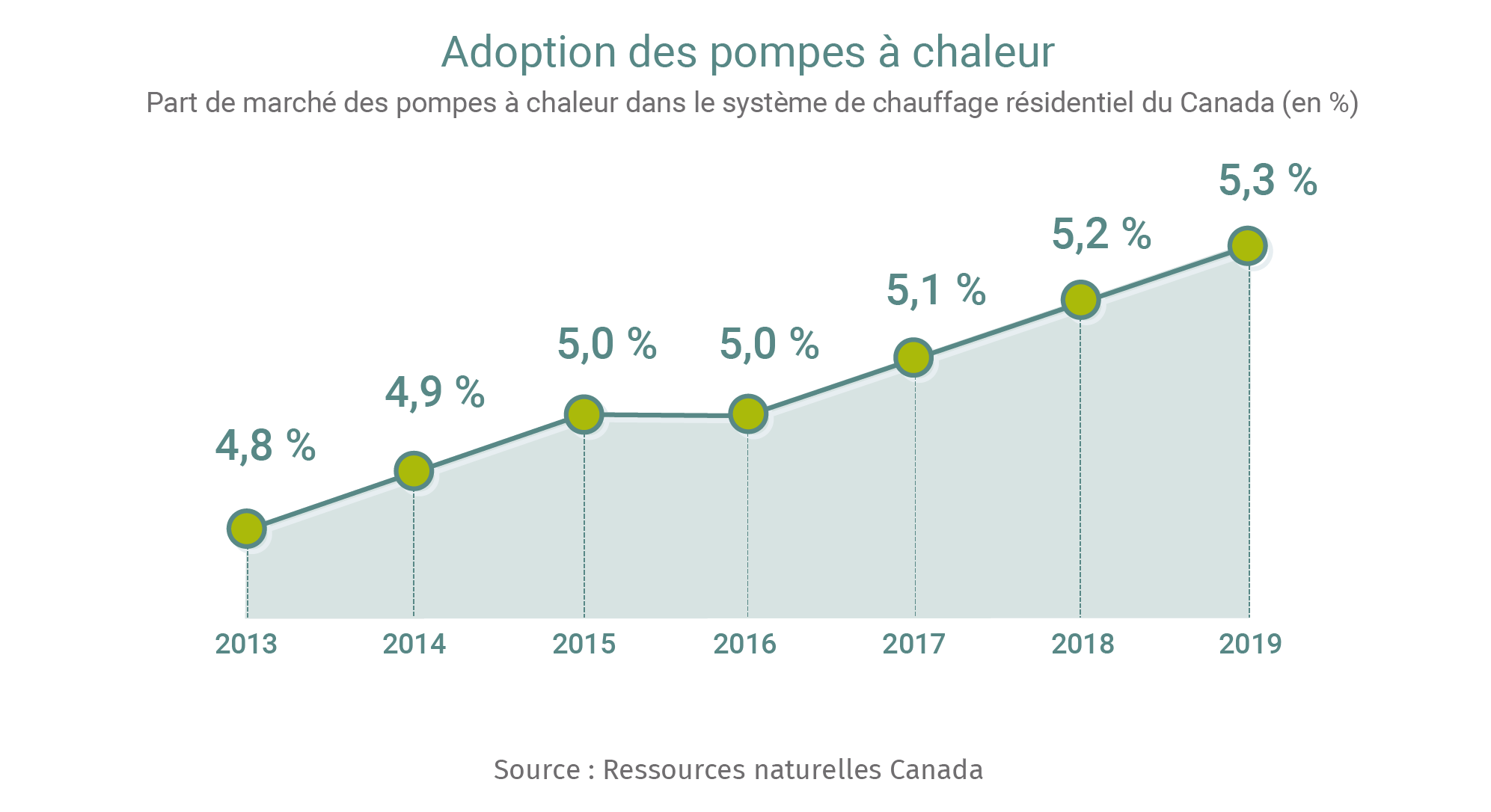
Pourquoi le Canada est-il en froid avec les pompes à chaleur ? Le gouvernement fédéral considère que l’adoption de la pompe à chaleur est l’un des moyens de réduire les émissions des bâtiments, qui représentent 13 % des émissions de gaz à effet de serre du Canada. Pourtant, les ventes ont stagné. Les pompes à chaleur ont atteint 5,3 % du marché canadien de la chaleur et de la ventilation en 2019, mais les mesures du Plan de réduction des émissions pourraient aider à doubler cette part d’ici 2030, selon les estimations de l’Institut Climatique du Canada.
Comment le Canada peut-il accélérer l’adoption de la pompe à chaleur ? Il le pourrait de trois façons :
- En offrant des subventions pour rendre le coût initial des pompes à chaleur plus attrayant pour les acheteurs précoces et aider à abaisser la courbe des coûts.
- En ciblant les secteurs dans lesquels les pompes à chaleur sont déjà pertinentes sur le plan financier (p. ex., pour de nombreux ménages qui se chauffent au mazout ou au propane).
- En informant les techniciens et les installateurs de climatisation des avantages des pompes à chaleur, vous les aiderez à les commercialiser auprès d’un plus grand nombre de propriétaires.
FINANCEMENT
Une Banque mondiale plus verte
La semaine dernière, les plus grandes nouvelles en matière de climat n’ont pas fait la une. Or, elles pourraient changer le cours de l’histoire.
Les principales puissances économiques mondiales se sont réunies à Washington et ont convenu de réformes pour la Banque mondiale, qui permettront à l’institution de prêter 50 milliards de dollars supplémentaires sur 10 ans aux pays à revenu faible ou moyen pour lutter contre les changements climatiques. Il s’agit d’une étape importante pour aider les pays en développement à investir dès maintenant dans l’énergie propre et les processus industriels.
Mais il y a encore beaucoup à faire. Selon les prévisions du Peterson Institute for International Economics (ce contenu est disponible en anglais seulement), les économies en développement du monde, qui contribueront majoritairement à la croissance des émissions de gaz à effet de serre dans les décennies à venir, ont besoin de multiplier par sept leurs investissements climatiques. La majeure partie de ces prêts peut provenir du secteur privé, mais il faut aussi beaucoup plus de prêts garantis par les gouvernements afin de réduire le risque pour les autres investisseurs.
Les banques multilatérales de développement comme la Banque mondiale, la Banque de développement asiatique et la Banque africaine de développement, entrent dans la danse. Elles ont mis sur la table 20 milliards de dollars américains en financement climatique en 2020, à comparer aux 66 à 111 milliards de dollars américains de prêts garantis par les gouvernements que l’Institut Peterson estime nécessaires pour lutter contre les changements climatiques.
Pour obtenir ce type de capital, l’Occident devra investir beaucoup plus dans la Banque mondiale et dans d’autres entités du même genre, ou laisser la Chine et d’autres pays à revenu intermédiaire en pleine croissance jouer un rôle plus important. Les deux options sont contestées en raison de l’austérité budgétaire dans les pays occidentaux et du désir de Washington de contrecarrer l’influence chinoise.
La secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, a dit à la Banque de faire plus avec les moyens dont elle dispose. Les ministres des Finances des pays en développement se sont également rendus à Washington pour rappeler que la lutte contre la pauvreté est une priorité mondiale, car ils estiment que les gouvernements et les investisseurs s’empressent d’investir dans des fermes solaires plutôt que dans des écoles primaires.
Si les États-Unis et les autres grands actionnaires de la Banque mondiale renoncent à demander des réformes et des capitaux, leurs objectifs en matière de lutte contre les changements climatiques pourraient bien manquer leur cible.
POLITIQUES PUBLIQUES
Une vague d’investissements carboneutres est imminente
Le budget fédéral de 2023 du Canada propose des mesures vigoureuses en réponse à la loi américaine sur la réduction de l’inflation (l’IRA ou l’Inflation Reduction Act) prévoyant des dépenses de plusieurs milliards de dollars, mais l’adhésion massive à des pratiques d’investissement carboneutres pourrait se heurter aux obstacles que sont la concurrence internationale croissante, la réglementation et la difficulté de s’entendre avec les provinces.
Les nouvelles mesures vertes du budget visent à renforcer la chaîne logistique en amont pour favoriser une économie à faibles émissions de carbone, au moyen de nouveaux crédits d’impôt à l’investissement remboursables accordés pour l’électricité propre, la fabrication de technologies propres et l’hydrogène. Dans la foulée de l’annonce de crédits d’impôt à l’investissement faite l’an dernier pour la capture de carbone et les technologies propres, le gouvernement fédéral prévoit dépenser environ 80 milliards de dollars sur dix ans en crédits d’impôt pour les investissements verts.
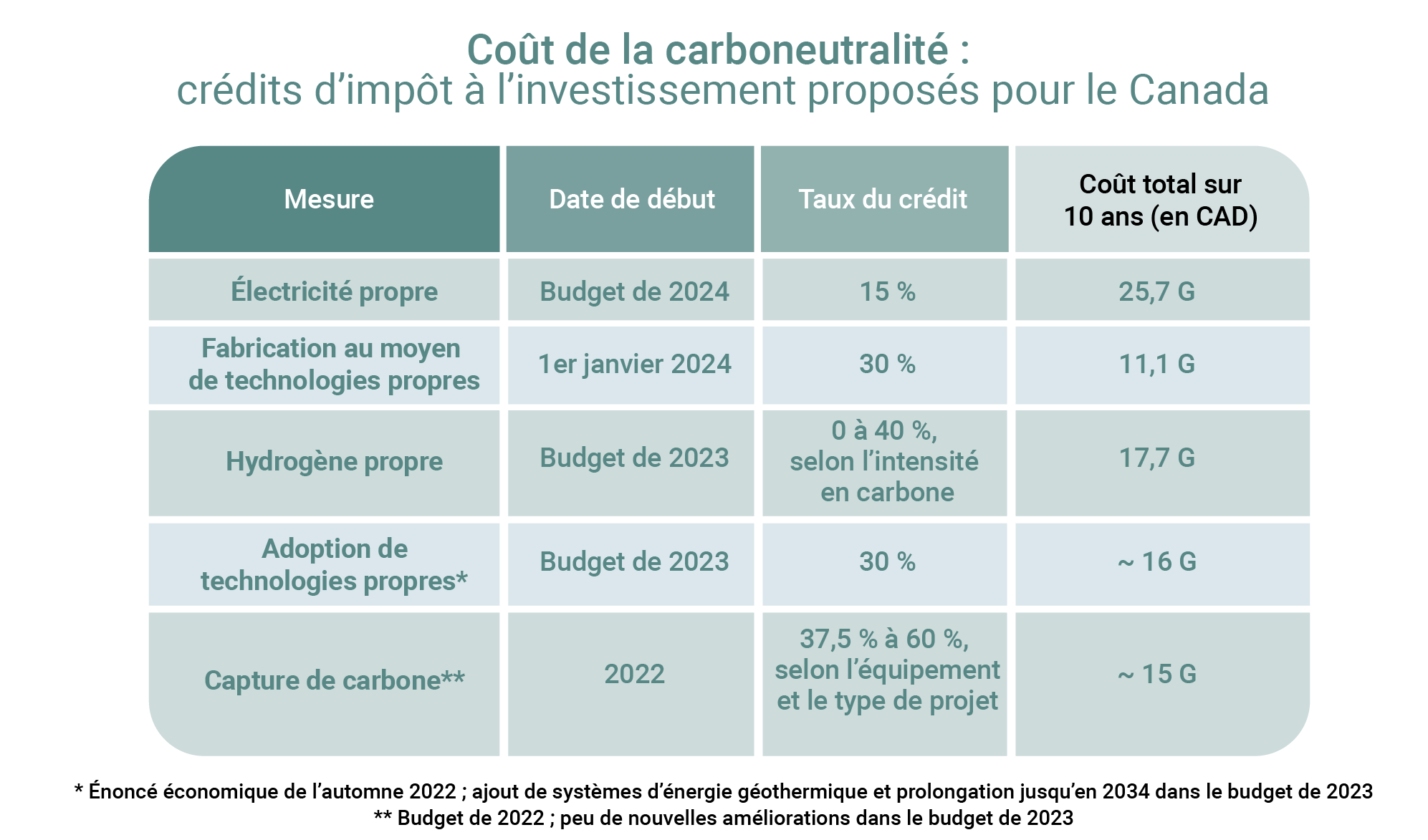
Ces mesures soutiennent avantageusement la comparaison avec celles de l’IRA, mais le nouvel article Perspectives et politique : le budget 2023 favorisera-t-il les investissements verts ? de l’Institut d’action climatique RBC explique pourquoi le Canada pourrait encore se heurter à des difficultés dans ses efforts pour obtenir des investissements verts.
DES EFFORTS DE PLUS EN PLUS PAYANTS
Bilan des émissions du Canada
Quelques bonnes nouvelles à l’approche du Jour de la Terre (22 avril) : le Rapport d’inventaire national 2023 du Canada montre des progrès dans la mise en œuvre de mesures de lutte contre les changements climatiques. Il reste encore beaucoup à faire pour atteindre les objectifs de réduction des émissions du Canada pour 2030. Quelques statistiques importantes tirées du dernier rapport :
- -8,4 %
- Diminution des émissions de gaz à effet de serre du Canada en 2021 par rapport aux niveaux de 2005. Toutefois, les émissions en 2021 ont augmenté de 1,8 % par rapport à 2020, lorsque sévissait la COVID.
- 5 %
- Augmentation des émissions de GES provenant des transports, suivie d’un bond de 4 % des émissions liées au gaz et au pétrole entre 2020 et 2021.
- -2,2 %
- Recul des émissions de GES agricoles entre 2020 et 2021, dû en partie aux baisses de la production agricole provoquées par les épisodes de sécheresse dans les Prairies.
- -29 %
- Moindre intensité des émissions du PIB canadien depuis 2005, ce qui suggère un découplage de la croissance économique des émissions.
Source : Rapport d’inventaire national
Le présent article vise à offrir des renseignements généraux seulement et n’a pas pour objet de fournir des conseils juridiques ou financiers, ni d’autres conseils professionnels. Veuillez consulter un conseiller professionnel en ce qui concerne votre situation particulière. Les renseignements présentés sont réputés être factuels et à jour, mais nous ne garantissons pas leur exactitude et ils ne doivent pas être considérés comme une analyse exhaustive des sujets abordés. Les opinions exprimées reflètent le jugement des auteurs à la date de publication et peuvent changer. La Banque Royale du Canada et ses entités ne font pas la promotion, ni explicitement ni implicitement, des conseils, des avis, des renseignements, des produits ou des services de tiers.


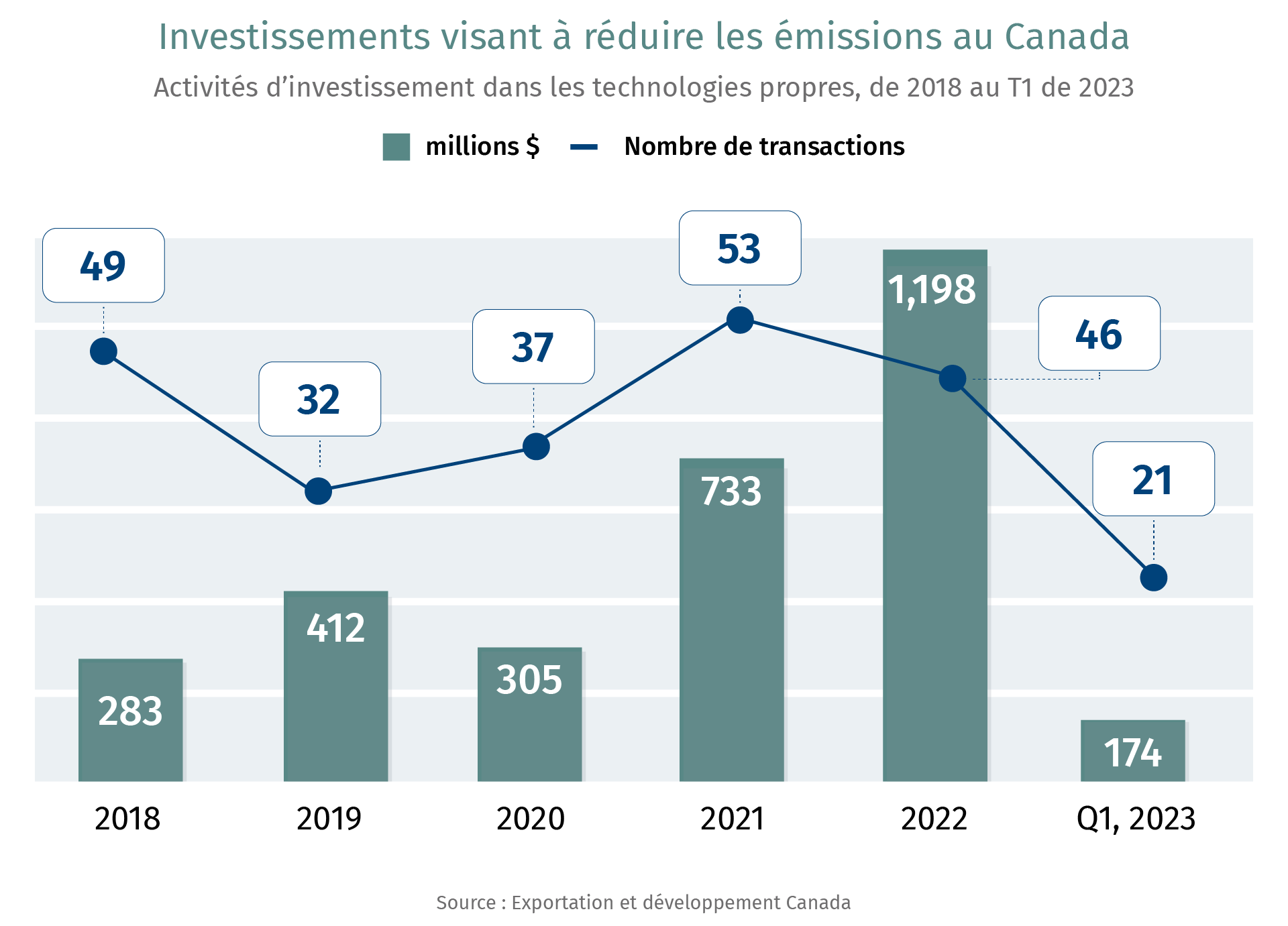
 Voir Plus
Voir Plus